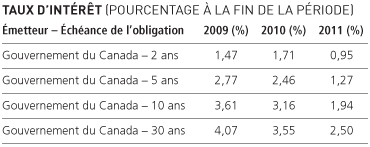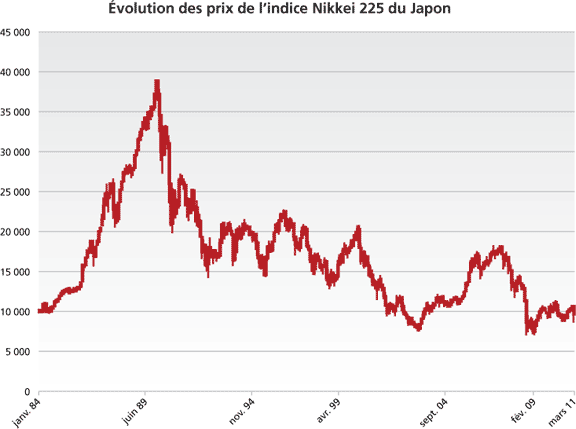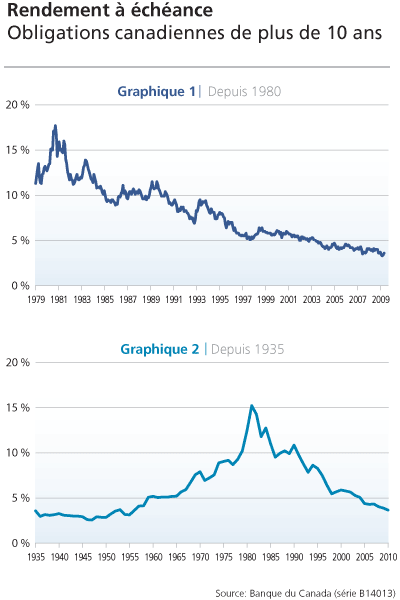Avec un rendement de 8,66 %1 au 31 décembre 2011, le Fonds obligations canadiennes FMOQ s’est classé bon premier parmi les Fonds FMOQ quant aux rendements pour cette période annuelle. De leur côté, les Fonds d’actions affichaient des rendements négatifs pour la même période.
En plus de provoquer des « J’aurais donc dû… », une telle constatation est susceptible de piquer la curiosité de ceux qui ne s’étaient jamais intéressés aux fonds d’obligations jusqu’alors. Si tel est votre cas, voici les principales caractéristiques des obligations, des fonds d’obligations et de l’évolution de leurs rendements sur le marché.
Titre à revenu fixe
Une obligation est un titre de créance à long terme émis par un gouvernement ou une société. Elle fait partie de la famille des titres à revenu fixe, car l’émetteur s’engage principalement à deux choses:
1) verser périodiquement2 au détenteur de l’obligation un montant d’intérêt fixe, selon le taux de coupon convenu, et ce, jusqu’à l’échéance de l’obligation;
2) rembourser au détenteur la valeur nominale de l’obligation à la date d’échéance qui peut aller jusqu’à 30 ans à compter de l’émission.
C’est ce revenu potentiel fixe qui sert de base pour l’évaluation d’une obligation existante, en fonction du taux de rendement exigé par le marché.
Taux de rendement exigé
Pour chaque obligation émise antérieurement et qui est négociée, le marché « exige » qu’elle produise, pour son éventuel acheteur, un taux de rendement similaire à celui que rapporterait une nouvelle émission d’obligations d’échéance et de risque à assumer similaires.
Le risque dépend principalement de l’émetteur (p. ex. le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, une municipalité ou une société), de sa cote de crédit, de la liquidité du titre, etc. En théorie, une obligation déjà en circulation et comportant un taux d’intérêt nominal (taux du coupon), un niveau de risque ainsi qu’une échéance similaires à une nouvelle obligation, devrait exiger le même rendement que celle-ci. Toutefois, il est très rare en pratique que deux séries d’obligations émises à deux périodes différentes affichent exactement les mêmes caractéristiques, en particulier quant au taux d’intérêt nominal qui varie en fonction des taux en vigueur au moment de l’émission. C’est l’évaluation mathématique du rendement courant d’une obligation par rapport à son échéance et à son taux nominal, de même que les lois de l’offre et de la demande, qui déterminent le prix de vente de l’obligation.
L’évaluation des obligations
Puisque le revenu généré par une obligation jusqu’à son échéance est fixe, le mécanisme de l’offre et de la demande sur le marché s’avère le seul moyen de déterminer le prix par lequel un acheteur peut obtenir le taux de rendement exigé, ce dernier évoluant au rythme des taux d’intérêt dans l’économie.
Ceci signifie que, si le taux de rendement exigé pour une obligation donnée augmentait, la seule façon de réaliser ce plus haut taux de rendement, à partir du revenu fixe prévu, serait de payer un prix moins élevé pour l’obligation. De la même façon, le prix d’une obligation augmenterait si jamais le taux de rendement exigé sur le marché venait à baisser. En conséquence, compte tenu des fluctuations constantes des taux d’intérêt, la valeur marchande d’une obligation varie constamment au cours de sa durée : à la hausse si les taux courants baissent, à la baisse s’ils montent.
Il est important de distinguer ici le taux de rendement exigé par le marché, tel que décrit précédemment, du taux de rendement réalisé évoqué au début de l’article.
Le taux de rendement réalisé est la somme du revenu courant et de l’intérêt reçu, plus la croissance (ou moins la décroissance) de la valeur du capital. Ainsi, quand le taux de rendement exigé par ceux qui veulent acheter des obligations diminue, le taux de rendement réalisé par leurs détenteurs augmente en raison de l’accroissement de la valeur de leurs obligations.
De plus, pourvu que son détenteur conserve son obligation jusqu’à son échéance (et que l’émetteur ne fasse pas défaut, bien sûr), le rendement à échéance sera toujours correspondant à celui exigé par le marché lors de l’achat (à l’émission ou par la suite), et ce, peu importe les fluctuations de prix et de rendement exigé par les marchés tout au long de la durée de l’obligation.
En d’autres mots, même si le rendement d’une obligation pour une année est négatif à la suite d’une dévaluation de sa valeur sur les marchés (p. ex. à cause d’une hausse des taux d’intérêt courants), son détenteur aura obtenu, en moyenne, à l’échéance, le rendement exigé par les marchés au moment de l’achat. En contrepartie, l’existence d’un marché secondaire pour les obligations offre en tout temps une liquidité au détenteur, de même qu’une opportunité de réaliser à tout moment la valeur ajoutée de son placement, advenant une baisse des taux d’intérêt courants. Ce même détenteur doit toutefois faire preuve de patience en période haussière des taux, et laisser le temps faire son œuvre.
L’évolution des taux de 2009 à 2011
Le tableau ci-dessous détaille l’évolution des taux de 2009 à 2011. À titre d’exemple, le taux de rendement pour les obligations de 10 ans émises par le gouvernement du Canada est passé de 3,16 % (fin 2010) à 1,94 % (fin 2011). Cette baisse du taux de rendement, qui était généralisée pour l’ensemble des obligations canadiennes en 2011, a entraîné une augmentation des valeurs marchandes des obligations, d’où la relative bonne performance des fonds obligataires en 2011.
Les taux de rendement exigés par les marchés pour chaque type d’émetteur varient selon des courbes (généralement ascendantes), selon les durées à courir avant l’échéance. Les variations des taux de rendement exigés des obligations et, inversement, de leur prix, ne sont jamais uniformes. Par exemple, la variation des taux de rendement exigés d’une obligation de 5 ou de 30 ans sera différente, de même que la variation pour une même échéance, d’une obligation du Canada par rapport à une obligation corporative.
À titre d’exemple, le tableau suivant permet d’illustrer la baisse généralisée du taux de rendement exigé pour les obligations du gouvernement du Canada de 2009 à 2011. Ces données témoignent de l’augmentation de la valeur marchande de l’ensemble des obligations qui est à la source de la bonne performance des portefeuilles d’obligations au cours de ces années.

Les prévisions
Tant au Canada qu’aux États-Unis, la situation économique explique les niveaux historiquement bas des taux d’intérêt actuels. Cette situation devrait vraisemblablement s’améliorer, selon les prévisions des économistes. Puisqu’on peut anticiper une augmentation des taux d’intérêt des deux côtés de la frontière au cours des prochaines années, on peut également prévoir une baisse générale de la valeur marchande des obligations.
Ceci ne signifie pas pour autant qu’il faille éviter totalement ces dernières. En effet, les obligations continueront à jouer un important rôle de diversification dans un portefeuille équilibré, tout en étant fort utiles, si jamais la situation économique et les marchés boursiers s’avéraient moins favorables.
Les Fonds d’obligations
Contrairement à une obligation détenue directement, où le détenteur n’évalue pas constamment la valeur marchande de son titre, un fonds d’obligations doit, afin que les entrées et sorties s’effectuent à la juste valeur marchande, évaluer à chaque jour d’évaluation (quotidiennement ou hebdomadairement), la valeur de chacune des obligations et, par conséquence, de l’ensemble du fonds. La valeur unitaire du fonds évolue donc constamment en fonction des taux de rendement exigés par les marchés.
L’achat d’un portefeuille d’obligations, par le biais d’un fonds commun de placement, comporte tout de même des avantages certains, notamment :
1) une excellente diversification en ce qui concerne les types d’émetteurs, les émetteurs, la durée, le crédit, etc. ;
2) les gestionnaires de ces fonds peuvent parfois utiliser différentes techniques afin de maximiser le rendement du fonds et atténuer les conséquences d’une hausse de taux anticipée.
Toutefois, étant donné qu’un fonds d’obligations contient différentes obligations dont les échéances varient et que son portefeuille est constamment renouvelé (contrairement à une obligation détenue directement), il n’existe pas d’échéance précise. On ne peut donc pas connaître à l’avance la période au cours de laquelle le rendement à l’achat sera obtenu. Dans une conjoncture de relative stabilité des taux d’intérêt, elle devrait être approximativement équivalente à la durée moyenne de l’ensemble du portefeuille.
Le Fonds obligations canadiennes FMOQ
Le Fonds obligations canadiennes FMOQ a été créé en mars 2001. Son approche indicielle « améliorée » l’a très bien servi depuis sa création, car il a dégagé un rendement annuel composé de 5,72 % au 29 juin 2012.
L’approche indicielle est qualifiée d’« améliorée » parce que le Fonds est construit sur la base de l’indice DEX Univers. Le gestionnaire ne sélectionne pas tous les titres qui composent l’indice et jouit d’une certaine latitude quant au type d’émetteurs d’obligations gouvernementales.
Ces bons résultats classent le Fonds obligations canadiennes FMOQ dans le premier quartile (le meilleur 25 %) des fonds d’obligations canadiennes de l’univers des fonds AON Hewitt au 31 mai 2012 pour le rendement de 5 et de 10 ans.
Le Fonds est composé exclusivement d’obligations canadiennes dont l’échéance moyenne est actuellement d’environ 9,7 ans, ce qui lui confère une durée moyenne de 6,8 ans. Celle-ci a permis au Fonds de bien profiter du contexte baissier des taux. Même s’il en ira autrement lorsque les taux d’intérêt recommenceront à monter, on peut tout de même espérer un rendement légèrement positif, si les taux n’augmentent pas brusquement.
Conclusion
Les titres à revenu fixe ont toujours leur place dans un portefeuille de valeurs mobilières, entre autres, parce qu’ils réagissent de façon différente des actions et que leur capital à l’échéance comporte une garantie de remboursement de la part de l’émetteur.
La question est de savoir dans quelle proportion. Cela dépend de la conjoncture économique, certes, mais aussi et surtout de la situation financière, des objectifs de placement et de la tolérance au risque de l’investisseur. Une analyse détaillée par un professionnel du domaine, comme un conseiller des Fonds FMOQ, permettra de préciser les pondérations à attribuer à chacun des types de placement dans le portefeuille du particulier.
1 https://www.fondsfmoq.com/fonds_fmoq/pdf/feuillet_rendements_internet.pdf
2 Semestriellement, règle générale.
Dans l’édition de mai 2000 de la revue Le Médecin du Québec, nous avions abordé le calcul du rendement d’un fonds, une opération qui est régie par la Norme canadienne 81-102 Les organismes de placement collectif (NC 81-102) selon laquelle le rendement doit être net de tous les frais payables par tous les détenteurs du fonds. Ce rendement ne tient cependant pas compte de frais payables par quelques porteurs, comme les commissions de vente ou les frais de sortie1. Le résultat obtenu représente précisément ce qu’aurait obtenu un participant qui aurait investi au début de la période puis réinvesti, sous forme de parts additionnelles au moment de leur versement, tous les revenus et gains en capital reçus, et ce, sans rien ajouter ni retirer à son investissement initial.
Qu’en est-il maintenant de vos rendements personnalisés qui sont inscrits sur vos relevés de placement?
Depuis plusieurs années, la Société de gérance des Fonds FMOQ inc. utilise la méthode de calcul de rendement pondéré en fonction du temps qui repose sur la formule de liaison de la méthode Dietz modifiée. Ainsi, les rendements qui figurent sur vos relevés trimestriels tiennent compte des apports et des retraits d’argent effectués pendant la période concernée.
Pour établir les rendements personnalisés, notre système calcule les rendements tous les mois. S’il y a eu un flux monétaire (c.-à-d. un dépôt ou un retrait) durant le mois, un facteur de pondération est déterminé afin de tenir compte de la portion du mois qui a été affectée par le dépôt ou le retrait2. Une fois les rendements mensuels connus, il ne reste plus qu’à lier les rendements des 12 mois de l’année pour obtenir le rendement annuel3. Pour les périodes de plus d’un (1) an, les rendements de chacune des années sont liés, et le tout est soigneusement annualisé4.
Bien que cette méthode de calcul soit la plus couramment utilisée, il faut noter qu’un dépôt ou un retrait important, surtout en fin de période, peut fausser le rendement calculé en regard du rendement réellement obtenu en considérant les montants en dollars.
Exemple
En janvier, un client ouvre un nouveau compte avec un investissement de 100 $. Au cours des 11 mois suivants, son investissement croît de 10 % et vaut donc 110 $, le 1er décembre. Le client décide alors d’ajouter 9 890 $ à son compte qui grimpe à 10 000 $, mais son investissement chute de 1 % au cours du mois de décembre.
La valeur inscrite sur son relevé au 31 décembre sera donc de 9 900 $. En pratique, son relevé affichera un rendement positif de 8,9 %, et ce, même si le client a effectivement perdu 90 $.
Toutefois, tant que les investissements ne sont pas disproportionnés5 en comparaison de la valeur globale du portefeuille, ou qu’il n’y a pas d’écarts de rendement majeurs entre les périodes, cette méthode de calcul fournit de très bons résultats. Il existe d’autres méthodes de calcul du rendement, mais chacune a ses défauts et ses incohérences.
La Société de gérance des Fonds FMOQ inc. a opté pour cette méthode, d’une part, parce qu’elle est celle qui est la plus répandue et qu’elle permet ainsi de meilleures comparaisons et, d’autre part, parce que, pour la très grande majorité des portefeuilles de nos clients, elle représente correctement le rendement obtenu.
Il faut toutefois garder à l’esprit que, peu importe la méthode utilisée, les résultats obtenus ne sont qu’une estimation de rendement, à moins que vous n’ayez effectué aucun retrait ni dépôt dans votre compte.
Pour plus de renseignements sur cette question, ou pour discuter du rendement obtenu dans votre portefeuille, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
1 Les Fonds FMOQ ne comportant pas de commission, il n’y a aucuns frais ni à l’achat, ni à la vente.
2 Formule de la méthode Dietz modifiée
Rendement mensuel = VMF – VMI – F
VMI + FP
OÙ
VMF = Valeur marchande du portefeuille à la fin du mois
VMI = Valeur marchande du portefeuille au début du mois
F = Somme des flux monétaires (dépôts – retraits)
FP = Somme de chaque rentrée ou sortie de fonds Fi multipliée par sa pondération Pi.
Fi = Chaque flux monétaire
Pi = N – Ji
N
OÙ
N = Nombre de jours dans le mois
Ji = Nombre de jours qui se sont écoulés entre le début du mois et de la date du dépôt ou retrait
3 Formule de liaison
Rendement = {[(1+R1 ) x (1+R2 ) x …(1 + Rn )] – 1} x 100
OÙ
R1 = Premier rendement mensuel calculé
R2 = Deuxième rendement mensuel calculé
Rn = Dernier rendement mensuel calculé
4 Formule annualisée
Rendement annualisé = (1 + Rendement obtenu avec formule de liaison) ^(1/ nombre d’années)
5 Dans notre exemple, le 2e investissement était de 90 fois la valeur du compte (9 890 $ contre 110 $).
Compte tenu de l’incertitude mise en évidence par la macroéconomie à l’échelle mondiale, de même que de la complexité d’évaluer la juste valeur marchande d’une entreprise, la lecture de conseils déjà connus ne vous métamorphosera pas en Warren Buffet. Par contre, en prenant de nouveau connaissance de quelques suggestions éprouvées, il est possible de constater que le rééquilibrage systématique demeure une stratégie d’investissement à la portée de tous et, surtout, que sa simplicité n’a d’égale que son efficience.
En quoi le rééquilibrage systématique consiste-t-il?
Dans un premier temps, il faut impérativement déterminer la répartition stratégique des éléments d’actif correspondant le mieux à son profil d’investisseur, c’est-à-dire qui tient compte de l’horizon de placement et du niveau de tolérance au risque. Une fois cette étape préalable franchie, il est possible de décider de la répartition des actions et des titres à revenu fixe au sein du portefeuille de placement.
Prenons l’exemple d’un investisseur pour qui l’idéal est d’avoir un portefeuille composé de 60 % d’actions et de 40 % de titres à revenu fixe. Puisqu’il est acquis que les fluctuations des marchés vont affecter cette répartition initiale, il pourrait tirer profit de cette volatilité et dégager un rendement excédentaire en rééquilibrant son portefeuille de façon à retrouver sa répartition de départ (60 – 40).
En pratique, cela signifie que l’investisseur devra vendre des titres de la classe d’actifs ayant le mieux performé et réinvestir le produit de la vente pour acheter des titres de celle ayant moins bien performé. Autrement dit, il utilisera ses profits dans la classe d’actifs ayant pris de la valeur et «monnayera à la baisse» l’autre classe d’actifs.
De fait, il s’agit de respecter et d’appliquer le principe reconnu selon lequel il faut vendre haut et acheter bas, sans qu’il soit pour autant nécessaire de prévoir l’évolution des marchés.
Fort différent d’un rééquilibrage émotif effectué en fonction de l’humeur de l’investisseur ou de ses perspectives économiques, ce rééquilibrage systématique peut revêtir deux (2) formes :
1. Le rééquilibrage périodique auquel l’investisseur procède à une période prédéterminée, par exemple, une fois l’an et en milieu d’année. Il faut cependant noter que dans des marchés plus volatils et propices à d’importants revirements, certains investisseurs pourraient vouloir privilégier un rééquilibrage plus régulier, chaque trimestre par exemple.
2. Le rééquilibrage ponctuel est effectué uniquement lorsque la répartition du portefeuille dévie suffisamment de la répartition initiale, par exemple lorsque le pourcentage des actions se situe à ± 3 % de cette dernière. Bien qu’il soit impossible de fixer précisément le pourcentage requis pour déclencher le processus de rééquilibrage, il faut savoir que, dans un marché relativement stable et directionnel (à la hausse ou à la baisse), il est plus avantageux de laisser courir une position gagnante ; autrement dit, de tolérer une déviation plus importante que dans un marché volatil sans direction claire.
Un rééquilibrage est-il toujours nécessaire?
L’investisseur qui privilégie principalement des fonds équilibrés n’a pas trop à se soucier du rééquilibrage systématique de son portefeuille.
À titre d’exemple, le Fonds omnibus FMOQ est l’objet de rééquilibrages systématiques en fonction de sa cible de 55 – 45, soit 55 % en actions et 45 % en titres à revenu fixe. Cependant, contrairement au Fonds omnibus FMOQ, le Fonds de placement FMOQ et le Fonds revenu mensuel FMOQ (deux Fonds équilibrés) ne sont pas l’objet de rééquilibrages systématiques. La gestion de la répartition de leurs éléments d’actifs est toutefois confiée à des gestionnaires de portefeuilles qui les rééquilibrent en fonction de certaines balises et de leurs attentes face aux marchés.
Toutefois, si un investisseur détient des éléments d’actifs autres que des parts du Fonds omnibus FMOQ (par exemple, des parts d’autres Fonds communs de placement FMOQ, des titres d’Épargne Placements Québec, des certificats de placement garanti, des actions, des obligations, etc.), et ce, par le biais ou non de notre société, il doit effectuer un rééquilibrage de l’ensemble de son portefeuille.
Un rééquilibrage est-il toujours profitable?
Pas nécessairement, car l’appréciation (plus value) est conditionnelle à un changement de direction des marchés. Cependant, aucune classe d’actifs negrimpe indéfiniment.
Il est important de ne jamais perdre de vue que si un rééquilibrage systématique a certes pour but de dégager un rendement excédentaire, il vise d’abord à assurer l’adéquation de la répartition des éléments d’actifs avec le profil d’investisseur ; en d’autres mots, de contrôler le risque du portefeuille.
Les conseillers de notre société sont à l’entière disposition des investisseurs qui souhaitent bénéficier d’une assistance professionnelle dans l’établissement de leur profil d’investisseur, de leur répartition cible et dans la gestion de celle-ci.
L’été qui vient de prendre fin aura été une source de grande inquiétude pour les investisseurs qui supportent difficilement les trop fortes fluctuations des marchés, surtout lorsque celles-ci semblent vouloir n’emprunter qu’une seule direction, en l’occurrence celle du bas. La saison estivale, qui s’annonçait ensoleillée et réparatrice, a été tout sauf reposante pour les investisseurs qui ont souffert de la même incertitude qui a contaminé et fait sombrer l’ensemble des marchés de la planète.
La Bourse canadienne avait pourtant amorcé l’année de belle façon, en poursuivant sur sa lancée haussière des deux dernières années. Elle a cependant commencé à manifester des signes de faiblesse au printemps. Après avoir atteint un sommet à 14 270 points en avril, l’indice TSX de la Bourse de Toronto s’est soudainement mis à reculer à la suite de plusieurs événements perturbants et de nouvelles négatives.
Il y a d’abord eu le terrible tsunami qui a foudroyé le Japon le 11 mars dernier. Ce raz-de-marée a paralysé sérieusement les activités de la troisième puissance économique mondiale. Celle-ci étant aussi un partenaire commercial et économique majeur des États-Unis, l’activité économique de nos voisins du sud a été affectée du même coup. Dès lors, les experts ont évoqué un possible ralentissement printanier de la laborieuse reprise américaine. Cette éventualité a évidemment eu un impact au Canada, les États-Unis demeurant notre principal partenaire et client commercial.
Outre ces perspectives négatives, il faut se rappeler que le monde entier est aussi devenu le témoin d’un mouvement de libération politique sans précédent dans certains pays du monde arabe.
Un contexte géoéconomique trouble
Après la Tunisie qui s’est rapidement — et somme toute assez pacifiquement — libérée de son dictateur Ben Ali, le Printemps arabe s’est rapidement propagé à d’autres pays de la région. Les populations de l’Égypte, du Bahreïn, du Yémen, de la Libye et de la Syrie, se sont aussi liguées contre leurs dirigeants, provoquant du même coup beaucoup d’incertitude et d’insécurité dans une région stratégique pour le bon fonctionnement de l’économie mondiale, en raison des réserves importantes de pétrole qui s’y trouvent.
Pour couronner le tout, c’est à la fin du printemps dernier que la Grèce s’est de nouveau retrouvée au centre de l’actualité économique mondiale, alors qu’elle devait renégocier un nouvel emprunt important pour financer ses opérations courantes et, par le fait même, assurer sa survie.
En mai 2010, la République hellénique avait réussi à obtenir un financement intérimaire de 110 milliards d’euros auprès des pays membres de la zone euro, de la Banque centrale européenne (BCE) et du Fonds monétaire international (FMI). Cette année, elle a eu besoin d’un financement équivalant à celui de l’année précédente (mai 2010). À défaut d’un tel sauvetage budgétaire, elle se serait retrouvée complètement à sec en septembre, c’est-à-dire sans la trésorerie minimale requise pour pouvoir payer ses fonctionnaires et faire face à ses créanciers.
Les pays membres de la zone euro étant tout un chacun aux prises avec une situation budgétaire extrêmement sensible, leurs dirigeants voulaient à tout prix trouver une solution qui limiterait leur exposition au risque, si jamais la crise de la dette grecque, dont l’acuité n’a d’égale que l’urgence de la régler, devait déboucher de nouveau sur une situation de défaut de paiement.
Cette solution était d’autant plus impérative que plusieurs pays européens, notamment l’Italie, l’Espagne, le Portugal et l’Irlande, ont des profils financiers semblables à celui de la Grèce. Ils font face eux aussi à des déficits budgétaires insoutenables qui ne font que gonfler des dettes publiques colossales. Il fallait certes sauver la Grèce, mais il fallait aussi éviter que l’Europe ne sombre dans l’anarchie financière la plus totale.
Une situation explosive
Les négociations entre les autorités financières européennes, en vue de convenir d’un plan de sauvetage financier de la Grèce, ont largement dominé l’actualité économique tout au long du mois de juillet. Les gouvernements des pays de la zone euro voulaient impliquer les grandes banques commerciales dans ce plan et endiguer les risques de contagion de la crise financière grecque aux autres pays européens vulnérables.
Finalement, à la suite d’un marathon de négociations entre la France et l’Allemagne, les dirigeants de la zone euro ont annoncé, le 22 juillet, la conclusion d’un plan de sauvetage de 109 milliards d’euros pour la Grèce ainsi que la création du Fonds européen de stabilité financière dont le rôle sera de prévenir et de gérer les prochaines crises de dettes souveraines des pays membres de la zone.
Il n’empêche que, tout au long du mois de juillet, le comportement des marchés boursiers a été affecté par cette nouvelle illustration du dysfonctionnement de nombreux pays européens qui peinent à se relever de la crise financière et économique de 2008-2009.
Si le jour de l’annonce de la conclusion du plan de sauvetage financier de la Grèce méritait d’être célébré dignement par la communauté financière internationale, il a été malheureusement assombri par un discours du président des États-Unis. Barack Obama était en effet furieux que le leader républicain de la Chambre des représentants, John Boehner, ait quitté de façon cavalière la table des négociations sur le déplafonnement de la dette publique américaine qui était sur le point d’atteindre le seuil limite des 13 500 milliards de dollars.
Si le Congrès américain, dominé par des élus républicains hostiles au président démocrate, n’acceptait pas que le gouvernement central s’endette au-delà du plafond convenu (13,5 G$ US), tout l’appareil étatique risquait d’être paralysé. Compte tenu d’une possible incapacité du gouvernement américain à emprunter pour payer ses fonctionnaires, ses militaires disséminés partout dans le monde, son propre système de santé publique, ses professeurs, etc., un immense chaos menaçait le plus puissant et le plus « riche » pays de l’univers. Cette crise budgétaire américaine était d’abord et avant tout idéologique, car les républicains s’opposent à toute hausse d’impôt (même pour les milliardaires) et réclament l’abolition de nombreuses dépenses sociales. Elle a d’ailleurs littéralement plombé les marchés boursiers de la fin de juillet jusqu’au début d’août. Finalement, le jour de la date butoir (2 août), un accord bipartite sur le déplafonnement de la dette américaine a été adopté. Malheureusement, c’était trop peu trop tard.
Le psychodrame du surendettement des États-Unis a mis en lumière plusieurs lacunes qui minent la première puissance économique mondiale. Le 5 août, après la fermeture des marchés, la firme de notation de crédit Standard & Poors annonçait qu’elle venait de retirer à l’État fédéral sa note de crédit parfaite (AAA). Cette décote humiliante ne laissait présager rien de bon lors de l’ouverture des marchés boursiers et financiers, le 8 août.
De fait, les marchés ont réagi violemment pendant toute la semaine, la volatilité étant alors à son comble. La solvabilité des États-Unis était remise en question et les risques que le pays ne retombe en récession n’allaient qu’en grandissant.
Après que l’activité manufacturière se soit contractée en juillet, les dépenses à la consommation ont fait de même. L’activité immobilière demeurait anémique et le marché de l’emploi s’avérait incapable d’absorber ne serait-ce qu’une infime partie des 14 millions de chômeurs officiels.
Des marchés qui écopent durement
Il est facile de comprendre qu’un tel contexte hautement anxiogène ait généré beaucoup d’incertitude sur les marchés financiers. Après avoir affiché des rendements de 100 % de mars 2009 à avril 2011, les grands indices boursiers américains ont perdu 20 % de leur valeur entre avril et août 2011.
De son côté, l’indice canadien TSX, qui avait enregistré des gains de 91 % au cours des deux dernières années, avait perdu au 30 septembre 18,5 % de sa valeur en regard de son sommet d’avril. Les marchés nord-américains, tout comme ceux d’Europe et d’Asie, sont officiellement entrés dans une tendance baissière, ayant tous cumulé des pertes de plus de 20 % sur une période continue.
Bien que les marchés boursiers abhorrent l’incertitude, c’est malheureusement la seule chose qui les a alimentés tout au long de l’été. Pour mesurer l’extrême volatilité qui régnait alors, il suffit de se rappeler que l’indice Dow Jones a réalisé un record pendant la semaine du 15 au 19 août, alors qu’il a gagné ou perdu quotidiennement plus de 400 points au cours de quatre (4) séances consécutives. Cette même semaine était également la dernière de quatre successives durant lesquelles l’indice S&P 500 a terminé en baisse. Il s’agissait de la plus longue séquence de correction à la baisse jamais enregistrée par la bourse américaine depuis 1950.
Bref, l’été 2011 en est un à oublier. Souhaitons maintenant que les efforts de plus en plus concertés des divers gouvernements, Banques centrales et autres autorités financières de partout à travers le monde, puissent faire effet et ramener une certaine stabilité au cours des prochains mois.
Investir n’est pas une activité de tout repos. Même lorsque l’on confie cette tâche à des professionnels dont le métier est justement de transiger quotidiennement avec des fluctuations de toutes sortes, on est toujours un peu inquiet lorsque les marchés boursiers cessent soudainement de progresser. L’histoire nous enseigne cependant qu’il ne faut jamais céder à la panique et succomber à la tentation de vendre lorsque les marchés sont en baisse.
Après deux années de rendements somme toute assez généreux, certains investisseurs ont commencé à déchanter lorsque le marché boursier canadien (l’indice de la Bourse de Toronto S&P/TSX) qui a atteint un sommet à 12 470 points au début du mois d’avril, a amorcé un repli qui perdure depuis maintenant plus de trois mois ; un repli qui a eu pour effet d’effacer tous les gains réalisés par l’indice S&P/TSX depuis le début de 2011 mais qui l’a même entraîné en territoire négatif puisque l’indice canadien affichait un rendement de -1,06 %, en date du 30 juin dernier : une contre-performance qui est suffisante pour distiller le doute dans l’esprit des investisseurs nerveux qui attendent le premier signal venu pour revoir de fond en comble la composition de leur portefeuille.
Une stratégie perdante
Vendre ses fonds d’actions canadiennes ou réduire la proportion d’actions dans un portefeuille parce que l’indice S&P/TSX traverse une période de morosité est pourtant la pire des stratégies à suivre. En effet, année après année, de nombreuses études nous rappellent que les investisseurs canadiens ont tendance à mal synchroniser leurs achats et leurs ventes de fonds d’actions. Ils achètent quand les marchés sont à la hausse et ils vendent quand ceux-ci sont à la baisse alors que ce devrait être toujours l’inverse qui se produise, de façon à profiter au maximum de « l’effet de prix ». Ça coûte plus cher quand les prix sont plus élevés et ça vaut moins cher quand les prix baissent et qu’on vend à rabais.
Cette vérité toute simple échappe pourtant à bien des investisseurs qui se laissent dominer par leurs émotions. Quand ils constatent que tout le monde fait de l’argent avec le marché boursier, ils décident de partager cet engouement et d’embarquer dans le marché. Quand ils voient que les valeurs baissent parce que plusieurs investisseurs vendent leurs titres, ils décident de liquider leur portefeuille. Suivre une pareille stratégie à long terme ne peut, au mieux, que procurer un rendement neutre, ce qui n’est pas le but de l’investissement. Chose certaine, si vous êtes de ceux qui ne supportez pas de voir leur portefeuille de placements se déprécier même légèrement, il serait sage et même impératif que vous consultiez votre conseiller avant de prendre la décision de liquider vos fonds, ce qui pourrait s’avérer catastrophique.
Le monde de l’investissement est pavé de phrases telles que « j’aurais donc dû » ou « si j’avais su… ». Plutôt que de regretter une décision prise rapidement, vaut mieux prendre le temps de consulter pour vous assurer qu’il s’agit là de la bonne décision à prendre. Qui sait ? Peut-être que votre conseiller, en vous présentant l’ensemble des éléments à considérer, influencera votre geste et vous évitera de regretter une décision prise trop rapidement. De toute façon, au pire, si vous choisissez de consulter et que la conclusion vous amène à la même décision que celle que vous auriez prise initialement, vous aurez au moins la satisfaction de ne pas avoir agi sur un coup de tête.
Enfin, il convient ici de faire un bref rappel historique pour illustrer combien les marchés boursiers ont cette faculté de récupération qui leur est propre. Ainsi, l’indice S&P 500 (un des principaux indices de la bourse américaine) a connu, au cours des cinquante dernières années, huit corrections majeures qui ont duré, en moyenne, 13 mois et au cours desquelles, l’indice a perdu, en moyenne, 30 % de sa valeur. Pourtant, dans les douze mois qui ont suivi la fin de ces corrections, l’indice S&P 500 a produit des rendements moyens de 29,5 % et de 42,3 % au cours des 24 mois suivants.
Celui qui a tout vendu pendant l’un ou l’autre de ces replis de marché n’a jamais profité des généreux rendements qui ont suivi. « J’aurais donc dû… »
Trois facteurs d’incertitude
Selon l’avis de nombreux spécialistes financiers, l’investisseur québécois aurait doublement tort de succomber à la panique pour vendre ses fonds d’actions canadiennes ou américaines d’autant que le recul que l’on observe depuis quelques mois sur les marchés ne devrait être que temporaire.
Si le marché boursier canadien a interrompu sa progression en avril dernier, après avoir généré des rendements de 27 % en 2009 et de 15 % en 2010, c’est qu’il perçoit certains signes de faiblesse économique qui affectent tous les grands pays industrialisés.
La reprise économique moins rapide que prévue aux États-Unis de même que le niveau d’endettement record du gouvernement américain inquiètent toujours les marchés, tout comme la crise européenne dont on a la fâcheuse tendance à amplifier les côtés dramatiques. Ainsi, bien qu’on estime à 85 % les chances de réussite du plan de sauvetage de la Grèce, on ne fait que focaliser sur les 15 % de risques qu’il échoue. Enfin, les effets du tsunami au Japon se font toujours ressentir sur l’économie mondiale et particulièrement aux États-Unis.
Toujours selon les spécialistes en la matière, ces mêmes facteurs étaient présents en début d’année et n’ont pas empêché les marchés de connaître un bon premier trimestre. Depuis avril, ils ont pris plus d’importance et ont contribué à alimenter la peur « d’avoir peur ».
Un contexte encore très favorable
Il y a quelques mois, la plupart des stratèges des grandes sociétés d’investissement canadiennes anticipaient de très bons rendements pour le marché boursier canadien pour l’ensemble de l’année 2011. Ainsi, on escomptait des rendements se situant entre 9 % et 14 %.
Selon ces professionnels de l’investissement, les bourses canadiennes et américaines sont présentement sous-évaluées. L’indice S&P 500 de la bourse américaine affiche présentement le plus bas ratio cours-bénéfice des 27 dernières années, en se transigeant à 12 fois la valeur des profits des sociétés qui composent l’indice. Pour la bourse canadienne, on parle d’un ratio cours-bénéfice de 13 fois les profits attendus.
Or, historiquement, tant le S&P 500 que le S&P/TSX se transigent à des ratios cours-bénéfice moyens de 17 ou 18 fois les profits escomptés. Si on est loin du compte, c’est que les marchés – et les investisseurs – se laissent distraire par les trois principaux facteurs économiques négatifs que l’on évoquait plus haut, soit : l’endettement massif des États-Unis, la crise européenne et les effets persistants du tsunami au Japon.
Vers un retournement du marché obligataire ?
Il suffirait donc de quelques nouvelles positives dans les prochaines semaines pour que l’on assiste à un ralliement boursier estival, un peu comme celui que l’on a connu l’été dernier, une probabilité qu’il ne faut pas sous-estimer, selon plusieurs analystes.
Il faut rappeler que l’essentiel des rendements produits par les marchés boursiers en 2010 ont été enregistrés durant la seconde partie de l’année.
Par ailleurs, si la crise européenne arrive à se résorber d’elle-même, sans bouleversements majeurs, et si la reprise économique américaine se déploie de façon un peu plus marquée au cours des prochains mois, on pourrait aussi assister à un retournement du marché obligataire qui a encore très bien performé cette année.
Les taux directeurs des banques centrales, qui ont été ramenés à presque 0 % depuis trois ans maintenant, devraient amorcer une remontée prochaine. Le Canada a déjà timidement commencé à hausser son taux d’escompte et les États-Unis vont faire de même dès que les signes de reprise économique seront plus manifestes.
Ces hausses appréhendées des taux d’intérêt vont réduire d’autant les rendements sur les titres obligataires qui ont généré des paiements d’intérêts élevés au cours des dernières années. Il s’agit ici d’un autre facteur qui devrait favoriser, à moyen terme, le marché des actions.
La stratégie de l’étalement
Autre facteur qui devrait donner matière à réflexion à l’investisseur qui songe à quitter le monde des actions pour espérer trouver refuge dans un autre véhicule d’investissement plus sécuritaire, il faut juste rappeler que ce n’est pas la première correction de plus de 5 % que les marchés nord-américains subissent depuis que la reprise boursière s’est amorcée en mars 2009.
Pour la bourse américaine, il s’agit en fait de la 7e correction de plus de 5 % que vient d’enregistrer l’indice S&P 500 depuis mars 2009 et, à chaque fois, l’indice a non seulement repris ce qu’il avait perdu, il a par la suite poursuivi son ascension.
La Bourse de Toronto a subi au cours des deux mêmes dernières années des reculs à peu près équivalents à ceux enregistrés par le S&P 500– quoique de moindre envergure – et a, aussi, toujours repris, par la suite, sa course ascendante.
Devant pareil contexte, l’investisseur qui dispose de liquidités et qui souhaite favoriser le marché des actions aurait avantage à étaler, progressivement ou systématiquement dans le temps, ses investissements. Réintégrer de façon graduelle le marché permet de réduire son exposition aux mouvements de repli boursier comme celui que nous venons tout juste de traverser, tout en s’assurant de pouvoir pleinement profiter de la remontée des titres lorsqu’elle se matérialisera.
Il s’agit sans conteste de la meilleure stratégie à adopter pour faire face à la période de repli que l’on connaît présentement ; une période qui, rappelons-le, devrait être de courte durée selon l’avis de la grande majorité des experts. C’est à tout le moins une stratégie nettement plus gagnante que celle de céder à une panique passagère et de liquider des placements qui ont pourtant encore beaucoup de potentiel d’appréciation à offrir à ceux qui savent rester patients. Pourquoi ne pas en discuter avec votre conseiller ?
Le violent tremblement de terre, le tsunami dévastateur et l’accident nucléaire qui secouent le nord-est du Japon constituent une autre menace qui s’ajoute à une longue liste d’événements susceptibles d’affecter l’économie planétaire. Les conflits au Proche-Orient, l’évolution du prix du pétrole, l’augmentation de l’inflation en Chine, la crise des finances publiques de pays européens, de même que la faiblesse du marché immobilier et de l’emploi aux États-Unis, sont autant de facteurs qui créent de l’incertitude quant à la croissance mondiale.
En ce qui concerne plus particulièrement le Japon, la question la plus préoccupante réside dans la capacité du pays à contrôler la crise nucléaire qui perdure à la suite de la série d’explosions à la centrale de Fukushima. L’économie nippone est la troisième du monde, après celles des États-Unis et de la Chine. Avec un poids d’environ 9,5 % dans l’indice boursier MSCI monde, les actions du Japon en font le deuxième plus important pays après les États-Unis. Il faut rappeler que, depuis de nombreuses années, le marché boursier japonais est aux prises avec des difficultés qui ont eu pour effet de réduire considérablement sa valeur. Non seulement celle-ci est-elle environ 75 % inférieure à son sommet du début de la décennie 1990, mais le début de reprise escompté cette année par les prévisionnistes est possiblement compromis. Le graphique illustre l’évolution du marché boursier japonais depuis l’année 1984.
À la suite de cette catastrophe, le marché japonais a connu une correction de plus de 20 %. Les autres marchés boursiers à travers le monde ont saisi l’occasion pour faire de même, mais dans une moindre mesure. Si, règle générale, des événements
catastrophiques servent de prétexte à une prise de profit mondiale dans un marché haussier et engendrent des occasions d’achat, le spectre d’une tragédie nucléaire majeure est plus difficile à mesurer. Il n’en demeure pas moins que les récents événements qui bouleversent les Japonais ne pouvaient pas survenir à un plus mauvais moment.
La capacité du gouvernement à stimuler l’économie est limitée en raison du niveau très élevé de la dette publique, et il ne dispose d’aucune marge de manœuvre sur le plan monétaire, les taux étant déjà à zéro. De plus, la flambée du yen face au dollar l’a propulsé à un niveau record depuis la Seconde Guerre mondiale, et elle représente un risque sérieux pour la compétitivité des exportations.
Le haut atteint par la monnaie japonaise après le séisme peut paraître surprenant, mais il s’explique par une fièvre spéculative provoquée par le rapatriement de nombreux capitaux requis pour la reconstruction du pays. Économie exportatrice, le Japon aurait indéniablement intérêt à ce que son yen soit plus faible afin de stimuler ses ventes de biens et services à l’étranger. Récemment, le groupe des sept pays les plus industrialisés de la planète, le G7, est intervenu pour combattre la force du yen. De son côté, la Banque du Japon en a injecté plusieurs milliards pour alimenter le système bancaire et tenter de rassurer les marchés. L’appréciation de l’unité monétaire nippone est considérée comme un facteur aggravant de la déflation qui persiste depuis plusieurs années. Rappelons qu’après son sommet boursier de 1990, le Japon a connu une période de 10 ans avec une faible inflation pour ensuite connaître des épisodes de déflation (inflation négative) dans la dernière période de 10 ans. Les taux d’intérêt pour des obligations 10 ans se situent encore aux environs de 1,30 % laissant peu d’alternatives intéressantes aux investisseurs domestique japonais. Selon plusieurs analystes, la reconstruction du Japon fera grimper la demande de matières premières. Le pays est le troisième plus important consommateur mondial de produits de base, après la Chine et les États-Unis. La situation actuelle pourrait être également propice aux sources énergétiques plus sécuritaires, car nombre de pays seront vraisemblablement portés à remettre en question leurs projets de développement de l’énergie nucléaire.
Des études indiquent qu’en général, les perturbations économiques provoquées par des catastrophes naturelles et des événements géopolitiques ne s’avèrent pas néfastes à long terme pour les bourses. Les tremblements de terre, par exemple, sont des événements dont l’ampleur des dommages est, de manière générale, évaluée assez rapidement. Les opérations de nettoyage et de reconstruction qui suivent un désastre naturel de ce type exigent des capitaux importants. En conséquence, il est possible que cette malheureuse catastrophe ait, dans une certaine mesure, des répercussions positives sur la croissance mondiale, si les autorités japonaises parviennent à parer la menace nucléaire.
Trois de nos Fonds FMOQ sont faiblement exposés au marché japonais. Il s’agit du Fonds omnibus FMOQ (2 %), du Fonds de placement FMOQ (1 %) et du Fonds actions internationales FMOQ (8 %). Il faut noter que le pourcentage d’actions nippones a été effectivement réduit au cours des dernières années afin de faire place à celles de pays émergents, les titres de ces derniers étant plus susceptibles de s’apprécier en raison de la performance impressionnante de ces pays en croissance rapide ou nouvellement industrialisés. Il faut aussi préciser que Fiera Sceptre, l’équipe responsable de la gestion active du Fonds actions internationales FMOQ, a choisi de peu investir l’actif du portefeuille de ce dernier au Japon. Elle a surtout privilégié les titres de quelques sociétés nippones axées sur les exportations, plutôt que de détenir des titres d’entreprises locales qui sont sans nul doute sérieusement ébranlées par la calamité qui s’abat sur le pays du soleil levant.
En terminant, nous réitérons qu’il est avantageux d’investir dans des Fonds, car la diversification qui les caractérise permet de réduire les risques inhérents à divers types d’événements, comme ceux qui, malheureusement, viennent de frapper de plein fouet le Japon.

Comme vous le savez, les taux d’intérêt ont beaucoup baissé depuis quelques années. De fait, la tendance baissière remonte au début des années 1980 (voir graphique 1), alors que la plupart des gens devaient payer probablement un taux hypothécaire avoisinant les 15 %. À cette époque, il était également possible d’investir sans risque dans un certificat de placement garanti (CPG) portant intérêt au taux de 13 %.
Ce temps est révolu et bien que les taux d’intérêt soient encore à des niveaux historiquement bas, les économistes ne prévoient pas de hausse fulgurante au cours de la prochaine année. Les banques centrales ont baissé leurs taux directeurs jusqu’à 0 % pendant la crise financière de 2008 – 2009 afin d’insuffler un peu d’oxygène dans leurs économies respectives, mais la reprise économique en cours ne justifie pas encore le retrait complet de ces politiques monétaires stimulatrices. Toutefois, le moment s’avère particulièrement propice pour évaluer l’impact qu’auront les hausses de taux sur vos différents placements.
LES FONDS MONÉTAIRES
Les fonds monétaires rapportent actuellement environ 1,30 %, excluant les frais de gestion. Puisque ceux du Fonds monétaire FMOQ sont de 0,42 %, son rendement net avoisine 0,90 % par année. Ce taux suivra de très près les hausses qui seront décrétées par la Banque du Canada dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. En conséquence, les hausses de taux seront favorables pour le Fonds monétaire FMOQ.
LES FONDS D’OBLIGATIONS
Contrairement aux fonds monétaires, les fonds d’obligations ont été les grands bénéficiaires des baisses de taux. Rappelons que le rendement d’un fonds d’obligations est basé sur deux (2) éléments : 1) le coupon (l’intérêt) de l’obligation et 2) l’appréciation de la valeur marchande de celle-ci, lorsque les taux d’intérêt sont à la baisse. La situation est problématique lorsque ces derniers sont à des niveaux planchers : 1) le coupon est alors très faible et 2) la valeur marchande de l’obligation baissera lorsque les taux commenceront à monter.
Puisqu’un fonds de ce type diversifie généralement les échéances de ses obligations (de 1 à 30 ans), ce ne sont pas tant les variations de taux à court terme de la Banque du Canada qui affecteront la valeur des obligations que 1) les expectatives des marchés à moyen et à long terme sur la croissance économique à venir et que 2) des pressions inflationnistes possibles au cours des prochaines années. Les gestes du gouverneur de la Banque du Canada, certes, mais surtout ses discours, auront tout de même un impact sur la courbe des taux.
Plus une obligation est à long terme, plus sa valeur est sensible aux variations des taux d’intérêt. L’indice qui sert de repère aux fonds d’obligations est le DEX Univers. Sa durée* moyenne est de six (6) ans. Sans trop entrer dans les détails, sachez que la durée d’une obligation ou la durée moyenne d’un fonds d’obligations nous permet de mesurer l’impact d’une variation de taux d’intérêt sur la valeur marchande de l’obligation ou du fonds. Pour un fonds dont la durée est de six (6) ans, comme le Fonds obligations canadiennes FMOQ, une hausse de taux de 0,5 % sur toutes les échéances se traduirait par une baisse du Fonds de 3 %, une hausse de 1 % par une baisse de 6 %, et ainsi de suite. Pour obtenir le rendement du Fonds, il faudrait y ajouter le coupon (environ 3,5 % présentement) et en soustraire les frais de gestion (1 %). Une hausse généralisée des taux de 1 % entraînerait donc un rendement de – 3,5 % (3,5 % – 6 % – 1 %). En conséquence, les hausses de taux seront défavorables à court terme pour ce Fonds. Nous parlons bel et bien de court terme, car après la période d’ajustement à la hausse des taux, les fonds d’obligations pourront générer des rendements plus élevés. Si les investisseurs ayant un horizon de placement à court terme doivent se méfier de ces fonds, la situation est beaucoup moins délicate pour ceux qui investissent à long terme, c’est-à-dire sur un horizon de plus de cinq (5) ans.
LES FONDS ÉQUILIBRÉS
Puisque les fonds équilibrés détiennent à la fois des actions, des obligations et des titres de marché monétaire, il faut creuser un peu pour connaître la vulnérabilité des ces fonds face aux hausses possibles de taux.
Le Fonds omnibus FMOQ
Ce Fonds est régulièrement rééquilibré afin de détenir 55 % d’actions et 45 % de titres à revenu fixe. Dans un environnement normal, ceux-ci sont composés de 3 % de marché monétaire et de 42 % de Fonds obligations canadiennes FMOQ. Suite aux baisses de taux et pour réduire l’impact d’une hausse de taux sur ce dernier, il détient plutôt actuellement 10 % de marché monétaire et 35 % de fonds d’obligations. Ainsi, le Fonds omnibus FMOQ est moins sensible aux variations de taux d’intérêt qu’en temps normal.
Le Fonds de placement FMOQ
La répartition d’actifs de ce Fonds varie en fonction des perspectives de ses gestionnaires. Sa proportion de titres à revenu fixe peut fluctuer de 25 à 45 %. Afin de se prémunir contre une hausse de taux, le gestionnaire peut aussi favoriser les titres de marché monétaire, et ce, au détriment des obligations. Actuellement, seulement 25 % du Fonds est en obligations et 5 % en titres de marché monétaire. Conséquemment, le Fonds de placement FMOQ sera très peu affecté par une hausse généralisée des taux et le gestionnaire aura la possibilité d’ajuster la répartition du Fonds pour profiter des occasions qui se présenteront.
Le Fonds revenu mensuel FMOQ
Dans un contexte de hausse de taux, ce Fonds pourrait être plus affecté que les deux autres Fonds diversifiés, car il investit dans des actions à dividende élevé, des actions privilégiées, des obligations ainsi que des titres de marché monétaire. La demande pour les actions à dividende élevé est forte lorsque les taux d’intérêt sont bas, mais il n’est pas exclu que ces titres subissent la « concurrence » de placements plus conservateurs tels que les CPG ou les obligations, si jamais leurs taux d’intérêt étaient bonifiés.
Pour tenir compte de ce contexte, le gestionnaire du Fonds revenu mensuel FMOQ sous-pondère actuellement ses investissements qui sont plus sensibles aux hausses de taux (en l’occurrence les obligations à long terme et les actions privilégiées) et surpondère les placements à court terme ainsi que les actions ordinaires versant un dividende susceptible de s’apprécier au cours des prochaines années. Ainsi, le Fonds revenu mensuel FMOQ serait affecté négativement advenant un ajustement abrupt des taux à la hausse, mais il se tirerait très bien d’affaire si les hausses de taux étaient graduelles et modérées.
CONCLUSION
Il vous faudra tenir compte de ces différents points lorsque vous procéderez à vos prochains investissements. Qu’ils soient effectués dans votre REER, dans votre CELI, ou tout simplement dans des placements non enregistrés, il est important de savoir que les hausses de taux n’affecteront pas tous les placements de la même façon. Il vous appartient d’en tirer parti lors de vos prochaines cotisations.
En terminant, nous vous invitons à jeter un coup d’œil au graphique 2 qui remonte jusqu’à 1935. Tout comme le graphique 1, il présente le rendement à l’échéance d’une série représentative d’obligations canadiennes de plus de 10 ans. Les taux ont beaucoup baissé depuis 1980, mais vous remarquerez que les taux obligataires ont déjà été plus bas. En effet, de 1935 à 1955, soit après la Grande Dépression de 1929, les taux se sont maintenus à des niveaux inférieurs à ceux qui prévalent actuellement. À bien y penser, étant donné la sévérité de la crise financière de 2008 et même si la Banque du Canada recommence à monter timidement son taux directeur, peut-être que les taux obligataires à moyen et long terme ne sont pas prêts à remonter de sitôt.
Comme d’habitude, n’hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller afin d’approfondir cet important sujet.

* La durée représente l’échéance moyenne des obligations en tenant compte des coupons qui seront perçus avant l’échéance.
Depuis quelques années, les baisses des taux d’intérêt incitent nombre d’investisseurs à se mettre à la recherche de revenus intéressants. Or, le Fonds revenu mensuel FMOQ, qui a été conçu pour répondre à cette attente, affiche des résultats suffisamment convaincants pour que tout investisseur, peu importe son àge, lui fasse une place de choix dans son portefeuille.
En octobre 2006, nous avons confié la gestion du Fonds revenu mensuel FMOQ aux gestionnaires de Fiera Capital (maintenant Fiera Sceptre) qui étaient regroupés dans cinq équipes distinctes focalisant sur les obligations, sur les actions privilégiées, sur les actions à dividendes, sur les fiducies de revenu ainsi que sur la répartition des actifs. En raison des changements législatifs qui affecteront les fiducies de revenu à compter de janvier 2011, les deux équipes mandatées pour les actions à dividendes et les fiducies de revenu ont été jumelées en une seule chargée des actions à revenu élevé (voir le tableau 1).
Depuis son lancement, le Fonds revenu mensuel FMOQ remporte un succès indéniable et pour cause. En effet, en dépit des soubresauts des marchés, il enregistre un rendement plus qu’intéressant (voir le tableau 2), tout en performant mieux que la très grande majorité des autres fonds à revenu mensuel disponibles (voir le tableau 3). Au 24 septembre 2010, son actif totalisait 82,7 millions $.
Il faut rappeler que ce Fonds ne s’adresse pas uniquement aux personnes retraitées qui doivent décaisser une partie de leurs investissements. Il est vrai que sa distribution de revenu mensuelle, fixée à 0,40$ par part depuis 2006, s’avère attrayante pour ceux qui désirent encaisser régulièrement les revenus générés par leurs investissements. Qui plus est, depuis plusieurs années, la recherche de dividendes élevés est aussi une stratégie de placement intéressante. En effet, à long terme, environ 40 % du rendement total des actions provient des dividendes, et ce pourcentage est encore plus élevé en période de faible rendement boursier. De fait, au fil des ans, les sociétés qui ont pu récompenser leurs actionnaires en augmentant graduellement et systématiquement leurs dividendes, se sont généralement avérées très payantes.
En pratique, le rendement du Fonds revenu mensuel FMOQ est majoritairement composé de dividendes et de gains en capital, une caractéristique qui le rend encore plus attrayant pour des placements dans des régimes non enregistrés. En effet, sur le plan fiscal, il est possible de profiter du crédit d’impôt pour dividendes et du taux d’inclusion de 50 % des gains en capital. Il est également possible d’ajouter ce Fonds à un CELI. Cette option permet de toucher les distributions sans impôt, même lors du décaissement.
Bien entendu, le Fonds peut faire partie de régimes enregistrés (REER, FERR, REEE, REEI, etc.), et ce, pour une raison de diversification, compte tenu de ses différences avec le Fonds omnibus FMOQ et le Fonds de placement FMOQ. Alors que le Fonds revenu mensuel FMOQ est entièrement investi en titres canadiens, les deux autres détiennent des actions aux états-Unis, en Europe, en Asie et dans les pays émergents ; en conséquence, le Fonds revenu mensuel FMOQ ne comporte aucun risque de devise. Bien qu’à long terme, cette stratégie puisse sembler restrictive pour le Fonds revenu mensuel FMOQ, elle ne lui a pas nui depuis son lancement, bien au contraire. De plus, le Fonds revenu mensuel FMOQ est le seul de la famille à détenir des actions privilégiées, des titres que l’on peut considérer comme des hybrides entre les actions ordinaires et les obligations. Les sociétés financières sont de loin les plus grandes émettrices d’actions privilégiées.
La dernière différence notable entre le Fonds revenu mensuel FMOQ et les deux autres réside dans le fait que le gestionnaire investit seulement dans des actions versant de bons dividendes, une « contrainte » à laquelle ne sont pas assujettis le Fonds omnibus FMOQ et le Fonds de placement FMOQ.
Il est à souhaiter que la croissance impressionnante du Fonds revenu mensuel FMOQ perdure et qu’il trouve sa place au sein des portefeuilles de placement, à côté du Fonds omnibus FMOQ et du Fonds de placement FMOQ.
N’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller afin de voir comment cet incontournable pourrait s’intégrer à votre portefeuille.
Fonds revenu mensuel FMOQ
Tableau 1 Répartition au 24 septembre 2010
|
Marge de manoeuvre
Répartition des actifs |
|
Min. |
Cible |
Max. |
| Court terme et obligations canadiennes |
20 % |
30 % |
40 % |
| Actions canadiennes |
10 % |
15 % |
20 % |
| Actions canadiennes à revenu élevé |
35 % |
55 % |
65 % |
Tableau 2 – Rendements au 24 septembre 2010
| Année à jour |
1 an |
2 ans |
3 ans |
| 8,90 |
13,85 |
7,62 |
3,53 |
Tableau 3 – Enquête AON sur les divers fonds canadiens 1, 2
|
1 an |
2 ans |
3 ans |
| Quartiles |
1er |
1er |
1er |
1. Comparaison des 50 fonds de revenu mensuel disponibles au Canada
2. Au 31 août 2010 (plus récente information disponible)
Certains médecins s’interrogent encore au sujet des avantages d’exercer leur profession dans le cadre d’une société par actions (SPA). Pourtant, l’incorporation des professionnels est un dossier qui remonte à une quinzaine d’années, alors que les comptables agréés ont été les premiers à se voir reconnaître le droit de pratiquer en cabinet constitué en compagnie. Or, s’il y a des professionnels qui sont particulièrement bien placés pour apprécier les avantages d’une telle pratique, ce sont bien ceux de la lignée de Luca Pacioli, à qui l’on attribue la paternité du premier livre publié sur la comptabilité…
Pour un médecin, le principal avantage de l’incorporation réside assurément dans la réduction de sa charge fiscale qui peut se matérialiser :
a) en reportant l’impôt (sur les sommes laissées dans la SPA) autrement payable sur le revenu de profession qui n’est pas utilisé pour les besoins financiers de la vie courante ; ou
b) en fractionnant les revenus avec des membres de sa famille qui feront partie de l’actionnariat et dont la charge fiscale sera faible ou nulle.
De fait, la situation financière et familiale du médecin revêt une grande importance dans sa décision d’utiliser ou non une SPA dans le cadre de sa pratique professionnelle. Chaque cas devrait faire l’objet d’une analyse appropriée.
Prenons l’exemple d’un omnipraticien dont les revenus professionnels nets sont de 180 000 $1 et dont le coût de vie personnel assumé se chiffre à 65 000 $.
Situation actuelle (sans SPA)
| Revenus imposables |
180 000 $ |
| Contribution REER |
(22 000 $) |
| Impôt à payer + charges sociales2 |
(65 700 $) |
| Montant disponible |
93 300 $ |
| Coût de vie personnel |
(65 000 $) |
| Surplus (épargne) |
28 300 $ |
1 Ce qui suppose des revenus bruts d’environ 220 000 $ et des dépensesd’affaires de 40 000$.
2 Régie des rentes du Québec (RRQ) – Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) – Fonds des services de santé (FSS).
Situation avec SPA
| Situation de la SPA |
|
| Revenus professionnels après dépenses |
180 000 $ |
| Salaire versé au médecin |
(123 000 $) |
| Charges sociales (part de l’employeur) |
(5 900 $) |
| Revenus imposables pour la SPA |
51 100$ |
| Impôt à payer |
(9 700 $) |
| Montant disponible dans la SPA pour investissement |
41 400 $ |
| Situation de l’actionnaire |
|
| Salaire reçu de la SPA par le médecin |
123 000 $ |
| Contribution REER |
(22 000 $) |
| Impôt à payer + charges sociales (part de l’employé) |
(35 400 $) |
| Montant disponible |
65 600 $ |
| Coût de vie |
(65 000 $) |
| Surplus |
600 $ |
Calcul de l’épargne potentielle accumulée sur un (1) an
|
Avec une SPA |
Sans SPA |
Avantage en faveur de la SPA |
| Contribution REER |
22 000 $ |
22 000 $ |
|
| Épargne personnelle |
600 $ |
28 300 $ |
|
| Épargne dans la SPA |
41 400 $ |
|
|
| Total |
64 000 $ |
50 300 $ |
13 700 $ |
Le montant de 41 400 $ laissé dans la SPA représente un report d’impôt. En effet, au moment du retrait de cette somme, un impôt devra être payé par le particulier, et ce,
à un taux d’imposition généralement moindre. Dans le cas présent, on comprend que ce montant n’est pas requis pour assumer les dépenses courantes actuelles.
D’autre part, si le fractionnement des revenus est possible avec les membres de la famille dont le taux d’imposition est faible ou nul, il est possible d’en tirer profit.
Par exemple, en versant le montant de 41 400 $ (impôt et contribution au FSS estimés à 2 750 $) sous forme de dividende à un conjoint ou à un enfant majeur qui n’a aucun autre revenu. Contrairement à un salaire, un dividende versé à un actionnaire n’a pas à être justifié au niveau fiscal.
Cette façon de faire aurait pour effet d’augmenter le montant disponible pour la famille de 10 950 $ (soit 13 700 $ – 2 750 $) dans l’année courante et de créer un avantage immédiat.
Dans notre exemple, le médecin continue de contribuer au REER et d’accumuler des gains au RRQ. En incorporant sa pratique médicale, il ajoute la possibilité de reporter l’impôt sur des sommes non requises pour son coût de vie annuel ou encore de l’augmenter par le principe du fractionnement des revenus avec des membres de sa famille, le cas échéant.
Autres éléments
Une incorporation entraîne une administration supplémentaire (par exemple, une comptabilité liée à la préparation des états financiers, la production de documents fiscaux et les déclarations de revenus).
Il faut également considérer les frais de constitution à payer au moment de l’incorporation, lesquels varient selon la structure et la complexité de la SPA (c’est-à-dire avec ou sans fiducie familiale).
Bien que certaines économies ne soient pas suffisantes pour justifier l’incorporation, elles méritent d’être prises en considération. Par exemple :
- le paiement des primes d’assurance sur la vie du médecin effectué par la SPA (bien que non déductibles, il en coûte ainsi moins cher) ;
- l’acquisition d’équipements ou le paiement de dépenses d’affaires déductibles ou non, tels que les frais de repas, de représentation ou d’adhésion à un club ;
- l’utilisation de la voiture aux fins d’affaires, généralement selon une allocation au kilomètre déductible pour la SPA et non imposable pour l’actionnaire ;
- la prestation consécutive au décès d’un actionnaire dirigeant de 10 000 $ non imposable pour la succession ;
- l’inapplication des restrictions sur les dépenses de bureau à domicile.
Force est de constater qu’il est faux de prétendre que toutes les dettes doivent être payées ou encore qu’il faille laisser une somme substantielle dans la SPA pour rendre l’incorporation rentable. De telles affirmations sont erronées parce qu’elles restreignent les avantages de l’incorporation à une simple question d’impôt différé et omettent de prendre en considé-ration d’autres aspects favorables, comme le fractionnement de revenus ou la présence de placements non enregistrés.
De fait, la décision d’incorporer votre pratique médicale doit être fondée sur une connaissance de vos besoins financiers actuels et des possibilités inhérentes à votre situation familiale, d’où l’importance d’effectuer une évaluation spécifique à votre situation.
Autre considération – le choix du mode de rémunération
Une fois incorporé, l’actionnaire dirigeant doit s’interroger sur la combinaison optimale (salaire et/ou dividendes) pour assumer ses dépenses courantes annuelles.
Dans certains cas, le médecin se versera un salaire afin d’effectuer, entre autres, des contributions à son REER et de cotiser au Régime des rentes du Québec (RRQ). Le surplus disponible après impôt sera conservé par la SPA ; au besoin, il sera versé sous forme de dividendes à l’actionnaire.
Le paiement d’un salaire oblige le versement de charges sociales (RRQ, RQAP, FSS, part de l’employeur et part de l’employé), alors que le versement de dividendes implique un renoncement de cotisation au REER et à la valeur de la cotisation au RRQ3. Toutefois, il faut préciser que dans cette dernière situation, les charges sociales à payer sont inexistantes.
Reprenons l’exemple précédent et supposons qu’il y ait versement d’un salaire ou de dividendes pour assumer des dépenses courantes de 65 000 $.
Situation de la SPA
|
Avec salaire |
Avec dividendes |
| Revenu de la SPA |
180 000 $ |
180 000 $ |
| Salaire versé |
(123 000 $) |
s.o. |
| Charges sociales4 |
(5 900 $) |
0 $ |
| Revenu imposable |
51 100 $ |
180 000 $ |
| Impôt5 |
(9 700 $) |
(34 200 $) |
| Montant disponible |
41 400 $ |
145 800 $ |
| Dividendes versés |
0 $ |
(80 000 $) |
| Surplus laissé dans la SPA |
41 400 $ |
65 800 $ |
3 L’accumulation des gains au RRQ devra être prise en compte pour déterminer la valeur d’une contribution au RRQ, laquelle est de 4 326 $ par employé et employeur en 2010.
4 Part de l’employeur pour le RRQ et le RQAP, et 2,7 % du salaire versé au FSS.
5 Le taux d’impôt est de 19 % (11 % au fédéral et 8 % au provincial) sur les premiers 500 000 $ de revenus actifs annuellement.
Situation de l’actionnaire
|
Avec salaire |
Avec dividendes |
| Revenu personnel |
123 000 $ |
80 000 $ |
| Charges sociales6 |
(2 400 $) |
(500 $) |
| Cotisation REER |
(22 000 $) |
(0 $) |
| Impôt |
(33 000 $) |
(13 400 $) |
| Montant disponible |
65 600 $ |
66 100 $ |
| Coût de vie |
(65 000 $) |
(65 000 $) |
| Surplus budgétaire |
600 $ |
1 100 $ |
6 Part de l’employé pour le RRQ et le RQAP (si un salaire est payé) ainsi que le FSS (si des dividendes sont versés).
En supposant que les dividendes puissent être fractionnés avec les membres de la famille, il serait possible de réaliser des économies supplémentaires.
Par exemple, en versant au médecin et à son conjoint une somme identique de 35 000 $, le montant disponible pour le couple serait de 66 500 $ (après impôt et FSS de 1 750 $ chacun), et le montant laissé dans la SPA serait alors de 75 800 $.
Calcul de l’épargne potentielle accumulée sur un (1) an
|
Avec salaire |
Avec dividendes |
Avec dividendes fractionnés |
| Contribution REER |
22 000 $ |
0 $ |
0 $ |
| Épargne personnelle |
600 $ |
1 100 $ |
1 500 $ |
| Épargne dans la SPA |
41 400 $ |
65 800 $ |
75 800 $ |
| Total |
64 000 $ |
66 900 $ |
77 300 $ |
L’accumulation du capital dans la SPA pourrait servir, lors de la retraite (ou de la préretraite), à couvrir les dépenses courantes, et ce, sans avoir à effectuer des retraits dans les REER, ou encore à payer les études des enfants en leur versant des dividendes dès leur majorité.
Par exemple, l’impôt payable sur le versement d’un dividende de 30 000 $ à un actionnaire n’ayant aucun autre revenu serait de 1 050 $, soit 4 %. En considérant l’impôt de 19 % payé par la SPA, l’impôt combiné serait de 23 %.
Au taux marginal maximum payé, un versement de dividende est imposé à 36,4 %, comparativement à un retrait REER qui, lui, est imposé au taux marginal maximum de 48,2 %, soit un écart favorable de 11,8 % pour les dividendes.
De plus, au plus tard à l’âge de 71 ans, le REER doit être converti en FERR, ce qui nécessite un retrait minimum annuelobligatoire, alors que les sommes accumulées dans la SPA ne sont pas assujetties à une telle contrainte, car elles peuvent y rester tant et aussi longtemps que la SPA existe, et ce, même si le médecin ne pratique plus.
Certains affirment qu’il faut absolument adopter l’approche « salaire » pour pouvoir cotiser au REER et à la RRQ. S’il est vrai que le salaire est nécessaire à la cotisation à ces régimes, il faut aussi savoir que l’actionnaire médecin pourrait décider de ne rien se verser pendant un certain nombre d’années, notamment s’il dispose d’autres revenus ou de placements non enregistrés lui permettant de satisfaire ses besoins financiers. Ainsi, la totalité du montant disponible après impôt pourrait être investie dans la SPA afin d’en reporter le maximum d’impôt.
FACTEURS MILITANT EN FAVEUR DE L’INCORPORATION
1. La présence de placements non enregistrés qui permettent de financer le coût de vie en laissant des sommes plus importantes dans la SPA, ce qui augmente l’avantage de l’impôt différé.
2. Le taux d’imposition moindre de la SPA qui permet d’y investir des montants plus élevés.
3. La création d’une SPA qui s’avère fort intéressante dès que les revenus professionnels après impôt et la contribution au REER excèdent ce dont le médecin a besoin pour vivre.
4. Plus le niveau de vie est bas, plus l’incorporation s’avère avantageuse, car le médecin dispose d’une épargne additionnelle.
5. La possibilité de fractionner le revenu avec des membres de la famille (conjoint, enfant majeur) dont le taux d’imposition est faible ou nul.
6. Le faible taux d’imposition d’un actionnaire dont les revenus sont exclusivement constitués de dividendes.
7. Contrairement au REER qui doit être converti en FERR lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de 71 ans, obligeant ainsi les retraits annuels, il n’y a aucune obligation de conversion ni de retrait dans la SPA.
EN CONCLUSION
Le Service de la planification financière de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. peut vous aider à faire l’analyse de votre situation personnelle. Vous profiterez d’une évaluation personnalisée quant à l’incorporation de votre pratique médicale, ou encore de conseils quant aux stratégies fiscales les plus avantageuses, si vous êtes déjà incorporé. Renseignez-vous sur notre forfait à honoraires fixes (300 $ plus taxes).
| Votre société est déjà constituée ? Bravo ! Vous devez maintenant vous assurer de tirer pleinement bénéfice des avantages que procure votre société constituée aux fins de regrouper les revenus de votre pratique médicale. N’hésitez pas à nous consulter à ce sujet. |
e Fonds omnibus FMOQ, qui vient tout juste de fêter son 30e anniversaire, a été créé par un groupe de médecins omnipraticiens qui souhaitaient offrir à leurs confrères et à leurs consœurs un véhicule de placement abordable, diversifié comme une caisse de retraite doit l’être, et susceptible d’offrir un bon rendement ajusté pour le risque à long terme.
Sans l’ombre d’un doute, le Fonds omnibus FMOQ a livré la marchandise, car il a généré un rendement annuel composé de 9,84 % sur 30 ans (tableau 1), période au cours de laquelle il n’a affiché un rendement négatif qu’à deux occasions, soit en 2002 et 2008 (tableau 2). En pratique, une somme de 1 000 $ investie le 1er janvier 1980 dans le Fonds omnibus FMOQ valait 16 703 $ le 31 décembre 2009.
Force est de constater que les médecins omnipraticiens qui ont choisi ce Fonds pour bâtir leur capital-retraite se sont fort bien tirés d’affaire. Le tableau 3 permet d’apprécier la valeur d’un REER accumulé par un médecin ayant toujours investi le maximum permis annuellement dans le Fonds, et ce, au début de chaque année. Les données tiennent évidemment compte de la limite de cotisation annuelle qui prévalait à l’époque et qui a récemment été haussée de façon plus substantielle. De fait, sur 30 ans, 351 000 $ ont pu être investis dans ce REER et le Fonds omnibus FMOQ a permis de faire croître cette mise de fonds pour atteindre 1 076 100 $.
Bien que la croissance semble avoir été plus forte pendant les années 1980 (tableau 4), il est important de tenir compte de l’inflation dans un tel exercice. Ce faisant, il appert que les années 1990 se sont avérées encore plus enri-chissantes que la décennie précédente, période pendant laquelle l’inflation était beaucoup plus problématique.
Pour ce qui est des 10 premières années du nouveau millénaire, le marché des actions et, dans une moindre mesure, celui des obligations, ont été moins profitables, en raison d’un écart de rendements provoqué essentiellement par les actions étrangères qui ont généré une perte pour la période de 2000 à 2009, alors qu’elles avaient été les « championnes » de la croissance entre 1980 et 1999. Depuis 10 ans, vos cotisations versées dans le Fonds omnibus FMOQ s’élèvent à 165 000 $ et ont progressé pour atteindre 203 912 $. Ce résultat est attribuable à trois facteurs principaux :
1) le rendement : la dernière décennie a permis de dégager un rendement annuel de seulement 4 %, alors que le Fonds omnibus FMOQ avait grimpé en moyenne de 12,89 % par année, de 1979 à 1999 ; les bourses mondiales sortent d’ailleurs de leur pire décennie depuis la Grande dépression des années 30 ;
2) le temps : plus la période observée est longue, plus l’effet des rendements composés prend de l’importance ;
3) la séquence des rendements : le plafond REER ayant beaucoup augmenté dans les dernières années, l’importante baisse de l’année 2008 a affecté une part plus importante du capital accumulé.
Ce dernier facteur devrait d’ailleurs encourager les investisseurs plus jeunes qui ont été déçus, voire découragés par les maigres rendements des 10 dernières années. Une mauvaise décennie (comme celle que nous venons de traverser) est moins pénalisante pour le capital-retraite lorsqu’elle survient en début de carrière, soit pendant la période où le capital détenu est moins élevé. D’où l’importance, pour tout investisseur avisé, de réviser sa stratégie de placement et la répartition des éléments d’actif de son portefeuille au fur et à mesure qu’il approche de la phase de décaissement de son capital-retraite.
Nos conseillers sont les professionnels tout désignés pour faire le point avec vous sur ce sujet, et à la lumière de votre situation personnelle. N’hésitez pas à prendre contact avec eux.
Le Fonds omnibus FMOQ est un Fonds diversifié composé de titres du marché monétaire canadien, d’obligations canadiennes, d’actions canadiennes, d’actions américaines et d’actions étrangères. Ses objectifs de placement sont de procurer un revenu modéré et une appréciation du capital à long terme. Il s’adresse aux investisseurs ayant un horizon de placement de plus de 5 ans, qui recherchent des placements dont le risque se qualifie de moyen.
1) Rendements annuels composés du Fonds omnibus FMOQ au 31 décembre 2009
| 1 an |
16,5 % |
20 ans |
7,7 % |
| 5 ans |
4,1 % |
25 ans |
8,7 % |
| 10 ans |
4,0 % |
30 ans |
9,8 % |
| 15 ans |
7,3 % |
|
|
2) Cotisation REER maximale, rendement du Fonds omnibus FMOQ et taux d’inflation
| Année |
Cotisation maximale |
Rendement |
Taux d’inflation |
| 1980 |
4 500 $ |
22,5 % |
12,2 % |
| 1981 |
4 500 $ |
6,1 % |
11,3 % |
| 1982 |
4 500 $ |
29,0 % |
8,2 % |
| 1983 |
4 500 $ |
14,6 % |
5,5 % |
| 1984 |
4 500 $ |
8,0 % |
3,5 % |
| 1985 |
7 500 $ |
21,5 % |
4,4 % |
| 1986 |
7 500 $ |
11,7 % |
4,0 % |
| 1987 |
7 500 $ |
6,5 % |
4,0 % |
| 1988 |
7 500 $ |
10,3 % |
4,3 % |
| 1989 |
7 500 $ |
13,7 % |
5,5 % |
| 1990 |
7 500 $ |
1,7 % |
6,9 % |
| 1991 |
11 500 $ |
21,9 % |
1,6 % |
| 1992 |
12 500 $ |
4,2 % |
2,0 % |
| 1993 |
12 500 $ |
19,1 % |
1,3 % |
| 1994 |
13 500 $ |
0,0 % |
0,6 % |
| 1995 |
14 500 $ |
17,3 % |
1,6 % |
| 1996 |
13 500 $ |
16,4 % |
2,2 % |
| 1997 |
13 500 $ |
16,1 % |
1,1 % |
| 1998 |
13 500 $ |
9,8 % |
0,7 % |
| 1999 |
13 500 $ |
12,0 % |
2,2 % |
| 2000 |
13 500 $ |
4,1 % |
3,0 % |
| 2001 |
13 500 $ |
2,0 % |
1,4 % |
| 2002 |
13 500 $ |
-8,6 % |
4,5 % |
| 2003 |
14 500 $ |
15,2 % |
1,3 % |
| 2004 |
15 500 $ |
8,3 % |
2,0 % |
| 2005 |
16 500 $ |
10,1 % |
2,8 % |
| 2006 |
18 000 $ |
10,6 % |
1,1 % |
| 2007 |
19 000 $ |
2,1 % |
2,2 % |
| 2008 |
20 000 $ |
-15,6 % |
1,1 % |
| 2009 |
21 000 $ |
16,5 % |
1,9 % |
3) Investissement + gain = valeur totale du REER
| Période |
Montant investi |
Gain |
Valeur du REER |
| 30 ans |
351 000 $ |
725 110 $ |
1 076 110 $ |
| 25 ans |
328 500 $ |
469 650 $ |
798 150 $ |
| 20 ans |
291 000 $ |
273 268 $ |
564 268 $ |
| 15 ans |
233 500 $ |
120 804 $ |
354 304 $ |
| 10 ans |
165 000 $ |
38 912 $ |
203 912 $ |
| 5 ans |
94 500 $ |
8 809 $ |
103 309 $ |
4) Rendements annuels composés par décennie
|
1980-1989 |
1990-1999 |
2000-2009 |
| Actions canadiennes (S&P TSX)* |
12,2 % |
10,6 % |
6,2 % |
| Actions étrangères (MSCI Monde)* |
19,8 % |
14,4 % |
-2,6 % |
| Obligations canadiennes (DEX)* |
13,1 % |
10,1 % |
6,7 % |
| Fonds omnibus FMOQ |
14,2 % |
11,6 % |
4,0 % |
| Inflation (IPC) |
6,3 % |
2,0 % |
2,1 % |
* Rendement de l’indice, avant frais de gestion, en dollars canadiens, incluant le réinvestissement des dividendes.