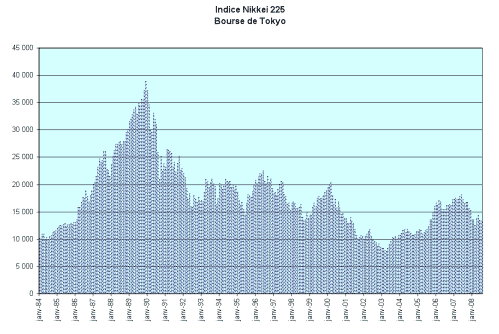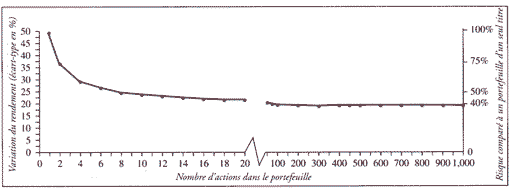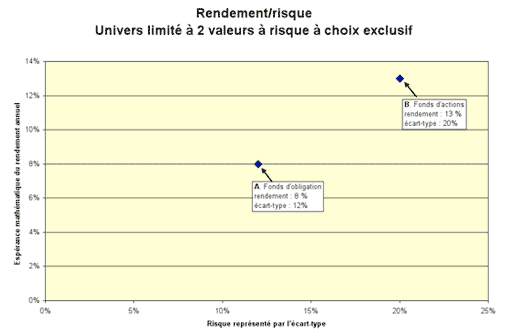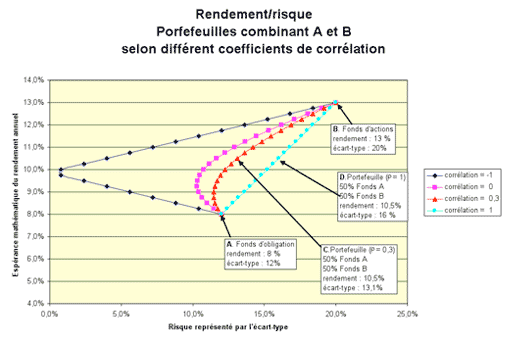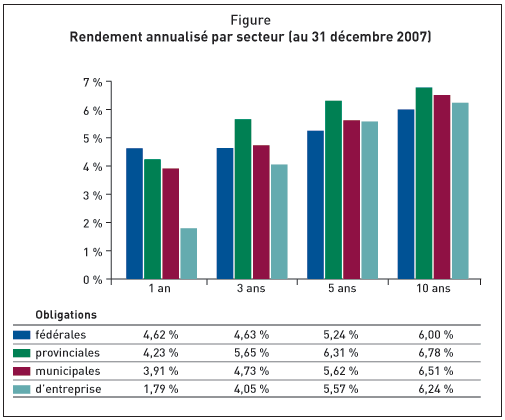Le décès d’une personne résidant au Canada déclenchera généralement un lourd fardeau fiscal qu’il vaut la peine de mieux comprendre afin d’affiner la planification successorale et testamentaire qui permettra d’en réduire l’ampleur au minimum.
De plus, la production de plusieurs déclarations de revenus peut être nécessaire à la suite du décès d’un contribuable.
L’année avant le décès
Tout d’abord il faudra produire la déclaration de revenus pour l’année précédant celle du décès si cela n’avait pas été fait à la date habituelle du 30 avril ou jusqu’à six mois après la date du décès pour les décès survenus après le 1er novembre.
L’année du décès
Cette déclaration de revenus comprendra tous les revenus du 1er janvier à la date du décès et les revenus courus à la date du décès.
La Loi de l’impôt sur le revenu du Canada prévoit aussi une disposition présumée à la juste valeur marchande de tous les biens détenus par la personne décédée l’instant avant son décès. Cela aura pour effet de déclencher des gains et des pertes en capital, de la récupération d’amortissement ou des pertes finales.
La juste valeur marchande des régimes enregistrés (REER, FERR, CRI, FRV) doit aussi être incluse dans les revenus du défunt pour l’année de son décès.
Dans le budget fédéral du 27 janvier 2009, il est proposé de permettre, pour les paiements finaux après l’année 2008, le report rétrospectif des pertes subies au moment de la liquidation d’un REER ou d’un FERR après le décès d’un contribuable à l’encontre des sommes incluses au titre de ces régimes enregistrés dans l’année du décès.
Les soldes à rembourser au REER dans le cadre du Régime d’accession à la propriété (RAP) ou du Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP) seront ajoutés aux revenus à moins que le conjoint survivant choisissent de poursuivre les remboursements.
Les sommes provenant d’un Régime de Pension Agréé ou d’un Régime de Participation Différée aux Bénéfices après le décès ne sont pas imposables pour la personne décédée mais plutôt pour les bénéficiaires qui les reçoivent. Le conjoint survivant pourra toutefois choisir de transférer ces sommes dans son REER ou FERR afin d’en reporter l’imposition.
Cette déclaration de revenus devra être produite à la date habituelle, soit au plus tard le 30 avril de l’année suivante ou au plus tard six mois après le décès lorsque la mort survient entre le 1er novembre et le 31 décembre.
Déclarations distinctes :
Jusqu’à trois déclarations supplémentaires peuvent être produites afin de réduire le fardeau fiscal au décès : pour les droits ou biens, pour le revenu d’une fiducie testamentaire ou pour le revenu d’une entreprise (propriétaire unique ou une société de personnes) dont l’exercice prenait fin à une date différente du 31 décembre.
Les droits ou biens sont des sommes déjà gagnées, mais non encore payées à la date du décès, par exemple des coupons d’intérêts échus et non encaissés, un salaire ou des vacances gagnés mais non versés, des dividendes, des bonis et des commissions déclarés mais non payés ou les travaux en cours d’un membre d’une profession libérale.
Les droits ou biens pourront être imposés de trois façons différentes, selon ce qui est le plus avantageux : au complet dans la déclaration principale, au complet dans une déclaration distincte ou après transfert à un ou plusieurs héritiers qui les ajouteront à leurs revenus.
Les différents soldes fiscaux (report d’impôt minimal de remplacement, pertes en capital, pertes autres qu’en capital, droits REER inutilisés) de la personne décédée devront être pris en compte avant de choisir de produire ou non des déclarations distinctes. Ainsi, les revenus de la déclaration principale de l’année du décès devront être suffisants pour tirer profit de ces soldes au maximum puisqu’ils ne seront plus utilisables par la suite.
Déclaration de la succession :
Tous les revenus gagnés après la date du décès seront ceux de la succession et devront être imposés dans une déclaration de revenus de fiducie 90 jours après la fin d’année choisie (d’un maximum de douze mois).
Il faudra être très prudent dans le choix de la fin d’année fiscale de la succession afin de ne pas nuire aux choix fiscaux par la suite.
Stratégies pour réduire les impôts au minimum en cas de décès
– Lorsqu’une personne meurt avec des droits de cotisation REER inutilisés, la contribution de ces droits au REER du conjoint survivant donnera droit à une déduction dans l’année du décès.
– Si des cotisations REER ont été faites par le défunt dans l’année du décès (avant son décès), elles pourraient être désignées comme remboursement au RAP ou REEP.
– Pour les régimes enregistrés (REER, FERR, CRI, FRV), le transfert en pleine propriété (pas dans une fiducie testamentaire) au conjoint survivant, l’achat d’une rente d’étalement en faveur d’enfants mineurs ou le transfert à un enfant ou petit-enfant à charge souffrant d’une infirmité physique ou mentale permettront de reporter l’impôt à payer.
– Pour les autres biens, il est possible d’utiliser le roulement sans aucun impact fiscal immédiat au conjoint ou à une fiducie testamentaire à son profit. Toutefois il faudra s’assurer d’avoir conservé suffisamment de revenus dans la déclaration du décédé afin de pouvoir absorber tous ses soldes fiscaux à reporter avant d’envisager le roulement. Le même roulement fiscal sera permis pour les biens transférés irrévocablement à une fiducie testamentaire au profit du conjoint, à condition que celui-ci ait droit à l’ensemble des revenus produits annuellement et que personne d’autre que lui n’ait accès au capital avant son décès.
– Le liquidateur de la succession pourra faire le choix, dans un délai prescrit, de reporter des pertes (en capital ou finales) subies par une succession durant sa première année d’imposition pour réduire les gains en capital et les revenus de la personne décédée. Les biens donnés par legs particuliers ne permettant pas un tel choix, il faudra être prudent lors de la rédaction du testament.
– Les frais médicaux des 24 derniers mois (plutôt que ceux des 12 derniers) pourront être réclamés dans la déclaration définitive, dans la déclaration finale, ou dans les deux.
– Les dons de bienfaisance donneront droit à un crédit d’impôt pouvant être appliqué à l’ensemble du revenu net. L’excédent de crédit non utilisé dans l’année du décès est reportable à l’année précédant le décès contre tout le revenu net. Le crédit peut être réclamé dans la déclaration définitive, dans la déclaration finale, ou dans les deux.
– Une somme reçue à titre de prestation consécutive au décès à la suite au décès d’un employé ou d’un ancien employé en reconnaissance des services rendus par celui-ci dans une charge ou un emploi ne sera pas imposable jusqu’à concurrence de 10 000 $.
– Une fiducie testamentaire prévue au testament ne grèvera pas les impôts à payer par le défunt, mais permettra le fractionnement des revenus entre es héritiers, assurera la protection contre la dilapidation rapide des biens légués et vous assurera de conserver les biens à l’intérieur de l’unité familiale à plus long terme.
Les facteurs à considérer dans le choix d’une ou de plusieurs approches
Dans cet article qui conclut la série, il sera question des facteurs sur lesquels on se base pour choisir une ou des approches en matière de gestion de portefeuille. Comme nous le verrons, les facteurs déterminant à cet égard sont a) le degré d’efficience des marchés, et b) la direction générale dans laquelle ils sont engagés.
Le degré d’efficience des marchés financiers
Les spécialistes de la finance débattent depuis déjà quelques décennies d’une hypothèse connue sous le nom de l’efficience des marchés et que l’on peut résumer ainsi : le prix des titres boursiers reflète déjà toute l’information disponible à leur sujet. Cela a donc amené les chercheurs à proposer trois variantes de l’hypothèse du marché efficient (HME) :
- Un marché faiblement efficient en est un où les prix actuels reflètent toute l’information sur le fonctionnement antérieur du marché (historique des cours et des volumes de transaction).
- Un marché semi-faiblement efficient en est un sur lequel les prix du marché reflètent toute l’information déjà publiée au sujet des titres et des entreprises qui les ont émis.
- Un marché fortement efficient en est un où les prix reflètent toute l’information pertinente se rapportant aux entreprises, y incluant celle qui n’est normalement accessible qu’aux initiés (administrateurs, actionnaires importants).
Si l’HME s’avère fondée, quelles en sont les conséquences pour le choix de méthodes d’analyse des titres boursiers ?
- Lorsqu’un marché est efficient à quelque degré que ce soit, on ne peut réaliser de façon consistante des gains en appliquant l’analyse technique, puisque celle-ci se limite à analyser le fonctionnement antérieur du marché;
- Dans un marché faiblement efficient, l’analyse fondamentale peut être utilisée pour exploiter tant l’information déjà publiée que l’information à diffusion restreinte, telle celle à laquelle ont accès les initiés;
- Dans un marché semi-faiblement efficient, l’analyse fondamentale de type descendant qui repose essentiellement sur l’information déjà publiée se révélerait de peu d’utilité, alors qu’une démarche ascendante visant à accéder à de l’information privilégiée rapporterait des dividendes si elle parvenait à ses fins;
- Enfin, dans un marché fortement efficient, l’évolution des prix relève davantage du hasard (random walk), c’est-à-dire que tant l’analyste fondamental que le technicien ne verront pas leurs efforts couronnés de succès. Quelle approche peut-on alors adopter ? On visera à constituer des portefeuilles efficients qui reposeront sur la gestion optimale du rapport rendement/risque du portefeuille dans son ensemble.
Le tableau résume ce que nous pouvons déduire des conséquences de l’HME en ce qui concerne les choix en matière de gestion de portefeuille.
| Efficience du marché |
Méthodes de gestion de portefeuille |
| Degré |
Signification |
Analyse technique |
Analyse fondamentale descendante |
Analyse fondamentale ascendante |
Gestion active |
Gestion passive |
Gestion du rapport rendement risque |
| Nul |
Le cours du marché ne prend en considération aucune information sur le titre |
X |
X |
X |
X |
|
X |
| Faible |
Le cours tient compte de toute l’information sur les transactions passées |
|
X |
X |
X |
|
X |
| Moyen |
Le cours tient compte de toutes l’information publique |
|
|
X |
X |
X |
X |
| Élevé |
Le cours tient compte de toute l’information existante |
|
|
|
|
X |
X |
| X signifie que cette méthode peut être utilisée pour ce degré d’efficience du marché |
|
Enfin, les marchés nord-américains sont-ils efficients ? La plupart des études sur le sujet ont conclu que les marchés nord-américains ne sont pas parfaitement efficients. À la suite de l’implosion de la bulle technologique au printemps 2000 et de la crise de la gouvernance d’entreprise en 2001-2002 qui ont durement secoué les marchés nord-américains, on a dû remettre en question les idées reçues en ce qui a trait au très haut degré d’efficience de ces derniers comparativement à celui des marchés européens et asiatiques (surtout). Malgré ce difficile retour à la réalité, il y a des raisons de croire que les marchés financiers évoluent vers un plus grand degré d’efficience, et ce, pour les raisons suivantes :
- bien que plusieurs événements aient révélé, ces dernières années, que les marchés n’étaient pas parfaitement efficients, ces situations ont été suivies de développements qui ont pour but d’assurer, à l’intention de tous les acteurs du marché, la diffusion la plus rapide possible de toute l’information pertinente;
- La révolution dans les technologies de l’information a, au cours des récentes années, permis que l’information soit accessible à tous les acteurs concernés, au même moment, et ce, à un coût très abordable.
La direction dans laquelle les marchés sont engagés
Le plus souvent, les marchés financiers sont engagés dans une certaine tendance, à la hausse ou à la baisse. Ce type de situation est certainement celui où il est le plus facile de tirer son épingle du jeu. De façon plus épisodique, on reconnaît des marchés qui ne montrent pas de tendance décisive.
Les trois types de marchés
On peut distinguer trois types de marchés :
- le marché haussier (bull market), soit un marché où les valeurs boursières affichent une tendance généralement à la hausse;
- le marché baissier (bear market), soit l’inverse du premier;
- le marché sans direction précise (trading range), dans lequel l’indice oscille à l’intérieur d’un intervalle fixe.
Si on considère l’évolution de l’indice Nikkei 225 de la Bourse de Tokyo (Voir figure 1), on peut observer une période de marché haussier de 1984 jusqu’à 1990. Cette période a vu l’indice passer de 10 000 à 40 000. Elle a été suivie d’un marché baissier de 1990 à 1992. Un autre marché baissier a prévalu de 2000 à 2003, suivi d’un marché à la hausse de 2003 à 2007. Ce graphique illustre également une longue période, de 1992 à 2000, où l’indice a évolué, sans maintenir une direction précise de façon soutenue.
Nos conseillers sont à votre disposition pour recueillir vos commentaires ou répondre à vos questions. N’hésitez pas à prendre contact avec eux.
Figure 1

Lorsque le marché est engagé dans une tendance à la hausse soutenue, la gestion passive donnera des rendements intéressants pour l’investisseur, si le portefeuille est principalement composé d’actions.
Dans le cas d’un marché baissier, la même stratégie peut être appliquée, mais avec une différence importante : le portefeuille devra être composé d’obligations, puisque les marchés baissiers s’accompagnent généralement de taux d’intérêt à la baisse, ce qui fait monter le prix des obligations.
Par contre, la gestion passive donnera des résultats décevants dans les marchés qui n’ont pas de direction précise. La sélection rigoureuse des titres et les ajustements fréquents au portefeuille seront alors de mise pour dégager des rendements intéressants en capitalisant sur les mouvements à court terme des marchés.
Nos conseillers sont à votre disposition pour recueillir vos commentaires ou répondre à vos questions. N’hésitez pas à prendre contact avec eux.
La gestion du rapport rendement-risque
Les deux premiers articles de cette série de quatre ont été publiés en novembre et en février derniers.
Dans cet article, nous présentons une technique qui permet d’évaluer une valeur à risque, par exemple une action, en se basant sur le risque que cette valeur présente et sur le rendement que recherche un investisseur typique en optant pour ce placement spécifique.
Si on compare une action ordinaire avec une obligation, on peut considérer l’action ordinaire comme un titre perpétuel qui produit un revenu courant variable dépendant du succès de l’entreprise. La valeur de l’action peut donc être calculée comme la valeur actuelle de tous les dividendes futurs au taux d’actualisation ou de rendement précisé par l’investisseur.
Myron Gordon, un Canadien, a démontré que cette série peut se réduire à l’expression suivante :

où :
P0 = la valeur de l’action au temps 0, soit au moment où le titre est acquis
D1 = le dividende versé par l’entreprise pour l’année 1
k = le taux d’actualisation retenu ou le taux de rendement visé par l’investisseur
g = le taux de croissance à long terme dans le revenu de dividendes versé.
Le taux d’actualisation du capital ou le rendement recherché par l’investisseur tiendra compte du degré de risque que présente la valeur à l’étude. Plus l’investissement dans les actions d’une entreprise apparaîtra risqué à un moment donné, plus le taux de rendement recherché par l’investisseur devra être important pour compenser ce risque. Pour utiliser la formule de Gordon, le taux de rendement recherché doit être supérieur au taux de croissance du dividende. En fait, lorsque l’investisseur recherche un rendement inférieur au taux de croissance qu’il anticipe à long terme pour le dividende, il est prêt théoriquement à payer tout prix que le marché pourrait exiger pour ce titre, à condition que le dividende initial lui apparaisse acceptable.
Quoiqu’il soit possible d’appliquer simplement la formule de Gordon en formulant des hypothèses réalistes sur les valeurs de k et de g, les gestionnaires de portefeuille disposent d’outils qui permettent d’estimer ces variables de façon plus précise.
Estimation du taux de croissance du dividende.
On peut estimer le taux de croissance futur de la valeur nette d’une entreprise et, par extension, de ses dividendes en multipliant le ratio du rendement sur l’avoir des actionnaires par le taux de réinvestissement des profits, soit :

où :
taux de distribution = la part que le dividende versé représente par rapport au profit par action
Selon cette méthode d’estimation, une entreprise qui opterait pour le réinvestissement complet de ses bénéfices réaliserait, en moyenne, une croissance égale à son rendement sur l’avoir des actionnaires, alors que celle qui redistribuerait entièrement ses profits connaîtrait une croissance nulle.
Estimation du taux de rendement recherché par l’investisseur.
Selon la théorie financière, il est possible d’évaluer le taux de rendement moyen recherché par l’investisseur pour un investissement à risque dans le titre A à l’aide de la formule :

où :
Rsr = le taux de rendement qu’on peut obtenir en investissant dans des valeurs sans risque, par exemple les Bons du trésor ;
A = le coefficient Bêta du titre A, un ratio qui indique la volatilité de ce titre lorsqu’on le compare à l’ensemble du marché, par exemple à l’indice de la Bourse ;
Prime de risque du marché = une valeur qui représente le supplément de rendement que les investisseurs exigent pour les valeurs à risque, telles les actions, par rapport aux obligations gouvernementales
La prime de risque du marché représente le supplément de rendement que demandent, en moyenne, les investisseurs pour investir dans des actions cotées en Bourse. Il s’agit d’un sujet qui fait régulièrement l’objet de recherches chez les théoriciens de la finance. On estime généralement que les primes de risque des marchés nord-américains fluctuent entre 4% et 6%. L’indice bêta de l’investissement A prend la valeur de 1 lorsque son risque est comparable au risque moyen des actions cotées en Bourse; un indice inférieur à 1 dénote un investissement moins risqué que le marché, alors que le contraire se produit s’il est supérieur à 1. On peut consulter des coefficients bêta pour des titres spécifiques sur des sites tels Yahoo!Finance (http://finance.yahoo.com) et argent.canoe (http://argent.canoe.com).
Illustration du calcul de la valeur fondamentale d’une action.
Évaluons les actions ordinaires d’une entreprise fictive, du secteur de la distribution alimentaire au détail, en appliquant la formule de Gordon. Les données à considérer sont :
- Dividende annuel : 0,50$
- Bêta : 0,8
- Taux de croissance de l’entreprise : 8%
- Taux de rendement sans risque : 5%
- Prime de risque du marché : 6%
La formule que nous avons vue précédemment permet de calculer le taux de rendement recherché qui s’établit à 9,8%. La formule de Gordon donnera donc une valeur fondamentale de 27,78$ pour l’action de cette entreprise.

En conclusion, retenons que la valeur d’un titre est fonction de l’évolution prévue du montant du dividende annuel, et du rendement recherché par les investisseurs. Rappelons certains facteurs qui influeront sur ces variables :
- L’évolution de l’économie dans son ensemble, qui touchera la rentabilité de l’entreprise;
- Les perspectives des secteurs industriels dont fait partie une entreprise, soit l’évolution de la demande pour les produits de ces industries;
- La croissance des bénéfices de l’entreprise par rapport à la croissance des versements de dividende;
- Les taux d’intérêt par rapport aux taux de rendement demandés par l’ensemble des épargnants et investisseurs, y compris ceux qui optent pour des actions ordinaires;
Dans cet article, on s’est référé à une valeur unique, telle une action de compagnie. Notez cependant que l’ensemble des notions peut s’appliquer à un portefeuille ou à un fonds d’investissement. On gardera à l’esprit cependant qu’un portefeuille présente l’avantage de faire bénéficier son détenteur d’un meilleur rapport-rendement-risque, lorsque la corrélation entre les valeurs qui le composent n’est pas parfaite, un effet recherché par les gestionnaires de portefeuilles professionnels (référence : article 2 de la série, Pourquoi diversifier le portefeuille de placement).
Nos conseillers sont à votre disposition pour recueillir vos commentaires ou répondre à vos questions. N’hésitez pas à prendre contact avec eux.
Pourquoi diversifier le portefeuille de placement
Le premier article de cette série, publié en novembre dernier, a présenté différentes techniques pour diversifier le portefeuille de placement. Dans ce deuxième article nous traitons de la justification théorique de cette stratégie. Intuitivement, on accepte d’emblée qu’il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors pourquoi, vous demanderez-vous peut-être, est-il utile d’en faire la démonstration théorique ? Les gestionnaires professionnels s’intéressent à cette démonstration parce qu’elle leur permet de mieux comprendre ce qu’est la diversification et ce qui constitue une bonne diversification du portefeuille. Même lorsqu’il n’envisage pas mettre en pratique lui-même les techniques qui découlent de ces connaissances, l’investisseur particulier a tout avantage à en comprendre les principaux fondements.
Combien faut-il de titres différents pour réduire suffisamment le risque ?
Quant il s’agit des valeurs à risque, les spécialistes de la finance font la distinction entre deux types de risque, le risque lié au marché et le risque spécifique. Le risque lié au marché est le risque que le prix de certaines valeurs à risque, par exemple celles de votre portefeuille, fluctuent à hausse ou à la baisse en synchronisme avec la tendance générale des marchés de valeurs de placement. Le risque spécifique, aussi appelé risque non systématique est décrit dans le Dictionnaire de la comptabilité comme «la partie du risque d’un titre qui est spécifiquement attribuable à ce titre et qui, par conséquent, peut être éliminé par la diversification du portefeuille de titres»1. Dans un article célèbre, Meir Statman s’est intéressé à la question de savoir combien de titres devrait contenir un portefeuille pour qu’on observe une réduction appréciable du risque spécifique2. Le résultat de cette recherche est présenté à la figure 1.

1 Ménard L., Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, ICCA, 1994
2 Statman M., How Many Stocks Make a Diversified Portfolio, Journal of Financial and Quantitative Analysis, septembre 1987
Ce que nous dit cette illustration, c’est qu’un portefeuille qui contiendrait 1000 titres à risque choisis au hasard aurait un risque global de 60% inférieur à celui d’un portefeuille composé d’un seul titre. Ce portefeuille n’exposerait alors son détenteur qu’au seul risque lié au marché puisque tout le risque spécifique y aurait été éliminé par la diversification. On y constate également, et c’est là une contribution majeure de Statman, qu’un portefeuille qui ne comporterait que 20 titres représentatifs du marché procure déjà l’essentiel des bénéfices qu’il y à retirer de la diversification du portefeuille de valeurs à risque. Un gestionnaire peut donc réduire de façon très importante le risque du portefeuille sans encourir de coûts d’administration excessifs pour effectuer les analyses et les transactions que cela requiert.
Améliorer le rapport rendement-risque en combinant des valeurs présentant différents degrés de risque
Les travaux de Harry Markovitz, un économiste de l’Université de Californie à qui on a décerné le Nobel d’économie en 1990, ont mené à une découverte majeure : un investisseur peut obtenir un meilleur rendement pour le même niveau de risque s’il détient un portefeuille bien diversifié, soit des titres présentant différents niveaux de risque. Pour illustrer cette affirmation, supposons un investisseur à qui s’offrent 2 choix d’investissements : a) un fonds d’obligation qui procure un rendement moyen de 8 % et un niveau de risque de 12 %, le fonds A, et b) un fonds d’actions dont le rendement moyen est de 13 % et le niveau de risque 20 % , le fonds B.

3 On a mesuré le risque avec l’écart-type, soit la différence moyenne entre le rendement d’une année quelconque et le rendement moyen. Pour le fonds d’obligation, un écart-type de 12 % signifie que les observations de rendement se trouveront entre -4 % et 20 % (8 % ± 12 %) avec une fréquence de 64 %, si on suppose que le rendement suit la distribution normale.
Si on suppose d’abord qu’un investisseur doit absolument choisir un ou l’autre de ces placements, les deux points tracés à la figure 2 représentent les seuls choix qui s’offrent à lui pour gérer le rapport rendement risque. Lorsqu’on introduit la possibilité de choix non-exclusifs, l’investisseur acquiert la possibilité de combiner les fonds A et B, ce qui augmente considérablement son éventail de choix en matière rendement-risque. Par exemple, il peut former un portefeuille contenant des parts égales du fonds A et du fonds B. Un tel portefeuille offre un espérance mathématique de rendement de 10,5 % (50 % de 8 % plus 50 % de 13 %), mais peut-on dire que son niveau de risque est de 16 %, soit la moyenne des taux de risque des deux fonds constituants ? La réponse est que le risque de ce portefeuille sera de 16 % seulement si les rendements des deux fonds sont parfaitement corrélés, ce qui signifie que le coefficient de corrélation (r) des rendements devra être égal à 1. Le coefficient de corrélation peut prendre des valeurs entre -1 et 1. La figure 3 montre l’éventail des choix rendement-risque d’un investisseur qui peut combiner les fonds A et B, selon que le coefficient de corrélation s’établit à -1, 0, 0,3 ou 1.

On observe que pour un coefficient de corrélation de 1, l’éventail des choix est représenté par une ligne droite qui relie A et B, mais que pour les autres valeurs du coefficients de corrélation, l’éventail des choix forme des courbes qui se retrouvent toutes au-dessus de la droite. Cela signifie que les portefeuilles que l’on obtient lorsque la corrélation entre les valeurs à risques est moins que parfaitement positive permettent d’améliorer le rapport rendement-risque, soit d’obtenir un rendement recherché à moindre risque. Par exemple, le point C sur le graphique nous montre un portefeuille formé à parts égales d’unités des fonds A et B, lorsque le coefficient de corrélation correspond à 0,3. Ce portefeuille génère un rendement de 10,5 %, comme le portefeuille D, mais son niveau de risque mesuré par l’écart-type n’est que de 13,1 %. Le cas limite des avantages que confère la diversification est atteint lorsque la corrélation entre les 2 fonds est parfaitement négative (-1). En fait, dans un tel cas, il est théoriquement possible, en dosant adéquatement A et B, de ramener le risque à 0 %.
Les études empiriques ont démontrés que les portefeuilles obtenus aléatoirement en combinant des valeurs de risques différents sont constitués de valeurs faiblement corrélées entre elles. De plus, les gestionnaires de portefeuilles qui veulent améliorer le rapport rendement-risque de leurs portefeuilles mettent un soin particulier à ne pas y inclure trop de valeurs qui présentent un haut degré de corrélation positive entre elles. Cette façon de faire est conforme à ce que les travaux de Markovitz ont révélé sur les avantages de la diversification : un portefeuille bien diversifié, qui inclut un bon éventail de valeurs présentant des degrés de risque différents, permet non seulement de réduire le risque, mais aussi d’obtenir un meilleur rendement pour un même niveau de risque.
Les deux premiers articles de cette série ont traité du comment et du pourquoi de la diversification du portefeuille. Le prochain article, qui sera publié au printemps, présentera une méthode d’évaluation facilitant la gestion du rapport rendement-risque du portefeuille. D’ici là, nos conseillers sont à votre disposition pour recueillir vos commentaires ou répondre à vos questions. N’hésitez pas à prendre contact avec eux.
Bien que le REER ne soit pas une nouveauté, l’allure récente des marchés financiers et les différents changements fiscaux au fil des ans vous amènent peut-être à remettre en question cette stratégie.
Nous tenterons donc de vous éclairer sur certaines des questions les plus fréquentes.
Est-il encore nécessaire de cotiser au REER du conjoint depuis qu’il est permis de fractionner les revenus de pension entre conjoints ?
Depuis l’année d’imposition 2007, les conjoints ont la possibilité de fractionner les revenus de pension dont fait partie la rente d’un REER (par exemple un FERR) dès l’âge de 65 ans. Les conjoints peuvent ainsi choisir d’attribuer jusqu’à 50 % des revenus de pension reçus dans l’année lors de la production de leurs déclarations de revenus et ainsi réduire le fardeau fiscal du couple.
À la lumière de cette nouvelle possibilité de fractionnement de revenu, plusieurs personnes s’interrogent donc sur la pertinence de continuer à faire des cotisations au REER du conjoint, croyant qu’il serait plus simple de faire toutes les contributions dans un seul REER et que le résultat sera le même à la retraite.
Premièrement, il est important de souligner que le fractionnement ne sera possible qu’à compter de 65 ans.
Ensuite, une stratégie n’empêche pas l’autre, même que le fractionnement pourrait être supérieur à 50 % si des cotisations ont été faites au REER du conjoint et que le fractionnement des revenus de pension est utilisé pour profiter davantage d’un taux d’imposition plus faible du conjoint en lui attribuant jusqu’à la moitié des revenus de rente du REER de l’autre conjoint.
Jusqu’à quand pourrez-vous contribuer à un REER ?
Des droits de cotisation vous seront crédités tant que vous aurez un revenu gagné admissible. Il faut toutefois préciser la définition de ce revenu qui ne se limite pas seulement au revenu d’emploi, mais inclut aussi les revenus nets de location ainsi que le revenu net d’entreprise. La somme de ces trois sources de revenus gagnés pour l’année précédente sera multipliée par 18 % et le résultat obtenu (maximum de 20 000 $ pour l’année d’imposition 2008 et de 21 000 $ pour l’année d’imposition 2009) représentera la somme maximale que vous pouvez cotiser pour l’année donnée. Votre avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, reçu à la suite de la production de votre déclaration de revenus fédérale à chaque année, vous fournira le montant exact.
Ainsi, pour autant que vous disposiez de revenus admissibles, vous pourrez faire des contributions à votre REER jusqu’au 31 décembre de l’année où vous atteindrez l’âge de 71 ans. Par la suite, vous pourrez continuer, si vous avez toujours des revenus gagnés admissibles, à contribuer au REER du conjoint qui n’a pas atteint l’âge de 71 ans, tout en continuant de bénéficier de la déduction fiscale.
De plus, chaque contribuable bénéficie d’une marge de manœuvre maximale de 2 000 $. Cela veut dire que cette somme pourrait être versée au REER avant d’en avoir gagné les droits de cotisation. Le revenu ainsi produit sera quand même à l’abri de l’impôt, mais vous devrez attendre d’avoir les droits de cotisation pour le déduire de vos revenus. Attention, toutefois, un impôt spécial de 1 % par mois sera exigé si vos contributions excédentaires dépassent 2 000 $.
Quels avantages y a-t-il à cotiser à un REER ?
Le premier avantage est que vous obtenez une déduction fiscale pour chaque dollar cotisé au REER (le vôtre ou celui de votre conjoint) à condition d’avoir des droits de cotisation au REER, ce qui réduira vos impôts à payer.
Le deuxième avantage est que le rendement des sommes investies dans un REER ne sera pas imposable tant que ces dernières resteront dans le REER, ce qui vous procurera une croissance plus rapide de votre capital puisqu’il ne sera pas grevé d’impôts à payer.
Le troisième avantage probable est que votre taux d’imposition ou celui de votre conjoint, lors des retraits éventuels à la retraite, sera plus faible que celui auquel vous avez obtenu la déduction fiscale.
Il y a donc très peu de situations où une cotisation au REER ne sera pas avantageuse pour un contribuable ayant des revenus moyens ou élevés.
Quand devriez-vous faire votre contribution au REER ?
Vous pouvez effectuer votre contribution à tout moment durant l’année ainsi que dans les 60 premiers jours de l’année suivante afin de bénéficier de la déduction fiscale. La date limite pour l’année d’imposition 2008 est donc fixée au 2 mars 2009.
Si vous disposez de liquidités vous permettant de cotiser à votre REER en tout début d’année, faites-le! Ne vous laissez pas distraire par les aléas des marchés financiers ni par le fait que vous n’avez pas le temps de rencontrer votre conseiller pour faire un choix judicieux. Au besoin, optez pour un type de placement à court terme, du genre marché monétaire, à l’intérieur du REER. Votre investissement croîtra immédiatement à l’abri de l’impôt et vous pourrez, à
votre convenance, transférer cet argent vers une autre option de placement à plus long terme, toujours à l’intérieur du REER.
De plus en plus populaire, la cotisation au REER par versements périodiques permet de répartir la contribution tout au long de l’année et d’investir dans les marchés financiers aux différentes étapes du cycle (à la hausse ou à la baisse). Sans frais et offrant plusieurs possibilités, cette option représente une solution des plus intéressantes.
Quel type de placements convient le mieux au REER ?
La détermination de votre profil d’investisseur, faite à l’aide de votre conseiller, vous indiquera la répartition d’actif à adopter pour votre situation personnelle. Une fois établie, cette stratégie devrait être maintenue malgré les fluctuations des marchés financiers.
Or, si vous possédez à la fois des placements dans des REER et des placements non enregistrés, il serait fiscalement plus avantageux de concentrer vos titres à revenus fixes dans vos REER, car les intérêts produits seront à l’abri de l’impôt.
Est-il mieux de verser 60 000 $ d’un seul coup ou 20 000 $ pendant trois ans ?
Il est possible que vous disposiez de droits de cotisation appréciables au REER, par exemple 60 000 $, si vous n’avez pas toujours cotisé le maximum permis chaque année.
Si c’est votre cas, vous devriez contribuer tout le montant dans la même année afin mettre le rendement à l’abri de l’impôt le plus rapidement possible, à condition que vos liquidités le permettent. Toutefois, vous aurez besoin d’une analyse pour savoir si la pleine déduction sera demandée dans une seule année ou répartie sur plusieurs années, afin que votre déduction vous soit accordée aux plus hauts taux d’imposition plutôt qu’aux plus faibles.
Nous vous invitons à prendre contact avec les conseillers de notre Société dont la rémunération est fixe (sans commission). Vous pourrez ainsi obtenir, gratuitement et sans aucune obligation de votre part, de plus amples renseignements sur le REER et les autres produits et services financiers offerts sur le marché. Conformément à la mission et à la culture de notre Société, nous nous engageons à vous fournir de l’information neutre et objective en tout temps. À vous d’en profiter!
Tout au long de l’année 2008, la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. a publié une chronique financière dans chaque numéro du Médecin du Québec. Nous vous invitons à prendre quelques instants pour répondre aux questions qui suivent. Toutes les réponses ont été données dans un article de notre chronique en cours d’année.
Q : Quel est le montant maximal permis pour une cotisation REER déductible pour l’année d’imposition 2008 ?
a) 18 000 $ b) 19 000 $ c) 20 000 $
R : c) 20 000 $ (janvier 2008)
Q : Depuis quelle année peut-on ajouter à notre REER une somme correspondant à des droits de cotisation REER inutilisés ?
a) depuis 1981 b) depuis 1991 c) depuis 2001
R : b) depuis 1991 (janvier 2008)
Q : Associez les actions suivantes aux entreprises auxquelles elles se rapportent :
a) action de première qualité (blue chips)
b) action cyclique
c) action à croissance rapide |
1) Alimentation Couche-Tard
2) Canadian Tire
3) McDonald |
R : a) avec 3) b) avec 2) c) avec 1) (février 2008)
Q : Dans la sélection de titres d’un portefeuille, quels sont les deux types de gestion de portefeuille ?
a) la gestion active et la gestion passive b) la gestion analytique et la gestion typique
R : a) la gestion et la gestion passive (mars 2008)
Q : Dans la sélection de titres d’un portefeuille, quels sont les deux principaux types d’analyse de portefeuille ?
a) l’analyse programmée et l’analyse suggérée
b) l’analyse fondamentale et l’analyse technique
R : b) l’analyse fondamentale et l’analyse technique (avril 2008)
Q : En pourcentage, quel est le plafond autorisé par les autorités fiscales canadiennes en ce qui a trait aux placements étrangers des véhicules de retraite enregistrés ?
a) 30 % b) aucun plafond depuis 2005
R : b) aucun plafond depuis 2005 (juillet 2008)
Q : Dans le régime enregistré d’épargne-études, quels sont les plafonds de cotisation annuel et viager ?
a) 2 500 $ et 25 000 $ b) 4 000 $ et 50 000 $
R : b) 4 000 $ et 50 000 $ (septembre 2008)
Q : Dans le régime enregistré d’épargne-études, quelle est la subvention maximale offerte par le Canada et par le Québec, selon les cotisations annuelles versées dans un régime ?
- au Canada 20 % des premiers 2 500 $ et au Québec 10 % des premiers 2 500 $
- au Québec 20 % des premiers 2 500 $ et au Canada 10 % des premiers 2 500 $
R : a) au Canada 20 % des premiers 2 500 $ et au Québec 10 % des premiers 2 500 $ (septembre 2008)
Q : Selon les experts financiers, quel pourcentage du revenu net devrait être consacré au loyer (ou au versement hypothécaire, avant taxes et chauffage) ?
a) 25 % b) 35 % c) 40 %
R : a) 25 % représente la limite acceptable qui devrait être allouée au loyer (octobre 2008).
Q : Quelle est la principale stratégie qui doit être adoptée par tout investisseur dans un portefeuille de placements ?
a) la concentration de son portefeuille dans une seule catégorie d’actifs
b) la diversification de son portefeuille dans plusieurs catégories d’actifs
R : b) la diversification de son portefeuille dans plusieurs catégories d’actifs (novembre 2008)
Toute l’équipe de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. vous souhaite de JOYEUSES FÊTES.
Article 1- Comment diversifier le portefeuille
L’atteinte des objectifs à moyen et à long terme de l’investisseur reposera davantage sur les stratégies d’ensemble qu’il adoptera dans la gestion de son portefeuille que sur le choix des titres individuels. En effet, dans un système efficace, la valeur de l’ensemble dépasse la somme des va leurs des éléments considérés séparément.
La principale stratégie qu’un investisseur puisse appliquer est certes la diversification de son portefeuille. En plus de correspondre à l’adage qui nous invite à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panie, cette approche offre la possibilité, à risque égal, d’augmenter le rendement à moyen et à long terme du portefeuille. La diversification d’un portefeuille devrait être envisagée tant au niveau de l’ensemble du portefeuille, de façon à répartir le montant global entre les catégories de véhicules de placement, qu’à l’intérieur d’un même groupe de valeurs, par exemple les actions ou les obligations.
Techniques de diversification du portefeuille
i) La diversification entre les types de véhicules de placement
Le partage du montant global d’un portefeuille de valeurs mobilières entre les trois principaux types de placements mobiliers, soit les actions, les obligations et les liquidités devrait se faire en tenant compte des facteurs suivants : la situation personnelle, les objectifs de placement et la conjoncture économique. Le tableau 1 présente un ensemble de pondérations de portefeuille adaptées à différentes conditions économiques.
En plus des catégories d’actifs financiers illustrées dans le tableau, le gestionnaire de portefeuille professionnel a recours à des placements dits complémentaires pour tirer profit de situations particulières. Parmi ces placements, on trouve les produits dérivés (options et contrats à terme), les métaux précieux, les fonds de couverture, les obligations à rendement réel et les fonds de revenus, …
Tableau 1
Structures de portefeuille recommandées
pour différents niveaux d’activité économique
et différents taux d’intérêt

ii) La diversification à l’intérieur d’un portefeuille de placement à taux fixe
Après avoir déterminé la pondération de portefeuille vers laquelle il tendra à un moment donné, l’investisseur doit sélectionner à l’intérieur de chaque catégorie les titres qui composeront son portefeuille. Différents critères de diversification peuvent être appliqués pour permettre à l’investisseur d’atteindre divers objectifs, tel que la sécurité du capital, la constance du rendement et la régularité des revenus.
- Répartir la partie du portefeuille investie en obligations entre différents émetteurs. Bien que les obligations soient des valeurs sûres, concentrer une trop forte proportion dans les titres de créance d’un seul émetteur, particulièrement s’il s’agit d’une entreprise, n’est pas souhaitable. Si le portefeuille ne comprend que des obligations gouvernementales, la diversification présente aussi des avantages. En incluant dans son portefeuille des titres provenant par des émetteurs de paliers inférieurs, l’investisseur obtient des rendements plus intéressants.
- Répartir ses placements à taux fixe selon différentes échéances. Cette stratégie permettra de réduire les fluctuations trop importantes entre les rendements moyens de cette section du portefeuille de valeurs mobilières. Une baisse importante du rendement moyen pourrait survenir si une forte proportion des titres détenus venait à échéance et devait être réinvestie au cours d’une période où les taux d’intérêt seraient particulièrement bas.
- Répartir ses revenus fixes de placements entre les différents mois de l’année. Les revenus fixes de placement peuvent, pour certains investisseurs, représenter un apport important dans leur planification financière personnelle. Pour le gestionnaire professionnel, les revenus réguliers fournissent un apport de liquidités qui permettent d’apporter des ajustements au portefeuille.
iii) La diversification à l’intérieur du portefeuille d’actions
Si la diversification à l’intérieur du portefeuille de placements à taux fixe vise particulièrement des objectifs de commodité pour l’investisseur, la diversification du portefeuille d’actions cherchera d’abord et avant tout à améliorer le rapport rendement/risque à l’intérieur des balises que l’investisseur s’est fixées en déterminant la pondération générale de son portefeuille de valeurs mobilières.
- Répartir le portefeuille d’actions entre des titres provenant de différents secteurs industriels. Biens qu’elles soient toutes touchées par le cycle économique, les différentes industries qui composent une économie le sont à des degrés différents. De plus, elles font face à des occasions et à des contrain tes qui leur sont propres. Par un dosage approprié des différents secteurs, l’investisseur diminue sa vulnérabilité par rapport aux difficultés que pourrait connaître un secteur et il tente de profiter au maximum de la conjoncture favorable dont peut bénéficier un secteur à un moment donné. On s’assure d’inclure dans le portefeuille des titres appartenant à chacun des cinq grands secteurs de l’économie:
1. Le secteur des ressources naturelles englobe les entreprises spécialisées dans les industries minières, pétrolières, forestières;
2. Le secteur de la fabrication industrielle contient les entre prises de l’industrie de l’acier, de l’informatique, de l’électronique, des formules d’affaires, etc.;
3. Le secteur de la consommation englobe à la fois les fabricants de pro duits de consommation et les entreprises de distribu tion au détail;
4. Le secteur des services publics : on y trouve les entreprises de téléphonie, de distribution de gaz, d’électricité;
5. Le secteur des services financiers englobe des domaines avec lesquels vous êtes maintenant familiarisés, soit les banques, de même que les sociétés de fi ducie, d’assurance et de courtage.
- Répartir le portefeuille d’actions entre titres provenant de différents marchés nationaux.
Une analyse de l’évolution des différentes économies à l’échelle de la planète montre que, bien qu’elles soient de plus en plus interdépendantes, elles évoluent à des rythmes fort différents les unes des autres. Par exemple, depuis 2005, les pays désigné par l’appellation BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) connaissent des taux de croissance soutenus avoisinant les 10% par année, alors que les pays industrialisés ont connu des taux de croissance à la baisse variant entre 1 et 4%. Mais, investir dans des actions d’émetteurs étrangers présente un obstacle supplémentaire en ce qui concerne la disponibilité des renseignements sur les rendements et les perspectives de ces entreprises. Une solution intéressante consiste alors à recourir aux fonds d’investissement internationaux pour obtenir la diversification souhaitée.
- Répartir le portefeuille d’actions entre des titres présentant des degrés de risque différents.
Compte tenu de l’importance de la tendance générale du marché et de celle du secteur industriel dans l’évolution que connaît un titre boursier en particulier, une diversification qui se ferait en incluant dans un portefeuille un grand nombre de titres très risqués ne pourrait éliminer le risque en deçà d’un certain niveau. En effet, dans une bonne mesure, les valeurs choisies connaîtrait un mouvement global, soit à la hausse, soit à la baisse, plus important que le marché dans son ensemble, ce qui conférerait à ce portefeuille une volatilité importante. Pour évaluer jusqu’à quel point un titre boursier connaît une volatilité supérieure, comparable ou inférieure au marché dans son ensemble, les spécialistes des marchés boursiers utilisent un indice statistique appelé «coefficient bêta». Le coefficient bêta renseigne sur le taux de variation que connaît en moyenne une action lorsque le marché boursier dans son ensemble varie de 1%. Plus l’indice bêta d’une action est supérieur à 1, plus ce titre est volatil. Au contraire, un indice bêta inférieur à 1 est caractéristique d’un titre moins sujet aux fluctuations que ne l’est l’ensemble du marché. Différents sites Web, telsque Yahoo !Finance et argent.canoe, publient les coefficients bêta des actions canadiennes et américaines.
Vous voilà maintenant plus au fait des principales méthodes de diversification. Au cours du premier trimestre de 2009, nous vous présenterons les raisons pour lesquelles il faut diversifier le portefeuille de placement. D’ici là, nos conseillers sont à votre disposition pour recueillir vos commentaires ou répondre à vos questions à ce sujet. N’hésitez pas à prendre contact avec eux.
« À 40 ans, j’ai réalisé que je n’avais rien devant moi, et j’ai décidé de redresser la situation, confie Johanne. Aujourd’hui, j’ai 55 ans, et j’ai encore des problèmes financiers… »
On achète une voiture, des meubles à payer un an plus tard, on craque pour de petits luxes qu’on paie avec la carte de crédit… Et peu à peu, on sent l’anxiété monter chaque fois qu’un compte arrive. Pas étonnant que plusieurs se retrouvent avec des problèmes budgétaires assez graves.
Les Québécois sont le reflet parfait de cette réalité. Au cours de l’année 2007, près de 19 000 consommateurs québécois ont fait faillite, ce qui représente plus de 30 % des banqueroutes nationales. La province est actuellement au deuxième rang canadien pour le nombre de faillites personnelles, derrière l’Ontario.
Bien entendu, la crise financière est l’envers de la médaille de la consommation excessive et de l’endettement, d’où l’importance de cesser de jouer à l’autruche pour éviter ce genre de tragédie.
Mais comment faire pour se sortir la tête du sable? Les réponses des experts sont unanimes: « il faut admettre le problème ». Le hic, c’est que même si ça semble évident, c’est loin de l’être… C’est pourquoi des conseillers budgétaires ont dressé une série de questions permettant d’évaluer si on est au bord de la crise. Voici ce quiz :
- Mes dépenses sont-elles plus importantes que mes revenus?
- Est-ce que j’emprunte pour les dépenses courantes (ex. : restaurant, épicerie, essence)?
- Ai-je accumulé du retard dans le remboursement de mes dettes (capital et intérêts)?
- Les entreprises de services publics me menacent-elles de couper les services?
- Suis-je stressé en pensant à ma situation financière?
Quiconque répond dans l’affirmative à une de ces questions a un sérieux problème et doit le prendre en main !
Dans plus de 90 % des cas, les problèmes financiers sont liés à un endettement excessif. Des gens s’endettent afin de pouvoir consommer tout de suite ce qu’ils pourraient seulement se payer plus tard s’ils économisaient avant d’acheter. Certains ne réalisent même pas ce que représente la somme de leurs dépenses ou le remboursement de leurs dettes, si bien qu’ils peuvent difficilement joindre les deux bouts. D’autres se retrouvent avec un problème budgétaire dès qu’un changement dans leur situation personnelle (ex. : maladie, perte d’emploi, divorce) vient diminuer subitement leur revenu, c’est-à-dire leur capacité de remboursement.
Il est toutefois possible de se prémunir contre les problèmes de dette en suivant les barèmes déterminés par les experts. Les gros canons de la planification financière ont en effet établi que les dettes totales à la consommation devraient représenter au maximum 10 % ou 15 % du revenu net (après impôts et autres retenues salariales ou charges sociales) alors que le versement hypothécaire, avant taxes et chauffage (ou le loyer mensuel ne devrait pas dépasser 25 %.
Voyons maintenant le répertoire des divers postes de dépenses du budget d’un consommateur canadien, selon les données cumulées par Statistique Canada en 2006 (tableau). À chacun d’en tirer ses conclusions.
HABITUDES DE DÉPENSES DES CANADIENS*
Revenu de 150 000 $
(environ 77 000 $ net après cotisation de 20 000 $ au REER)
| Logement (hypothèque, taxes, chauffage, etc.) |
36 % |
27 720 $ |
| Alimentation |
12 % |
9 240 $ |
| Habillement et soins personnels |
9 % |
6 930 $ |
| Transport (y compris l’essence, les assurances, etc.) |
19 % |
14 630 $ |
| Soins de santé |
3 % |
2 310 $ |
| Éducation et lecture |
3 % |
2 310 $ |
| Loisirs et voyages |
9 % |
6 930 $ |
| Autres (cadeaux, imprévus, etc.) |
9 % |
6 930 $ |
| TOTAL |
100 % |
77 000 $ |
*Statistique Canada, 2006, quintile supérieur, no 62-202 au catalogue.
Comment boucler le budget
Toute personne qui découvrirait un énorme trou dans son budget en faisant ces calculs devrait songer à modifier ses habitudes de consommation. Évidemment, c’est plus facile à dire qu’à faire. C’est pourquoi il est recommandé de procéder par étape.
Le point de départ est de répertorier soigneusement les dépenses pendant quelques mois afin de savoir où va l’argent. Ensuite, il faut analyser les résultats obtenus pour trouver le problème. Peut-être que les repas pris au restaurant représentent une partie importante de nos dépenses?
Une fois que la faille est trouvée, il ne restera plus qu’à imaginer comment on pourra redresser notre budget. Par exemple, si le problème, c’est la voiture et qu’on tient absolument à continuer d’en posséder une, il faut couper ailleurs ou trouver une façon d’accroître nos revenus.
En réalité, il existe plusieurs trucs pour diminuer les dépenses. En voici quelques-uns :
- Prendre soin de ce que l’on a
- Ne pas suivre la mode à tout prix et dans tous les domaines
- Prévoir les achats à l’avance afin d’épargner en conséquence – au lieu d’emprunter
- Acheter des produits plus durables en s’informant mieux
- Rechercher les véritables aubaines
- Acheter des articles d’occasion
Se sortir des dettes
Quand un problème budgétaire découle de l’endettement, la seule solution, c’est de s’y attaquer. Par où commencer ? D’abord, il faut réduire les intérêts payés afin de dégager une somme d’argent qui pourra servir à rembourser la dette.
Par exemple, si les cartes de crédit avec des taux d’intérêt de 18 à 30 % ont des soldes impayés, alors il faut les remplacer par une carte de crédit à taux préférentiel (de 9,5 % à 10,5 %), avec frais annuels, ou une marge de crédit (de 10 % à 11,75 %). Il est également possible de transférer des dettes à la consommation sur une carte qui offre 0 % d’intérêt durant une période donnée (à condition de lire attentivement le contrat au préalable). Il est aussi possible de consolider sa dette, c’est-à-dire emprunter sur l’hypothèque (entre 5 et 7%) ou d’obtenir un prêt personnel (autour de 6,5 % ou plus) à la banque qui permettra de rembourser toutes les dettes détenues à gauche et à droite.
Si les revenus d’une personne chutent brusquement, cette dernière pourrait envisager d’allonger le terme de l’hypothèque. Imaginons, par exemple, un propriétaire détenant une hypothèque de 100 000 $ financée sur 15 ans. Eh bien, en augmentant le terme à 35 ans, il ferait passer ses remboursements mensuels de 880 $ à 615 $.
Bien entendu, l’idéal serait d’éviter tous ces problèmes en vivant selon ses moyens. Bien que ce régime convienne parfaitement à certains, d’autres ont besoin d’une bonne dose de détermination et de volonté pour y arriver. Vivre les deux pieds sur terre est néanmoins la solution.
Pour toute question d’ordre économique ou financier, les conseillers de la société Les Fondsd’investissement FMOQ inc. sont à votre service. N’hésitez pas à prendre contact avec eux. C’est gratuit et sans obligation de votre part.
À juste titre, les frais de scolarité et, surtout, les frais afférents aux études collégiales ou universitaires préoccupent bon nombre d’étudiants et leurs parents. En effet, en dépit du gel des frais de scolarité, ces derniers totalisent approximativement 3 000 $ par année. Les frais afférents, eux, peuvent facilement atteindre 10 000 $ par année.
Avec un taux d’inflation annuel qui se situe à 3 % pour le logement et autres frais de subsistance et à 5 % pour les frais de scolarité, c’est une somme d’environ 22 000 $ qu’il faudra débourser, dans une quinzaine d’années, pour financer une année complète d’études universitaires.
Indéniablement, pour beaucoup de personnes, les études postsecondaires représentent un véritable défi financier pour lequel il n’existe pas de solution, si ce n’est de mettre de l’argent de côté, le plus tôt possible, afin d’amasser un pécule intéressant qui s’apprécie au fil des ans.
Le régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Or, si épargner de l’argent en vue des études d’un enfant est une chose, le faire fructifier pour qu’il s’apprécie de façon significative en est une autre. C’est pourquoi le régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un mode d’épargne à envisager sérieusement, d’autant plus qu’il comporte d’indéniables avantages.
Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) permet de faire fructifier des épargnes, à l’abri de l’impôt, jusqu’à ce que l’enfant que l’on veut aider (le bénéficiaire) s’inscrive à un programme d’études postsecondaires.
Pour encourager les contribuables à économiser, le gouvernement du Canada verse une subvention (la Subvention canadienne pour l’épargne-études), directement dans le REEE dont l’enfant est bénéficiaire.
De plus, le gouvernement du Canada a adopté des mesures destinées à « rehausser l’attrait des REEE », soit :
- l’élimination du plafond des cotisations annuelles de 4 000 $;
- l’augmentation du plafond cumulatif des cotisations de 42 000 $ à 50 000 $;
- la hausse du montant maximal annuel de la Subvention canadienne pour l’épargne-études de 400 $ à 500 $.
En pratique, ces trois mesures signifient que :
- la cotisation maximale de 4 000 $ par année et par bénéficiaire n’existe plus;
- pour toute la durée du régime, la limite cumulative des cotisations est désormais de 50 000 $;
- la subvention de 20 % s’applique dorénavant à la première tranche de 2 500 $ des cotisations annuelles, pour un total de 500 $.
Il est à noter :
- que le plafond cumulatif de subvention au régime (7 200 $ au total, par bénéficiaire) demeure le même. En conséquence, quatorze cotisations de 2 500 $ et une quinzième cotisation de 1 000 $ permettront d’atteindre ce montant limite (14 x 500 $ + 1 x 200 $ = 7 200$);
- qu’il est toujours possible de récupérer une année de retard de subvention à la fois. Ainsi, une cotisation de 5 000 $ permettra d’obtenir 1 000 $ de subvention, si l’enfant n’a pas touché toutes les subventions auxquelles il a droit depuis sa naissance.
Le paiement d’aide aux études (PAE)
Le paiement d’aide aux études (PAE) est un montant qui provient d’un REEE et qui est versé pour aider un bénéficiaire à payer le coût de ses études postsecondaires. Constitué des subventions et des revenus accumulés au fil des ans, ce paiement ne comprend pas les cotisations du souscripteur.
Pour un étudiant à temps plein (13 semaines consécutives dans un programme de formation admissible), le PAE est limité à 5 000 $ pour le premier trimestre d’études postsecondaires alors qu’il est sans limite par la suite. De son côté, un étudiant à temps partiel peut aussi recevoir un PAE, qui est toutefois limité à 2 500 $ par trimestre.
| |
AVANT
le 1er janvier 2007 |
APRÈS
le 1er janvier 2007 |
| Plafond de la cotisation (par année) |
4 000 $ |
Aucun |
| Plafond de la cotisation (à vie) |
42 000 $ |
50 000 $ |
| Plafond de la subvention (à vie) |
7 200 $ |
7 200 $ |
Limite de la subvention annuelle fédérale
(en l’absence de retard) |
400 $
(20 % de 2 000 $) |
500 $
(20 % de 2 500 $) |
Limite de la subvention annuelle fédérale
(en cas de retard) |
800 $
(20 % de 4 000 $) |
1 000 $
(20 % de 5 000 $) |
| Admissibilité aux PAE |
Étudiants à temps plein seulement |
Étudiants à temps plein ou à temps partiel(certaines restrictions s’appliquent) |
De plus, le gouvernement du Québec ajoute dorénavant une subvention de 250 $ pour toute cotisation annuelle de 2 500 $.
Dorénavant, des parents ou des grands-parents peuvent, à la naissance de leur enfant ou petit-enfant, cotiser d’un seul coup jusqu’à 50 000 $ dans un REEE. Ce faisant, ils peuvent toucher une seule subvention, tout en faisant croître longtemps les revenus à l’abri de l’impôt.
Le REEE s’avère donc un mode d’épargne très intéressant, car il permet de profiter d’un abri fiscal et de généreuses subventions gouvernementales.
Les conseillers de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. sont à votre disposition pour vous fournir de plus amples renseignements sur le REEE ainsi que sur toute autre question de nature financière.
Lorsque l’on regarde la performance des gestionnaires canadiens en obligations, on s’aperçoit rapidement que la valeur ajoutée de la très grande majorité de ces derniers est relativement faible par rapport à l’indice obligataire canadien (DEX Univers). Il n’est pas surprenant dans un tel contexte que de nombreux investisseurs ont jeté la serviette au niveau de la gestion active et ont décidé d’adopter une gestion purement indicielle.
Le tableau suivant, tiré de l’enquête de fonds communs de Morneau Sobeco, illustre bien la faible valeur ajoutée en obligations au Canada. On peut y voir les rendements obtenus par les gestionnaires obligataires canadiens au niveau du 1er quartile (meilleurs 25% de l’échantillon), de la médiane (point milieu de l’échantillon) et 3e quartile (pires 25% de l’échantillon), sur des périodes de 1 an, 3 ans et 5 ans au 31 décembre 2007. On y présente également le rendement de l’indice.
| Indice boursier |
1 an |
3 ans |
5 ans |
|
|
|
|
| 1er quartile |
3,69% |
4,93% |
5,98% |
| Médiane |
3,42% |
4,70% |
5,68% |
| 3e quartile |
2,60% |
4,45% |
5,49% |
| DEX Univers |
3,68% |
4,73% |
5,60% |
|
Comment peut-on obtenir une valeur ajoutée en demeurant au Canada ?
Quand on le compare à certains autres marchés (comme les États-Unis), le marché obligataire canadien est peu diversifié en termes de secteurs. Cet état de chose contribue au fait que la principale stratégie que la plupart des gestionnaires canadiens utilise pour tenter d’ajouter de la valeur relativement à l’indice est la gestion de la durée, suivie de la gestion de la courbe. Le problème est que ces stratégies, surtout la gestion de la durée, peuvent devenir risquées si elles sont appliquées de façon marquée. Une valeur ajoutée importante survient si le gestionnaire a raison, mais le prix à payer est élevé si celui-ci a tort.
Il est cependant possible d’aller chercher une valeur ajoutée par des stratégies autres que la gestion de la durée ou de la courbe au Canada. Une première stratégie serait de profiter de la prime résultant d’une moindre grande liquidité de certains secteurs, par exemple les obligations provinciales et municipales. En effet, la liquidité plus faible de ces secteurs devrait se traduire par un rendement plus élevé. Par conséquent, une allocation plus élevée à ces obligations relativement à l’indice devrait être bénéfique.
Une deuxième approche serait de surpondérer certains secteurs qui ont un risque plus élevé, mais qui ont le potentiel de procurer un rendement supérieur, comme les obligations corporatives. Cependant, dans ce cas, il faut absolument prendre en compte la tolérance au risque de l’investisseur, car les rendements pourraient être décevants au cours de certaines périodes.
Le graphique suivant, qui donne les rendements annualisés sur des périodes de 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans au 31 décembre 2007 des principaux secteurs de l’indice DEX Univers, illustre le bien fondé des deux stratégies mentionnées précédemment. On peut y voir des rendements supérieurs à long terme pour les obligations provinciales, municipales et corporatives relativement aux obligations fédérales (Canada). Cependant, une surpondération de ces secteurs aurait procuré des rendements inférieurs en 2007.

Une autre stratégie à valeur ajoutée (qui pourrait être combinée aux précédentes) serait de maintenir un portefeuille obligataire semblable à l’indice en termes d’allocation sectorielle, mais de diminuer la qualité au niveau de certains secteurs. Par exemple, une surpondération d’environ 30% des obligations de qualité moyenne (cotées A) dans le secteur corporatif au détriment des obligations de plus grande qualité de ce secteur (cotées AAA/AA) aurait procuré un rendement additionnel moyen de 0,14% par année relativement à l’indice au cours des 5 dernières années.
Enfin, une dernière approche consisterait à allonger systématiquement le terme (et, par conséquent, la durée) de son portefeuille. C’est une stratégie qui devrait rapporter un rendement intéressant à long terme, mais qui comporte plus de risque que celles discutées jusqu’à maintenant. À titre d’exemple, une surpondération de 10% des obligations à moyen terme (5 à 10 ans) et des obligations à long terme (plus de 10 ans) relativement à l’indice aurait généré en moyenne 0,54% par année de plus que l’indice au cours des 5 dernières années. Cependant, cette stratégie aurait fait perdre 0,11% relativement à l’indice en 2007.
Quelles sont les autres stratégies à valeur ajoutée possibles ?
Pour les investisseurs qui sont prêts à considérer des stratégies moins conventionnelles, il est possible d’aller à l’étranger pour pallier à l’étroitesse du marché canadien. En voici quelques exemples :
- Investir une partie de son portefeuille obligataire dans des secteurs à bon profil risque/rendement non présents ou peu représentés au Canada.
- Allouer une partie de son portefeuille à des régions plus risquées, mais avec un très bon potentiel de rendement, comme les pays émergents. Certaines de ces obligations sont garanties par les gouvernements et émises en dollars américains.
- Accepter de prendre un risque assez élevé et investir dans des obligations à haut rendement. Le marché canadien étant très limité dans ce secteur, il est préférable d’aller à l’étranger au niveau de cette stratégie.
Évidemment, il faut être prêt à accepter le risque de devises si l’on va à l’étranger ou trouver des façons de s’en prémunir lorsque cela est possible.
En conclusion…
Il devrait être possible d’obtenir une meilleure valeur ajoutée en obligations. En prenant des biais systématiques et calculés en termes de liquidité, de terme et de qualité relativement à l’indice canadien et en investissant une partie raisonnable de son portefeuille dans des obligations étrangères plus risquées (pays émergents, obligations à haut rendement), il est possible d’obtenir un portefeuille avec différentes sources de valeur ajoutée qui devrait procurer un profil risque/rendement intéressant.