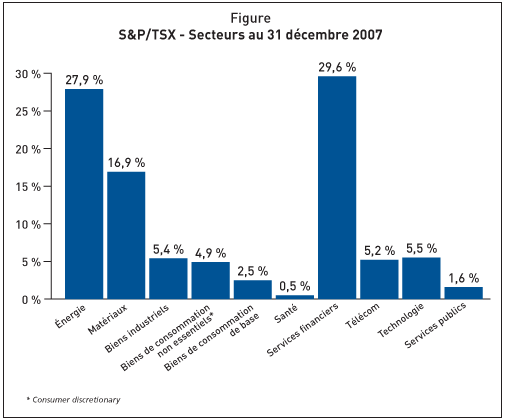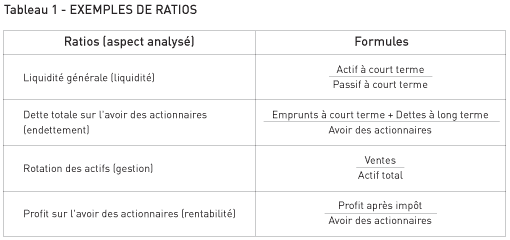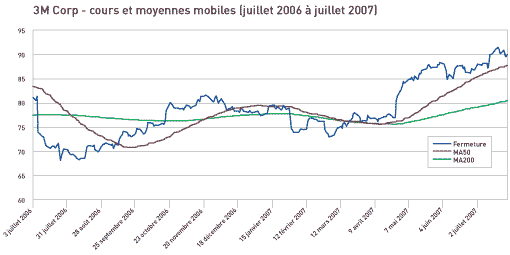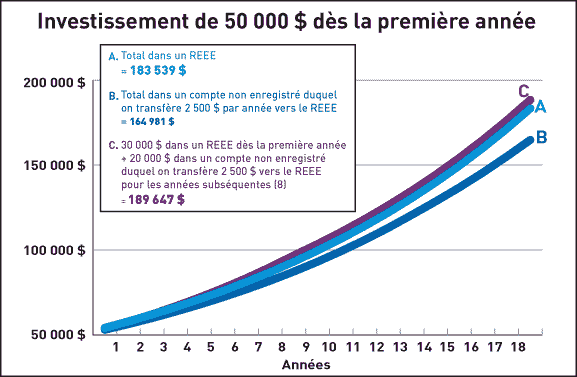En 2005, les autorités fiscales canadiennes enlevaient le plafond de 30% sur les placements étrangers des véhicules de retraite enregistrés. Cela élargissait les horizons des investisseurs canadiens en termes de types de placement étrangers qu’ils pourraient souhaiter inclure dans leur portefeuille. Il faut dire que la plupart des investisseurs n’avaient alors que des actions américaines et internationales de grande capitalisation au niveau étranger.
Au niveau des caisses de retraite canadiennes, on a alors pu apercevoir une tendance à investir plus à l’étranger. Ainsi, selon un sondage effectué par le gestionnaire MFC Global en 2007 auprès de 148 caisses canadiennes, un tiers des répondants avaient l’intention d’augmenter leur exposition en actions internationales au cours des deux prochaines années au détriment des actions canadiennes. Cette tendance n’est pas particulière au Canada selon une étude de la firme Greenwich Associates publiée au début 2007 qui montre le même genre de phénomène pour les principaux pays industrialisés.
Cependant, lorsque l’on regarde le marché des actions étrangères d’une perspective canadienne, il n’est pas très motivant d’investir à l’extérieur du Canada, à tout le moins sur la base des principaux indices boursiers. À cet égard, le tableau suivant présente le rendement annuel moyen, en dollars canadiens, des 5 dernières années au 31 décembre 2007 des indices boursiers de grande capitalisation au Canada (S&P/TSX), aux États-Unis (S&P 500) et à l’extérieur de l’Amérique du Nord (EAEO) :
Tableau
Rendement annuel moyen des indices boursiers
| Indice boursier |
Rendement (2003-2007) |
|
|
| S&P/TSX |
18,3% |
| S&P 500 |
2,7% |
| EAEO |
10,7% |
Il faut dire que les rendements du tableau précédent reflètent l’effet de la devise, et donc l’appréciation du dollar canadien au cours des dernières années.
Quelles seraient alors les motivations d’un investisseur canadien d’aller plus du côté étranger?
Le premier argument qui semble évident est le manque de profondeur du marché des actions canadiennes en termes de secteurs. En effet, le marché canadien est dominé par les ressources naturelles et les services financiers comme on peut le voir dans le graphique suivant qui donne la pondération par secteur de l’indice S&P/TSX au 31 décembre 2007 :

Il est clair qu’un investisseur qui désire avoir une diversification raisonnable au niveau sectoriel ne pourra l’obtenir dans le marché canadien.
Par ailleurs, au cours des dernières années, on a vu un certain nombre de nos fleurons canadiens soit passer à des intérêts étrangers (Alcan, Inco et Falconbridge pour ne citer que quelques-uns), soit devenir la propriété d’intérêts privés (BCE). Le marché des actions canadiennes devient alors de plus en plus un marché de moyenne et faible capitalisation. Il ne serait pas surprenant d’observer plus de volatilité dans le marché canadien à l’avenir. On serait alors justifié d’aller à l’étranger pour compenser cette carence.
La tendance notée au paragraphe précédent devrait amplifier un problème déjà apparent depuis quelques années, soit les limites du marché canadien en termes de liquidité. Ainsi, les gestionnaires de portefeuilles qui ont eu beaucoup de succès à amasser des actifs en actions canadiennes se sont vus dans l’obligation de commencer à refuser de nouveaux mandats. Pour certains d’entre eux qui ont un portefeuille très concentré, l’acquisition de nouveaux actifs en actions canadiennes a contribué à améliorer leur performance (puisqu’ils achètent de plus en plus un nombre limité des mêmes titres). Cependant, s’ils commencent à perdre des clients, la spirale ira alors vers le bas!
Évidemment, un investisseur pourra également avoir des obligations et d’autres types de placement dans son portefeuille (par exemple, de l’immobilier ou autres placements privés). Encore là, le marché canadien a ses limites. Par exemple, le marché des obligations canadiennes est passablement limité en termes de secteurs. Ainsi, la plupart des gestionnaires d’obligations canadiennes qui visent procurer une valeur ajoutée raisonnable pour leurs clients le feront principalement en s’éloignant considérablement de l’indice de marché au niveau de la durée ou en se positionnant de façon très différente de l’indice sur la courbe des taux d’intérêt. Mais c’est probablement beaucoup plus difficile d’ajouter de la valeur de cette manière dans un environnement à faibles taux d’intérêt.
Lorsque l’on regarde également d’autres classes d’actif moins fréquemment incluses dans le portefeuille d’un investisseur à profil moyen, comme les actions de petite capitalisation ou les placements en infrastructure, là encore le choix est beaucoup plus grand à l’étranger.
Il semble alors y avoir une foule de bonnes raisons pour un investisseur canadien de loucher davantage vers l’extérieur du Canada. Mais force de constater que la plupart des investisseurs canadiens ont la majorité de leurs placements au Canada. Logiquement, un investisseur canadien devrait avoir environ 3% de son portefeuille au Canada, en accord avec le poids du Canada dans l’économie mondiale. Qu’est-ce qui peut expliquer cet état de chose? À prime abord, les investisseurs sont plus à l’aise de mettre leur argent dans les titres de leur pays, car ils les connaissent mieux. Ce phénomène qu’on appelle en anglais ‘home bias’ n’est pas spécifique au Canada. Il y a également le sentiment par plusieurs investisseurs que, parce que le marché canadien a mieux fait aux cours des dernières années, il continuera à bien faire dans le futur. La finance comportementale qualifie ce genre d’attitude de ‘sur-confiance’.
Mais même si l’on est convaincu qu’il faille aller plus à l’étranger, il demeure une question fondamentale qu’il faut regarder : les devises. Plusieurs fonds n’offrent pas de protection à ce niveau. Cela a grandement contribué à la performance décevante des placements étrangers de bon nombre d’investisseurs au cours des dernières années et amplifier leur désir de conserver un biais canadien. Cependant, au niveau actuel du dollar canadien, l’aspect devises devrait être moins préoccupant pour les investisseurs.
Obtenir un rendement annuel de 30 %, au lieu de 10 %, simplement parce qu’on a emprunté 87 % du montant investi, est certes une idée est séduisante.
Pour multiplier ainsi le rendement, les investisseurs doivent utiliser l’« effet de levier », une stratégie qui repose sur un principe pouvant être formulé ainsi : « Il faut de l’argent pour faire de l’argent » ou «On peut faire de l’argent avec l’argent des autres ».
Les adeptes de cette stratégie avancent qu’un investisseur ayant 20 000 $ à placer pourrait obtenir un prêt « 2 pour 1 » qui lui permettrait d’injecter 60 000 $ (prêt de 40 000 $) dans un fonds commun de placement avec un rendement, par exemple, de 10 % par an. Au bout d’un an, il dégagerait un gain brut (avant le coût d’emprunt) de 6 000 $ (60 000 $ x 10 %).
Si l’emprunt était assorti d’un taux de 7 %, il devrait assumer une dépense en intérêts de 2 800 $ (40 000 $ x 7 %). Le gain net après les frais d’intérêt serait donc de 3 200 $, ce qui représenterait un rendement de 16 % en regard des 20 000 $ réellement investis. Le rendement de 10 % du fonds commun serait donc amplifié. En conséquence, plus on emprunte une grosse proportion de l’investissement, plus cet effet de levier est important.
Des exemples de ce genre, on en retrouve un peu partout. Le but de ceux qui les utilisent est fort simple : inciter des investisseurs à recourir à l’effet de levier. Il faut cependant savoir que la plupart des conseillers financiers sont rémunérés au moyen de commissions. Il est dès lors facile de comprendre qu’ils empocheront beaucoup plus en commissions s’ils parviennent à vous convaincre d’investir plusieurs fois la somme dont vous disposez. Comment? Par le biais d’un prêt levier! Par ailleurs, il est important de ne pas perdre de vue que l’établissement financier pour lequel ces « conseillers » travaillent empochera les intérêts que vous devrez payer sur l’emprunt.
Si ces commissions et ces intérêts sont assurés pour ceux qui vous « vendent » l’effet de levier, ce n’est pas du tout le cas du rendement sur vos investissements. Aussi, méfiez-vous de ce genre de calculs qui semblent si simples et si beaux !
Il est vrai que, pour certaines personnes qui ont fait appel à cette stratégie, la manœuvre s’est avérée bénéfique. La plupart des propriétaires de maison y ont recours, souvent sans même le savoir. En effet, pour la majorité des gens, l’acquisition d’une première habitation se fait avec une mise de fonds variant de 5 à 20 %. En pratique, ces nouveaux propriétaires empruntent de 80 à 95 % de la valeur de leur propriété et profiteront de sa pleine appréciation.
Un exemple : vous achetez une maison au prix de 200 000 $ avec une mise de fonds de 20 000 $. Cinq ans plus tard, vous la revendez 240 000 $, ce qui vous permet de réaliser un gain de 40 000 $, en excluant les coûts de votre hypothèque. Cela représente une appréciation de 20 % par rapport au prix initial de la maison, et un gain de 200 % par rapport à la mise de fonds initiale. Tout un effet de levier !
Par contre, ce genre d’expérience a mal tourné pour d’autres personnes qui se sont contentées de suivre un « conseiller » mettant l’accent surtout sur les gros caractères du contrat pour leur vendre l’effet de levier et qui ont négligé, par le fait même, de prendre connaissance des petits caractères avant de signer.
Répercussions d’une dégelée
Que se serait-il passé, dans notre premier exemple, si le fonds n’avait pas connu un rendement de 10 % ? Pis encore, s’il avait chuté au lieu de progresser ?
À l’aide du même calcul, il est facile d’illustrer ce qui serait arrivé si l’investisseur avait vu la valeur de ses parts fondre de 10 % au cours de l’année : au lieu de dégager un gain de 6 000 $, il aurait perdu la même somme (6 000 $), à laquelle il faut ajouter les intérêts sur l’emprunt, soit 2 800 $ (40 000 $ x 7 %). Cette perte totale de 8 800 $ est 4,4 fois plus élevée que la perte de 2 000 $ que l’investisseur aurait enregistrée en investissant seulement 20 000 $. En pratique, l’investissement de 20 000 $ ne vaudrait plus que 11 200 $ (20 000 $ – 8 800 $), pour une perte de 44 %, alors que le fonds commun n’a chuté que de 10 % !
Il est donc primordial de ne jamais oublier qu’un effet de levier amplifie le mouvement des prix à la hausse comme à la baisse. On peut même affirmer qu’en raison des coûts d’emprunt qui y sont rattachés, cet effet accentue davantage les baisses. Voilà pourquoi il est fortement recommandé aux investisseurs de toujours emprunter un montant qu’ils peuvent rembourser aisément. De fait, toute personne qui décide d’utiliser cette stratégie devrait estimer au départ combien elle est prête à perdre advenant que le pire se produise, un scénario qui n’est pas qu’hypothétique !
Heureusement, bon nombre d’investisseurs limitent leur emprunt à 10 ou à 20 % du capital investi. De cette façon, ils bénéficient de l’effet de levier sans trop s’exposer au risque de s’embourber dans des dettes.
Pour que cette stratégie soit envisageable, il faut que le rendement de l’investissement soit plus élevé que le taux d’intérêt sur l’emprunt. Cette condition signifie que vous devrez opter pour des investissements dont le risque est qualifié de « moyen » à « élevé », car les placements « conservateurs » ne produisent jamais des rendements plus élevés que le taux exigé sur l’emprunt. Or, qui dit « placements risqués » dit également « volatilité accrue des rendements ». Si l’on ajoute un effet de levier à cette combinaison, on se retrouve devant une recette assez explosive. Cœurs sensibles, s’abstenir !
Conditions d’emprunt
Tout investisseur avisé devrait acquérir un autre réflexe, soit celui de bien se renseigner sur les conditions d’emprunt. Quel est le taux d’intérêt? Est-il fixe ou variable? Dans ce dernier cas, il est primordial d’estimer les probabilités d’une hausse des taux d’intérêt, c’est-à-dire d’évaluer les pressions inflationnistes et la montée des taux d’intérêt pouvant en découler.
Il faut savoir également que certains prêts offerts par les sociétés financières sont qualifiés de « sur marge », en ce sens qu’ils peuvent enclencher un appel de marge. En clair, ces facilités de crédit permettent normalement d’emprunter jusqu’à 90 % de la valeur au marché libre d’un titre.
Si, par exemple, un investisseur achète 1 000 titres de la société ABC à 80 $ l’unité, en déposant une couverture (mise de fonds) de 8 000 $ dans son compte sur marge, il empruntera le reste, soit 72 000 $ (80 000 $ x 90 %).
Si, par la suite, le prix unitaire des titres d’ABC baissait à 77 $, le compte serait déficitaire de 2 700 $, parce que le courtier ne pourrait prêter que 90 % de la valeur au marché, soit 69 300 $ (77 000 $ x 90 %). Puisqu’il aurait déjà prêté 72 000 $, le courtier devrait récupérer cette différence de 2 700 $ (72 000 $ – 69 300 $). Si l’investisseur était incapable de lui remettre cette somme rapidement, les titres seraient alors vendus à leur valeur marchande, et l’investisseur subirait une perte de 3 000 $.
Déductibilité des intérêts : nuance !
On entend souvent que l’effet de levier procure un avantage fiscal intéressant, l’intérêt sur l’emprunt pouvant être déduit de l’impôt. Cette affirmation doit être nuancée, car elle omet une différence importante entre la fiscalité du Québec et celle du Canada. En effet, alors que la première permet de déduire les intérêts versés à des fins d’investissement uniquement du revenu d’investissement, la seconde permet de le faire des autres revenus. Cette différence n’est pas anodine puisqu’elle jette un doute sur la possibilité de bénéficier de cet avantage fiscal au Québec, en cas de placements non profitables.
En résumé, bien qu’il soit possible pour un investisseur aguerri ou fortuné de s’enrichir plus rapidement grâce à l’effet de levier, il est primordial de bien analyser tous les risques avant d’aller de l’avant, sans quoi cette aventure pourrait s’avérer catastrophique.
Nous terminons ici notre série de quatre articles consécutifs sur les méthodes utilisées pour sélectionner les titres d’un portefeuille dit «à risque». Dans le présent article, nous vous présentons les approches ascendante et descendante ainsi qu’une vue d’ensemble des techniques de sélection de titres.
Si vous êtes de ceux pour qui un score moyen, tout intéressant qu’il soit, est un seuil minimal que vous cherchez constamment à dépasser, il vous faudra normalement consacrer du temps à constituer, parmi le vaste éventail des choix possibles, le groupe de valeurs qui offrent, selon votre évaluation, les meilleures perspectives de rendement, compte tenu du risque que vous êtes prêt à prendre. Le premier choix méthodologique que vous effectuerez sera celui de l’approche descendante ou ascendante.
Approche descendante
L’approche descendante consiste à aborder le problème de la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières en partant du plus général, l’économie dans son ensemble, pour aboutir graduellement au plus spécifique, le choix d’une valeur précise de placement à un prix donné. La démarche logique suivie par l’adepte de l’approche descendante est la suivante :
- Analyse de la situation de l’économie dans son ensemble pour déterminer les grandes tendances (taux de croissance, inflation, investissements, commerce extérieur, etc.) et mesure des répercussions sur les principaux secteurs d’activité industrielle;
- Analyse des secteurs industriels les plus prometteurs;
- Analyse des entreprises les mieux positionnées à l’intérieur des secteurs ciblés;
- Analyse du prix des valeurs de placement que le gestionnaire pourrait inclure dans son portefeuille.
Si cette démarche vous est familière, cela est peut-être dû au fait que cette «grille d’analyse» est celle que suit la presse financière de l’économie et du monde financier. Regardons de plus près les étapes de cette démarche.
Analyse de la situation de l’économie
L’activité économique évolue par cycles plus ou moins réguliers, un peu comme les vagues qui déferlent sur une plage. Une période d’expansion est suivie d’un certain essoufflement pour ensuite faire place à une récession, puis à un plancher et, enfin, à une reprise de l’activité économique. Dans le passé, la durée de vie d’un cycle économique complet pouvait avoir entre 15 mois et 12 ans. Les cycles économiques qui se sont succédés depuis 1980 ont tous été relativement long. Un cycle complet se compose de quatre phases. Il touche l’ensemble de l’économie, non seulement un secteur d’activité ou une industrie en particulier. La progression du cycle économique est annoncée, établie ou confirmée par des signes révélateurs. On divise ces signaux d’alarme en trois groupes :
- Les indicateurs précurseurs. Ces derniers réagissent avant que ne survienne un changement à l’intérieur du cycle économique. Ils ont pour effet de devancer les revirements de tendance. En voici quelques exemples :
• l’indice avancé composite de la Bourse de Toronto (S&P TSX);
• les mises en chantier;
• l’indicateur composite avancé de Statistique Canada.
- Les indicateurs simultanés ou coïncidents. Les derniers ont pour principale caractéristique de suivre de près les revirements qui se produisent dans l’économie. Ils servent à confirmer une nouvelle tendance plutôt qu’à la prévoir. En voici quelques-uns :
• le produit intérieur brut (PIB);
• le revenu des particuliers;
• le taux de chômage.
- Les indicateurs retardataires. Enfin, ces indicateurs sont ceux dont le revirement se produit après celui de l’économie prise dans son ensemble. On retrouve, parmi eux :
• le crédit à la consommation;
• les investissements en biens de production.
Analyse des secteurs industriels
Les perspectives de croissance d’une entreprise et ses chances de réussite dépendent évidemment de la qualité de la gestion et de la pertinence de sa stratégie commerciale. Cependant, le choix des domaines où elle exerce son activité économique se révélera déterminant en ce qui a trait aux occasions favorables et aux contraintes que l’entreprise rencontrera. Comme point de départ, on peut utiliser la subdivision en secteurs industriels de l’indice composé de la Bourse de Toronto (S&P TSX) et de l’indice Standard and Poor 500:
• Biens de consommation discrétionnaire
• Biens de consommation de base
• Métaux et minerais diversifiés
• Énergie
• Services financiers
• Industries de la santé
• Biens industriels
• Technologies de l’information
• Matériaux
• Immobilier
• Télécommunications
• Services aux collectivités
Analyse des entreprises et du prix des valeurs de placement
Lorsqu’il a repéré les secteurs qui répondent à ses critères de risque et de rentabilité, l’investisseur qui recourt à l’analyse descendante voudra évidemment trouver les entreprises les plus intéressantes pour son portefeuille d’actions. Pour ce faire, il peut utiliser les fonctions de filtres qu’on retrouve des sites Web comme globeinvestor.comet Yahoo !Finance.
Il pourra également appliquer les outils de l’analyse fondamentale et de l’analyse technique que nous avons vus dans un article précédent. Mentionnons que ces outils peuvent également être employés au moment de l’analyse des secteurs industriels.
Approche ascendante
Les partisans de l’approche, popularisée et mise au point par un pionnier de l’investissement stratégique, Benjamin Graham, croient qu’en analysant de près la gestion et la situation financière de plusieurs entreprises, ils pourront dénicher de véritables aubaines qui deviendront des placements très fructueux. Pour eux, il est relativement peu important de s’attarder à la situation de l’économie parce que la tendance à très long terme est à la hausse depuis longtemps et qu’il devrait continuer d’en être ainsi dans un avenir proche. Quant à l’importance d’investir dans des entreprises des secteurs prometteurs, cela ne semble pas essentiel pour le célèbre investisseur Warren Buffet, pour qui il est possible, par exemple, de réaliser des profits exceptionnels en sachant déterminer correctement l’entreprise qui réussira à dominer la phase de déclin de son industrie, situation qu’ont connue ces dernières années des industries telles que celles de la lampe-radio et de la machine à écrire.
En notre époque de globalisation des marchés et de constitution de très grandes entreprises, il peut sembler difficile ou même impossible d’effectuer des analyses rigoureuses en ayant accès directement aux installations des entreprises. Reconnaissons, cependant, que la révolution des technologies de l’information et le resserrement des contrôles réglementaires rendent disponible une information fiable et volumineuse sur la très grande majorité des entreprises. En plus de la couverture accordée à l’actualité financière, on trouve aussi des ouvrages, tels que ceux de Jim Collins, qui passent au crible les stratégies de plusieurs entreprises au fil des décennies .
Vue d’ensemble des méthodes de sélection des titres
Pour conclure ce survol des approches en matière de sélection de titres, mentionnons que celles-ci ne doivent pas être perçues comme s’excluant mutuellement, même si cela est parfois le cas. Par exemple, un adepte de l’analyse technique pourra procéder à l’aide de l’approche descendante et effectuer une gestion active de son portefeuille.
La figure montre quelques-unes des possibilités de l’éventail des combinaisons potentielles.

Même si, théoriquement, toutes les possibilités peuvent se concrétiser dans le style de gestion adopté d’un investisseur choisi au hasard, force est de reconnaître que certaines combinaisons sont plus probables que d’autres. Par exemple, un investisseur se situant à l’une ou à l’autre des extrémités sur le continuum Fondamental-Technique sera moins susceptible de recourir à une gestion passive, précisément parce qu’il voudra que le type d’analyse qu’il privilégie soit utilisé afin de générer des rendements supérieurs.
Avec cet article, nous terminons une série qui a principalement porté sur la sélection des titres à inclure dans un portefeuille de valeurs à risque. Les méthodes présentées sont celles qu’utilisent les investisseurs particuliers et professionnels pour choisir les valeurs spécifiques qui composent leurs portefeuilles. En les utilisant à bon escient et en ayant recours également à des méthodes qui portent sur la composition du portefeuille, on améliorera de façon considérable les chances d’obtenir de bonnes performances dans la gestion du portefeuille d’actions.
Nous poursuivons, dans cet article, la présentation des méthodes de sélection de valeurs à risque amorcée dans le précédent article. Nous y établirons la distinction entre les 2 approches préférées des gestionnaires de portefeuille : l’analyse fondamentale et l’analyse technique.
L’analyse fondamentale
Une première façon d’analyser les valeurs de placement consiste à scruter la situation financière des entreprises ou des projets concernés dans le but de pouvoir établir une prévision raisonnablement fiable de leurs perspectives de gains à court et à moyen terme. L’information de base pour un tel exercice se trouve dans le rapport annuel de l’entreprise que l’on peut se procurer facilement sur le site Internet de l’entreprise. Ce document comprend les états financiers récents de l’entreprise , qui renseignent de façon objective sur la rentabilité passée de l’entreprise. On y trouve également des commentaires émanant de la direction de l’entreprise, qui servent à évaluer la capacité de l’entreprise à maintenir ou d’améliorer sa rentabilité au cours des années à venir.
Le domaine d’application de l’analyse fondamentale ne se limite évidemment pas aux entreprises, mais englobe aussi l’économie dans son ensemble et les secteurs d’activités qui peuvent être définis de façon très large (par exemple, le secteur manufacturier) ou beaucoup plus restreinte (par exemple, l’industrie des accessoires de mode).
L’analyste fondamentale recourt fréquemment à la méthode des ratios. Cette dernière offre la possibilité d’évaluer la performance financière d’une entreprise sur la base des renseignements contenus dans les états financiers. On trouvera, au tableau 1, une liste de ratios classés selon les quatre aspects qu’ils permettent d’analyser :
- la liquidité;
- la structure du capital (ou l’endettement);
- la gestion;
- la rentabilité.

Lorsqu’il applique la méthode des ratios, le spécialiste de l’analyste fondamentale ne se limite pas à calculer les ratios d’une entreprise, mais il les compare aussi à ceux des principaux concurrents, ainsi qu’à ceux du secteur industriel dans son ensemble.
L’analyse technique
L’analyse technique propose une approche des marchés de valeur de placement reposant sur l’analyse du comportement des investisseurs plutôt que sur l’étude des perspectives de profits des entreprises. Les défenseurs de cette approche comparent fréquemment le mouvement du prix des valeurs de placement à celui des vagues d’une mer plus ou moins agitée. Ainsi, lorsqu’une valeur a connu une hausse importante au cours d’une brève période, le marché va généralement connaître un mouvement de repli à la baisse. L’inverse se produit également dans le cas d’une valeur qui a chuté de façon prononcée.
La méthode de la moyenne mobile (MA)
L’une des techniques les plus couramment utilisées est certes celle de la « moyenne mobile », qui permet de suivre une tendance, si elle existe, et de réagir rapidement lorsqu’elle change de direction. La méthode consiste à établir, sur une période de temps déterminée, des moyennes successives qui forment la courbe graphique à partir de laquelle l’analyste pourra tenter d’envisager ou de confirmer la tendance des prix.
Une moyenne mobile sert à aplanir la courbe du cours du titre, à réduire l’effet des forts mouvements à la hausse ou à la baisse. L’investisseur recherche alors une information sur la direction du cours d’une valeur de placement (tendance à la hausse ou à la baisse), une information qui n’accordera pas une importance trop grande aux fortes fluctuations passagères. En fait, plus la période de temps sur laquelle la moyenne mobile est calculée est étendue, plus la courbe est uniforme. En effet, en considérant un laps de temps plus grand, on diminue nécessairement les conséquences des fluctuations erratiques et on obtient une courbe aux formes beaucoup plus arrondies.
En revanche, une moyenne mobile est, par définition, toujours en retard par rapport à la courbe des prix, et ce retard sera d’autant plus grand que la période de temps choisie sera grande. Les utilisateurs de la méthode de la moyenne mobile ont souvent recours simultanément à la moyenne mobile de 50 jours, qui permet de déterminer une tendance à court terme, et à celle de 200 jours, qui permet d’évaluer une tendance à long terme.
Les observations qui suivent s’appuieront sur le graphique montrant l’évolution du prix de 3M Corp entre juillet 2006 et août 2007. On y voit la courbe montrant l’évolution du cours de l’action (fermeture), la moyenne mobile de 50 jours (MA50) et la moyenne mobile de 200 jours (MA200).
Nous pouvons d’abord constater que la moyenne mobile de 50 jours se situe généralement en bas de la courbe de prix en période de hausse et au-dessus de cette courbe lorsque la tendance est à la baisse. En comparant la courbe du prix et celles des moyennes mobiles pour 50 et 200 jours, il est possible de tirer les conclusions suivantes :
- La tendance est à la hausse lorsque les deux moyennes mobiles se situent en bas de la courbe de prix et que ces deux courbes évoluent toutes deux dans la même direction. On constate une telle situation depuis mars 2007 sur le graphique de 3M Corp.
- La tendance est à la baisse lorsque les moyennes mobiles se situent au-dessus de la courbe de prix et que ces deux courbes évoluent toutes deux dans la même direction. Un tel scénario peut être clairement observé de janvier à mars 2007 sur le graphique de 3M Corp.
- La tendance teste une nouvelle direction lorsque la courbe de prix croise la ligne de moyenne mobile de 50 jours. Cette tendance se confirme lorsque la moyenne mobile de 200 jours est franchie. Sur le graphique de 3M Corp, nous constatons que le cours a franchi à la hausse la moyenne mobile de 50 jours au début de septembre 2006 et a traversé la moyenne mobile de 200 jours à la fin d’octobre 2006. Le titre s’est ensuite transigé à un niveau plus élevé en novembre et décembre 2006.

Vous voilà à maintenant plus familier avec ces importantes méthodes de sélection de titres que sont l’analyse fondamentale et l’analyse technique. Le quatrième article de cette série traitera d’un autre choix stratégique dans la sélection des valeurs constituant le portefeuille d’actions : le choix entre l’approche descendante et l’approche ascendante.
Dans le cadre de la série entreprise le mois dernier, nous vous présentons le deuxième de quatre articles traitant de la sélection de titres d’un portefeuille dit «à risque».
Dans la presse financière, on présente parfois les opinions de spécialistes des marchés en leur accolant l’étiquette d’adeptes de l’analyse technique ou de l’analyse fondamentale. Ce sont là les deux approches les plus répandues, et une très grande majorité des gestionnaires ont recours à l’une ou à l’autre de ces techniques. Cependant, d’autres approches existent et une bonne connaissance de ces dernières sera nécessaire pour mettre au point son propre style de gestion de portefeuille.
Une première distinction que l’on peut faire entre les méthodes de gestion du portefeuille concerne les approches qui guident la sélection des titres spécifiques et celles qui orientent la composition ou la structure du portefeuille.
Les méthodes de sélection des titres individuels peuvent être regroupées à l’intérieur de trois continuums sur lesquels le gestionnaire se fixe, après réflexion ou de façon spontanée :
- analyse fondamentale par rapport à analyse technique ;
- approche descendante par rapport à approche ascendante ;
- gestion active par rapport à gestion passive.
Pour chacun de ces continuums, le gestionnaire de portefeuille peut opter pour une position extrême ou préférer un certain dosage incorporant des éléments des deux pôles du continuum. Dans la suite du présent article, nous présentons le choix entre la gestion active et la gestion passive. Les prochains articles de cette série porteront sur les deux autres méthodes de sélection que nous avons repérées.
La gestion active ou la gestion passive ?
La grande popularité des fonds d’investissement au cours des années 1990 a amené chez les investisseurs un sens critique plus développé en ce qui concerne le rendement qu’obtiennent les gestionnaires de portefeuilles. On constate, en effet, que plusieurs fonds qui exigent des frais de gestion importants sont souvent moins performants que les principaux indices boursiers. De là à conclure qu’il serait peut-être préférable de tout simplement constituer un portefeuille qui reproduirait fidèlement l’indice boursier, il n’y a qu’un pas… qu’ont allègrement franchi les défenseurs de la gestion passive de portefeuille.
La gestion active de portefeuille
Cette approche de la gestion de portefeuille consiste, en fait, à utiliser différentes méthodes, comme l’approche descendante, l’approche ascendante et l’analyse fondamentale, afin de constituer un portefeuille de placements pour lequel on vise un rendement supérieur à ce qu’il serait possible d’obtenir en se limitant à investir dans les titres qui constituent l’indice boursier (gestion passive).
En optant pour une gestion active, l’investisseur, on le sait, espère un meilleur rendement que celui de l’indice boursier, mais il s’expose également à réaliser un rendement inférieur à cette référence. Si on suppose que le rendement moyen de l’indice boursier est de 12 % à long terme, on constate, par exemple, que le professionnel de la gestion active qui parvient à obtenir un rendement de 1 % supérieur accumule, en 25 ans, un capital de 17 % supérieur à ce qu’obtient le professionnel de la gestion passive. On peut illustrer la situation autrement en disant que si le fonds géré est un REER, on parviendra à produire une rente de retraite de 17 % supérieure grâce à la gestion active. À l’inverse, si le gestionnaire ne parvient pas à égaler le rendement de l’indice et qu’il obtient, par exemple, 11 %, le capital accumulé sera de 15 % inférieur à celui qui résulterait de la gestion passive.
La gestion passive de portefeuille
Comme nous l’avons dit précédemment, cette stratégie de gestion aborde la question de façon beaucoup plus simple en se contentant de constituer un portefeuille qui suivra de près la performance de l’indice boursier. Si on considère le fait que la croissance annuelle moyenne de l’indice boursier Dow Jones, qui reflète la tendance de la Bourse de New York, a été de 16 % au cours des années 1980 et 1990, on constate que le rendement obtenu par une gestion passive peut être tout à fait respectable.
Ce type de gestion a pris une ampleur considérable ces dernières années; en grande partie grâce à la prolifération des fonds indiciels négociables en Bourse (Exchange Traded Funds). L’investisseur nord-américain a maintenant accès à des centaines de fonds de ce type qui se transigent à la Bourse de Toronto ainsi que sur les Bourses américaines (particulièrement à l’American Stock Exchange) et en Europe. L’éventail des fonds offerts est très diversifié. Par exemple, sur le marché canadien, on trouve :
- des fonds d’actions provenant du marché global (iUnit60)
- des fonds d’actions provenant de secteurs industriels spécifiques (iGold, iEnergy, iIT)
- des fonds d’obligations canadiennes à durée de vie fixe (iShares Cdn Short Bonds, iShares Cdn Long Bonds)
Sur l’American Stock Exchange, on peut de plus se procurer des fonds reposant sur les indices boursiers de divers pays (iShares MSCI-France, Shares MSCI-Japan) ou sur des secteurs spécifiques de l’économie américaine (S&P Energy sector SPDR, S&P Technology sector SPDR). De nouveaux fonds de ce type sont régulièrement créés par les grandes banques, par les maisons de courtage et par les Bourses elles-mêmes.
Nous avons vu, dans cet article, un premier choix stratégique pour la sélection des titres qui composent le portefeuille de placement, celui entre la gestion active et la gestion passive. Dans le prochain article, nous traiterons de l’analyse fondamentale et de l’analyse technique.
Nous entreprenons ici une série de quatre articles consécutifs, sur les méthodes utilisées pour sélectionner les titres d’un portefeuille dit «à risque». Certaines sont d’ailleurs fort probablement déjà utilisées par les gestionnaires de vos fonds communs de placement. Bien que ces articles aient pour but de vous informer à titre d’investisseur, nous vous rappelons l’importance de faire appel aux services d’un conseiller financier qualifié avant de vous lancer seul dans la constitution d’un portefeuille d’actions.
Le premier article servira d’entrée en matière pour présenter les divers types d’actions. Le second traitera de la gestion active et de la gestion passive. Le troisième exposera l’analyse fondamentale et l’analyse technique. Enfin, le quatrième et dernier article décrira les approches ascendante et descendante. Bonne lecture !
 |
Compte tenu de l’importance cruciale du facteur «risque» dans tout investissement ou placement, il est normal que l’investisseur s’en remette à une autre classification que celle reposant strictement sur des considérations juridiques (actions ordinaires, actions privilégiées, obligations, etc.). Nous vous proposerons ici une classification qui repose en bonne partie sur la relation entre le rendement et le risque, et qui est constituée de six types d’actions :
les actions de première qualité ou blue chips;
les actions à revenus;
les actions défensives et les actions anticycliques;
les actions cycliques;
les actions à croissance rapide;
les actions spéculatives.
Même si, de façon générale, on tentera de classer un titre dans la catégorie la plus appropriée, ce barème n’est pas tout à fait étanche, ce qui signifie que certains titres répondent à la fois aux caractéristiques de plusieurs catégories.
Les actions de première qualité ou blue chips
Les actions de première qualité, que les Anglo-Saxons désignent par l’expression blue chips, sont des actions de grandes entreprises, dotées d’un actif de plusieurs milliards de dollars. Ces entreprises connaissent depuis de nombreuses années une progression continue et constante quant aux ventes et aux profits. De plus, elles ont affiché dans le passé des versements de dividendes qui montrent une croissance régulière et qui ne laissent voir aucune interruption. Enfin, ces entreprises qui ont atteint le stade de la maturité occupent une position de force dans leur secteur d’industrie. Des compagnies comme IBM, Manuvie, la Banque Royale et McDonald’s sont des exemples.
Ce que recherche un investisseur en optant pour un titre de première qualité, ce n’est pas tant un gain en capital rapide qu’une très bonne sécurité de l’argent investi et un revenu de dividendes périodique qui augmentera au fil des ans.
Les actions à revenus
Les actions à revenus sont des actions ordinaires qui ne sont pas recher chées pour leur potentiel de gain en capital, mais pour le rendement élevé de leur dividende. Il n’est évidemment pas exclu que les prix de ces actions connaissent un mouvement à la hausse, ce qui se produit en fait lorsque les taux d’intérêt baissent, mais l’investisseur ne recherchera pas cette caractéristique en premier lieu. Le taux effectif que représente le dividende sur la valeur au marché d’une action à revenus évolue de façon constante en rela tion directe avec le niveau général des taux d’intérêt. Par exemple, en 1992, une action à revenus pouvait rapporter un dividende se situant entre 5 % et 8 % de la valeur au marché de l’action. En 2007, les actions à reve nus ont versé des dividendes dont les taux varient entre 3,5 % et 5 %. Essentiellement, le taux des dividendes a suivi la même tendance que le taux des obligations à long terme du gouvernement fédéral.
On doit, cependant, éviter de confondre l’action à revenus avec celle présen tant un risque plus élevé. En effet, lorsque le marché perçoit un risque plus important à investir dans un titre, le cours de ce dernier baissera, ce qui aura nécessairement pour effet de faire monter le taux de rendement du dividende.
Les actions ordinaires de Fortis, de Trans-Canada Pipelines et de la Banque Nationale du Canada sont des actions à revenus. On trouve dans cette catégorie les actions ordinaires des entreprises de services publics et les actions privilégiées d’entreprises ayant de bonnes assises financières.
Les actions défensives et les actions anticycliques
Les actions défensives sont des titres de sociétés dont la rentabilité est moins ou peu liée à la situation économique générale ou à la tendance générale de l’ensemble du marché boursier.
Plusieurs entreprises évoluant dans le secteur de l’alimentation, qu’elles aient des activités liées à la production ou à la distribution, bénéficient d’une certai ne protection contre les variations dans le degré d’activité économique à cause du caractère essentiel, c’est-à-dire difficilement compressible, des be soins qu’elles contribuent à satisfaire chez les consommateurs. Le secteur des services financiers cons titue un autre exemple de secteur où l’on trouve plusieurs entreprises qui parviennent à bien se maintenir en période de récession, souvent en adap tant en conséquence l’offre de services à la clientèle. À titre d’exemple d’actions défensives, mentionnons celles de la Banque Laurentienne, de l’Industrielle-Alliance et de Molson Coors.
Les actions anticycliques sont celles des entreprises dont les affaires sont plus florissantes en période de ralentissement économique qu’en temps normal. Cela pourrait être le cas, par exemple, d’une chaîne de distribution au détail de pièces d’automobiles. En période de récession, en effet, de nombreux consommateurs reportent l’achat d’une automobile neuve, ce qui augmente les possibilités pour la vente de pièces d’autos au consommateur final. Les actions d’Uni-Sélect et de Family Dollar Strores (NASDAQ) ont connu ces dernières années une évolution qui s’apparente à celle des actions anticycliques.
Les actions cycliques
Les actions cycliques sont des actions d’entreprises dont la performance fi nancière est très liée au climat économique qui prévaut. En fait, ces entreprises enregistrent des variations dans leurs chiffres d’affaires et dans leurs bénéfices beaucoup plus importantes que ce que l’on constate pour la moyenne des entreprises.
Les compagnies fabriquant des biens de consommation durables comme les automobiles et les gros appareils ménagers, sont particulièrement liées à l’évolution du cycle économique. En effet, lorsqu’un ralentissement éco nomique se pointe à l’horizon, les consommateurs auront tendance à repor ter l’achat de tels biens. Par contre, au moment de la reprise, cette réserve d’achats reportés peut avoir des répercussions très importantes sur le chiffre d’affai res des entreprises qui ont connu la disette. Il en va de même pour les fabricants de biens industriels, comme les secteurs de l’acier et de la machinerie lourde, dont les carnets de commande s’amincissent rapidement au fur et à mesure que les entreprises qui constituent leur clientèle sont touchées par un ralentissement économique.
À titre d’exemple d’actions cycliques, mentionnons celles de General Motors, d’AbitibiBowater, de Teck Cominco, de Nova Chemical et de Canadian Tire.
Les actions à croissance rapide
Les titres de croissance sont des actions ordinaires d’entreprises en pleine expansion. Ces dernières ont connu au cours des récentes années un taux de croissance largement supérieur à celui de la moyenne des entreprises et des autres sociétés de leur secteur industriel. Il peut s’agir de compagnies à l’œuvre dans une industrie relativement récente ou encore qui ont réussi récemment une percée importante sur certains marchés en expansion. Il n’est pas rare que de telles entreprises enregistrent un taux de croissance annuel de leur béné fice supérieur à 25 %. Il arrive fréquemment qu’elles accélèrent encore davantage leur rythme d’expansion en procédant à l’acquisition d’autres entreprises du même secteur d’activité ou de secteurs connexes. L’évolution, ces dernières années, des actions de compagnies telles que Alimentation Couche-Tard, Cameco et Research in Motion illustre bien cette catégorie d’actions.
Les actions spéculatives
Les titres spéculatifs sont souvent associés aux valeurs à quelques sous, ou penny stocks, selon l’expression imagée des Anglo-Saxons. Ces dernières sont des actions dont le prix est inférieur à 1$. Un titre spéculatif repré sente généralement une action d’une entreprise qui commence ses activités dans un secteur très risqué ou dont les produits n’ont pas encore passé avec succès le test du marché, comme des produits dits avant-gardistes ou révolu tionnaires qui tentent de s’imposer. Les jeunes entreprises d’exploration minière ou pétrolière sont réputées pour émettre des titres spéculatifs, de même que les petites entreprises des secteurs de la haute technologie.
Il faut aussi inclure dans la catégorie des actions spéculatives les actions de compagnies déjà à l’oeuvre depuis plusieurs années sur des marchés plus stables, mais qui traversent néanmoins une période de difficultés financiè res dont l’issue est incertaine. Le titre spéculatif attire l’investisseur prêt à courir de grands risques pour bénéficier de gains en capital rapides. |
La nouvelle année marque le début des « campagnes REER » des différents établissements financiers qui, jusqu’à la fin de février, vont inonder les médias imprimés et électroniques d’annonces publicitaires vantant les mérites et les avantages de leurs produits de placement et d’épargne pour vous assurer une retraite confortable.
Dès lors, il est difficile, voire impossible d’ignorer l’existence du régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ni de douter de son utilité certaine pour mettre de l’argent de côté, à l’abri des impôts, en vue de la fin de votre vie professionnelle active. En plus de profiter d’une déduction du revenu imposable établie en fonction des cotisations versées, toute personne qui détient un REER tire avantage de revenus non imposés, à la condition cependant que l’argent versé y demeure.
Aux fins des déclarations de revenus de 2007, la date limite de cotisation à un REER est le 29 février 2008, soit le 60e jour de l’année. La cotisation maximale est égale à 18 % des revenus admissibles de 2007, jusqu’à un maximum de 19 000 $, MOINS le facteur d’équivalence (FE) pour les personnes participant à un régime de pension agréé (RPA) ou à un régime de participation différé aux bénéfices (RPDB), PLUS les droits de cotisation inutilisés et reportés. Le montant des cotisations auquel vous avez droit est indiqué dans votre avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
CONSEIL 1 – FAITES-LE EN DÉBUT D’ANNÉE… PEU IMPORTE LES MARCHÉS !
Il est possible de cotiser à un REER dès le début de l’année d’imposition en cours. La cotisation maximale permise est 20 000 $ en 2008, elle sera 21 000 $ en 2009 et 22 000 $ en 2010. Par la suite, ce plafond sera indexé annuellement.
Si vous disposez de liquidités vous permettant de cotiser à votre REER en tout début d’année, faites-le! Ne vous laissez pas distraire par les aléas des marchés financiers ni par le fait que vous n’avez pas le temps de rencontrer votre conseiller avant de faire un choix judicieux. Au besoin, optez pour un véhicule de placement à court terme, du type marché monétaire, à l’intérieur du REER. De cette façon, votre investissement croîtra immédiatement à l’abri de l’impôt. Par la suite, vous pourrez transférer votre argent vers un autre véhicule de placement à plus long terme, toujours à l’intérieur du REER. Vous pourrez alors procéder graduellement ou d’un seul coup.
CONSEIL 2 – NE PERDEZ PAS DE VUE LES RENDEMENTS !
Nous ne cesserons jamais de répéter qu’attendre la date limite permise pour cotiser est une décision malavisée et très lourde de conséquences sur le plan financier. Pourquoi? Parce que les retardataires ne profitent pas pleinement des rendements. Or, ceux-ci sont un élément très important à considérer.
Ne pas tenir compte des rendements et ne penser qu’aux seules économies d’impôt constituent la meilleure façon d’évaluer incorrectement vos placements. À titre d’exemple, le tableau ci-dessous permet d’évaluer la différence entre les revenus accumulés en raison de contributions annuelles de 19 000 $ (la cotisation maximale permise pour l’année d’imposition 2007) effectuées en début d’année, et dont les rendements annuels composés moyens sont respectivement de 6 %, 7 % et 8 %.
|
RENDEMENTS
|
Nombre d’années
dans le REER |
6 %
|
7 %
|
8 %
|
|
10
|
265 461 $
|
280 888 $
|
297 264 $
|
|
15
|
468 778 $
|
510 873 $
|
557 161 $
|
|
20
|
740 862 $
|
833 438 $
|
939 036 $
|
|
25
|
1 104 971 $
|
1 285 853 $
|
1 500 134 $
|
|
30
|
1 592 232 $
|
1 920 388 $
|
2 324 571 $
|
|
35
|
2 244 296 $
|
2 810 356 $
|
3 535 941 $
|
CONSEIL 3 – PORTEZ ATTENTION AUX HONORAIRES DE GESTION !
Même si vous décidez de cotiser à votre REER à la toute la dernière minute, prenez le temps de vous informer des honoraires de gestion, sans quoi vous risquez de vous pénaliser. Pourquoi? Tout simplement parce que la moindre différence a des répercussions énormes sur les rendements à long terme. En effet, une simple différence de 2 % entre les frais de gestion de deux fonds communs de placement équilibrés similaires offrant des rendements comparables (p. ex. l’un exigeant des frais de gestion de 1 % et l’autre 3 %) représentera, après 35 ans, une différence de 58 % quant à l’actif accumulé (3,1 M$ contre 1,9 M$).
CONSEIL 4 – COTISEZ AU REER DE VOTRE CONJOINT !
Malgré les modifications fiscales permettant le fractionnement du revenu entre conjoints à la retraite, il peut être avantageux de cotiser au REER de votre conjoint. Si vous prévoyez que votre revenu à la retraite sera supérieur à celui que votre conjoint aura, vous devriez envisager sérieusement de cotiser à son REER! En effet, en y versant des cotisations jusqu’à concurrence du montant maximal permis auquel vous avez droit, vous bénéficierez d’une déduction identique à celle que vous auriez obtenue en cotisant à votre propre REER, et ce, sans affecter les droits de cotisation de votre conjoint.
Bien entendu, lorsque le moment sera venu d’encaisser le REER, seule la personne qui le détient sera imposée sur le montant du retrait. Si vos revenus annuels sont inférieurs, vous aurez moins d’impôts à payer.
De plus, si votre conjoint est plus jeune que vous, l’argent pourra demeurer dans son REER plus longtemps, la limite étant fixée à la fin de l’année de ses 71 ans.
CONSEIL 5 – COTISEZ MAINTENANT, DEMANDEZ LA DÉDUCTION PLUS TARD !
Beaucoup d’investisseurs l’ignorent, mais il est possible de cotiser à un REER dès le début de l’année d’imposition en cours. Fixée à 19 000 $ pour 2007, la cotisation maximale permise sera de 20 000 $ en 2008, de 21 000 $ en 2009, et de 22 000 $ en 2010. Par la suite, ce plafond sera indexé annuellement.
Si votre taux d’imposition est peu élevé (en raison d’un congé de maternité, d’un congé sabbatique, d’un retour aux études, etc.) et que vous prévoyez déclarer un revenu moindre en 2007, vous auriez intérêt à cotiser la somme maximale permise à votre REER. Pourquoi? Parce que même si vous le faites, vous ne serez pas tenue pour autant d’utiliser la déduction pour l’année d’imposition correspondante. Vous pourriez, par exemple, faire fructifier vos investissements à l’abri de l’impôt immédiatement, puis utiliser la déduction quelques années plus tard, lorsque votre taux marginal d’imposition sera vraisemblablement supérieur. Votre remboursement d’impôt n’en sera alors que plus important.
Cette façon de faire est intéressante dans la mesure où vous commencez à investir dans un REER, mais que vos revenus, quoique limités, risquent d’augmenter de façon significative dans un proche avenir. C’est notamment le cas des étudiants ou des personnes qui bénéficient d’un congé parental.
Avant de reporter une déduction REER à une année ultérieure, prenez le temps de faire faire une simulation fiscale afin de bien évaluer toutes les répercussions de votre choix. Ne vous fiez pas uniquement à votre taux d’imposition marginal pour estimer l’économie d’impôt que vous réaliseriez en cotisant à votre REER. Vous devez tenir compte également des nombreux crédits d’impôts et d’autres allégements fiscaux qui, à compter d’un certain seuil de revenu, sont restreints, voire carrément éliminés. Faire appel à l’expertise d’un professionnel serait donc une sage décision.
CONSEIL 6 – UTILISEZ TOUS VOS DROITS DE COTISATION !
Si vous êtes de ceux qui n’ont pas versé les cotisations maximales autorisées à leur REER depuis 1991, vous devez savoir que vous pouvez ajouter une somme correspondant à vos droits de cotisation inutilisés. Pour la connaître, consultez votre avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada.
CONSEIL 7 – CONSTITUEZ-VOUS UN « COUSSIN » !
En terminant, sachez qu’il est également permis de cotiser jusqu’à 2 000 $ en sus des cotisations mentionnées précédemment, sans pénalité. Bien qu’il ne soit pas déductible dans l’année, ce « coussin » produit des revenus à l’abri de l’impôt, tant et aussi longtemps que la somme investie demeure dans votre REER. Quant à la cotisation, elle devra être déduite de votre revenu au cours d’une année à venir, au plus tard la dernière pour laquelle vous disposerez de droits de cotisation.
Vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur le REER ou sur d’autres produits et services financiers? Communiquez avec nos professionnels. Ils se feront un plaisir de vous aider.
| Vous pratiquez en société?
Comme pour tous les travailleurs qui ne participent pas à un régime de pension agréé, si votre pratique médicale se fait dans le cadre d’une société, et que vous souhaitez pouvoir cotiser au maximum à votre REER en 2009 (21 000 $), vous devrez prévoir vous verser un SALAIRE (revenu gagné admissible) de 116,667 $ en 2008 (116,667 $ x 18 % = 21 000 $) |
|
Tout au long de l’année 2007, la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. a publié une chronique financière dans chaque numéro du Médecin du Québec. Nous vous invitons à prendre quelques instants pour répondre aux questions qui suivent. Toutes les réponses ont été données dans un article de notre chronique en cours d’année.
| Q : |
Quelles sont les sommes maximales permises à titre de cotisations au REER
pour les années d’imposition suivantes: |
|
Année 2007 : a) 10 000 $ b) 19 000 $ c) 16 500 $
Année 2008 : a) 11 000 $ b) 20 000 $ c) 19 000 $ |
| R : |
Pour l’année 2007, 19 000 $ et pour l’année 2008, 20 000 $ (janvier 2007). |
| Q : |
Concernant le prix du pétrole, pouvez-vous associer les années suivantes aux
événements qui ont eu cours? |
|
1998-1999
2000
2001-2002
2003
La crise asiatique
La récession mondiale
Le boom
La reprise économique
|
| R : |
1998-1999 = la crise asiatique
2000 = le BOOM
2001-2002 = la récession mondiale
2003 = la reprise économique
(Juin 2007). |
| Q : |
Lequel des énoncés suivants concerne le calcul du rapport cours/bénéfice ?
a) Le dividende annuel par action divisé par le cours du marché de l’action
b) Le cours d’une action ordinaire divisé par le bénéfice par action
c) Le bénéfice net moins les dividendes privilégiés divisé par le nombre d’actions ordinaires émises et en circulation |
| Q : |
À combien s’élève le plafond cumulatif des subventions fédérales accordées dans un régime enregistré d’épargne-études ?
a) 4 000 $
b) 7 200 $
c) Aucun plafond cumulatif
|
| R : |
b) Le plafond cumulatif s’élève à 7 200 $ par bénéficiaire (septembre 2007). |
| Q : |
Sur la première tranche de 2 500 $ cotisés annuellement dans un REEE, quel pourcentage le Gouvernement du Québec accorde-t-il à titre de subvention ?
a) 5 %
b) 15 %
c) 10 % |
| R : |
c) La subvention est établie à 10 % des premiers 2 500 $ cotisés annuellement au régime d’un bénéficiaire (septembre 2007). |
| Q : |
Considérant qu’un investisseur est imposé au taux marginal le plus élevé (48,2 %), à combien sont imposés ses revenus de placement :
sous forme d’intérêts : a) 50 % b) 48,2 % c) 45 %
sous forme de dividendes : a) 48,2 % b) 35 % c) 29,7 %
|
| R : |
Sous forme d’intérêts, le taux d’imposition d’un revenu est 48,2 % alors que sous forme de dividendes, le taux d’imposition est 29,7 %. (novembre 2007) |
Toute l’équipe de la société vous souhaite de joyeuses fêtes !
Bon nombre d’investisseurs en ont mare des rendements de 4 à 5 % offerts présentement par les titres à revenu fixe et salivent rien qu’à l’idée d’obtenir 10 % par année. Lorsque ces derniers découvrent que les fonds de dividendes d’actions canadiennes ont procuré en moyenne (en date de septembre 2007) une performance annuelle de 14,8 % en 5 ans, de 10,3 % en 10 ans et de 11,9 % en 15 ans, ils sont estomaqués.
Est-ce trop beau pour être vrai ? Bien sûr que non, car les dividendes sont synonymes de profitabilité. Pourquoi ? Parce que les actionnaires détiennent les droits de propriété de l’entreprise et en partagent ainsi les succès et les revers. Alors, lorsqu’une société réussit à rentabiliser ses opérations, son premier réflexe sera généralement de chouchouter ses porteurs de parts en leur versant des dividendes.
La générosité des entreprises dans la distribution de cette gratification dépend en premier lieu de ses propres besoins. Dans le cas de sociétés parvenues à un stade de maturité, c’est-à-dire les Blue Chips, une grande partie du bénéfice sera versée en dividendes. Par contre, si les entreprises sont jeunes et en pleine croissance, l’essentiel des profits pourrait servir à en financer l’essor.
Le pourcentage du bénéfice net versé en dividendes varie donc énormément d’une entreprise à l’autre. Toutefois, une chose est certaine, un rendement en dividendes élevé (montant des dividendes/cours de l’action) caractérise généralement une entreprise rentable, bien établie et solide. Au Canada, les sociétés les plus généreuses avec leurs actionnaires évoluent dans les services financiers, les télécommunications et les services publics. Il s’agit donc de placements assez conservateurs qu’un investisseur peut détenir à long terme.
Une autre caractéristique non négligeable est que l’accroissement des dividendes est de nature à provoquer une montée du prix de l’action. La politique de versement de dividendes est donc un facteur clé influençant la valeur d’une entreprise. Ainsi, certaines sociétés, telles que Power Corporation, Banque Royale et Banque Nationale, se sont taillées une réputation appréciable auprès des investisseurs en raison de la constance avec laquelle le flot de dividendes s’est accru ces dernières années.
Dans l’ensemble, cependant, le rendement en dividendes a fléchi au fil des ans au Canada. De 1960 à 1998, le dividende annuel moyen de l’indice phare canadien s’est établi à 3,4 %, révèle l’étude Évolution récente des marchés d’actions et ses conséquences, publiée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Mais le taux a reculé depuis et s’élevait à 2,44 % le 30 mars dernier. Ce repli s’explique en grande partie par le fait que de plus en plus d’entreprises augmentent la valeur de leurs actions (et avantagent les actionnaires) en rachetant les titres en circulation à même leurs bénéfices.
Une dernière particularité des dividendes est que leur traitement fiscal est avantageux. En effet, le taux maximal d’imposition des dividendes versés par les sociétés ouvertes s’élève actuellement à 29,7 % au Québec, comparativement à 48,2 % pour les revenus d’intérêt. C’est donc un placement encore plus intéressant lorsqu’il ne fait pas partie d’un REER.
Choisir avec doigté
Avec un tel profil, pas étonnant que les fonds de dividendes soient en vogue. Leur popularité s’appuie sur les qualités suivantes : constance des rendements, limitation du risque, régularité des revenus et fiscalité avantageuse des dividendes et du gain en capital.
Le risque qui guette cependant les investisseurs est d’être ébahis par ces qualités et, conséquemment, ne pas sélectionner ces fonds diligemment. Pourquoi est-ce important de bien choisir? Parce que cette catégorie de fonds englobe des portefeuilles très différents les uns des autres, puisque l’actif peut être canalisé dans les actions ordinaires, les actions privilégiées, les parts de fiducies de revenu ou les obligations corporatives.
Les composantes clés de ces fonds sont bien entendu les actions ordinaires et privilégiées. Qu’est-ce à dire? Les actions privilégiées sont une action de type particulier qui rapporte un montant fixe de dividendes, puisé à même les profits de l’entreprise. Leur nom signale qu’elles ont priorité sur les actions ordinaires en ce qui concerne le paiement des dividendes. Elles sont en quelque sorte un titre hybride, plus sécuritaire que les actions ordinaires, mais plus risqué que les obligations corporatives.
Bien que les gestionnaires de fonds de dividendes mettent l’emphase sur ces titres, il y a un hic, et il est de taille : les actions ordinaires munies de dividendes élevés et les actions privilégiées sont souvent émises par les mêmes entreprises canadiennes. Par conséquent, les fonds pourraient dépendre d’un nombre restreint d’émetteurs. Pour contourner ce problème, les gestionnaires font normalement appel aux parts de fiducies de revenu et aux obligations de sociétés (corporate bonds).
Jusqu’à tout récemment, les fonds de dividendes fortement investis dans les fiducies de revenu brillaient avec éclat. Étant donné l’avantage fiscal dont jouissent ces fiducies, tous les projecteurs étaient tournés vers elles. Seulement voilà, le gouvernement fédéral a modifié les règles fiscales en novembre 2006 de manière à ce que l’imposition des distributions des fiducies de revenu devienne semblable à celle des dividendes d’ici la fin de 2011. Cette décision, visant à décourager les sociétés ouvertes de se convertir en fiducies de revenu, n’a pas manqué de jeter une douche froide sur la valeur de ces unités et sur le rendement des fonds qui y sont exposés.
Au reste, les obligations d’entreprises constituent le placement le moins avantageux à l’extérieur du REER, car les revenus d’intérêt sont imposables à 100 %. Il faut noter que les obligations ont tout de même l’avantage d’accroître la stabilité du fonds, tout comme les actions privilégiées.
En comprenant mieux les fonds de dividendes, un investisseur peut donc maximiser les avantages qu’il en tire. Il faut aussi noter que les fonds de revenu mensuel, parfois aussi appelés fonds diversifiés, ont fait leur apparition depuis quelques années et sont composés des quatre mêmes classes d’actifs. Ils méritent aussi notre attention.
Dans la chronique du mois dernier, nous avons abordé les plus récentes modifications apportées au régime enregistré d’épargne-études (REEE).
Même si le gouvernement fédéral n’a pas jugé bon de hausser la limite à vie de la subvention de 7 200 $ à laquelle un bénéficiaire a droit, le régime a été bonifié, car la subvention est dorénavant accordée sur les premiers 2 500 $ de capital investi par enfant, comparativement à 2 000 $ avant le 1er janvier 2007. La subvention annuelle passe ainsi de 400 $ à 500 $. De plus, le gouvernement du Québec ajoute dorénavant une subvention de 250 $ pour toute cotisation annuelle de 2 500 $.
Les autres améliorations apportées au régime sont :
- l’abolition de la limite de cotisation annuelle de 4 000 $;
- l’augmentation de la limite de cotisation à vie, de 42 000 $ à 50 000 $.
Ces deux éléments peuvent modifier d’une manière significative la façon d’accumuler de l’épargne pour les études des enfants.
En effet, dorénavant, des parents ou des grands-parents peuvent, à la naissance de leur enfant ou petit enfant, cotiser d’un seul coup jusqu’à 50 000 $ dans un REEE. Ce faisant, ils peuvent toucher une seule subvention, tout en faisant croître longtemps les revenus à l’abri de l’impôt.
En pratique, une cotisation de 50 000 $ dans un REEE pourrait croître jusqu’à 183 358 $1après 18 ans, comparativement à 116 447 $2 dans un compte non enregistré. L’écart de 66 911 $ provient presque exclusivement du fait que, dans le REEE, les rendements profitent à l’abri de l’impôt.
Par contre, si un souscripteur investissait plutôt 2 500 $ par année dans un REEE afin de toucher toutes les subventions auxquelles il aurait droit, tout en laissant le reste de son capital de 50 000 $ croître dans un compte non enregistré, son portefeuille (REEE et non enregistré) atteindrait 164 981 $2.

De fait, le scénario idéal se situe entre les deux précédents, car il est préférable de placer rapidement un bon montant à l’abri de l’impôt (même si l’on se prive des subventions gouvernementals futures). Voici un exemple :
- cotiser 30 000 $ à un REEE la première année; et
- placer 20 000 $ dans un compte non enregistré, duquel serait retiré annuellement un montant de 2 500 $ qui serait transféré au REEE, pendant une période de 8 ans.
En agissant ainsi, vous toucherez seulement 6 750 $ de subventions (500 $ X 9 et 250 $ X 9) alors que le maximum est 10 800 $ (7 200 $ au fédéral et 3 600 $ au provincial). Cependant, le portefeuille accumulé atteindra 189 647 $.
1 Rendement projeté de 7 %
2 Rendement projeté de 7 % et taux moyen d’imposition des rendements de 35 %