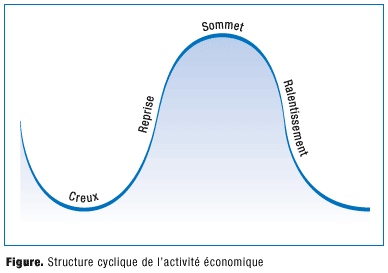Notre régime juridique prévoit la possibilité de nommer diverses personnes pour agir en notre nom lorsque nous ne sommes plus en mesure de le faire. Comme il existe des différences importantes quant aux rôles et aux responsabilités de ces intervenants, nous avons commencé à les expliquer dans les deux chroniques précédentes. Nous terminons aujourd’hui cette série en traitant d’autres formes de protection relatives à la minorité et à l’inaptitude et en décrivant les rôles du conseil de tutelle et du Curateur public du Québec.
LA MINORITÉ
Le Code civil du Québec prévoit quatre formes distinctes de protection pour les personnes majeures inaptes : 1) le mandat en cas d’inaptitude, 2) de la curatelle au majeur, 3) de la tutelle au majeur et 4) du conseiller au majeur.
Quant au régime de protection des mineurs en raison de leur jeune âge, il s’agit du régime de tutelle au mineur.
Ainsi, il y aura ouverture d’un régime de protection applicable selon la situation.
À titre de représentant légal de l’enfant mineur, le tuteur joue un rôle très important. En plus de prendre soin de l’enfant, de le surveiller adéquatement et de veiller à son éducation, le tuteur représente le mineur dans ses actes civils et administre ses biens avec prudence, diligence et compétence.
La tutelle légale (les parents)
Les parents (père et mère) sont de plein droit les tuteurs légaux de leurs enfants mineurs. En principe, cette charge est exercée conjointement. Si l’un des parents décède ou est dans l’impossibilité d’agir, la charge tutélaire est exercée par l’autre parent.
Le tuteur légal qui administre un patrimoine d’une valeur excédant 25 000 $ doit être assisté, dans l’exécution de sa charge, par un conseil de tutelle dont il ne peut être membre. Dans ce cas, le tuteur légal est tenu, entre autres obligations, de dresser un inventaire des biens, de rendre compte de sa gestion et de fournir une sûreté.
La tutelle dative (nommé par le parent ou le tribunal)
Les parents (père et mère) peuvent nommer eux-mêmes un tuteur à leurs enfants mineurs, soit par testament, soit par une déclaration au Curateur public. Cette désignation prend effet seulement au moment où l’enfant se retrouve sans père ni mère apte à prendre soin de lui. En cas d’absence de désignation ou encore de refus ou d’inaptitude des personnes désignées, c’est le tribunal qui nomme un tuteur. Le tuteur datif devient le représentant légal de l’enfant mineur. Il est assisté, dans l’exécution de sa charge, par un conseil de tutelle.
Un conseil de tutelle est nécessaire dans tous les cas de tutelle dative. Entre autres obligations, la loi impose au tuteur datif du mineur de dresser un inventaire des biens, de rendre compte de sa gestion et de fournir une sûreté.
L’INAPTITUDE
La loi protège aussi la personne majeure qui n’est pas apte à prendre soin d’elle-même en raison d’une incapacité quelconque.
En l’absence d’un mandat en cas d’inaptitude, les règles applicables sont déterminées en fonction du degré d’inaptitude. Comme nous le verrons ci-dessous, selon le cas, c’est un tuteur, un curateur ou un conseiller au majeur qui sera nommé.
Un représentant légal veille alors au bien-être de la personne protégée, administre ses biens avec prudence, diligence et compétence, et l’assiste dans tous ses actes civils. Toute décision concernant cette personne doit être prise dans son intérêt, dans le respect de ses droits et en vue de sauvegarder son autonomie. Le représentant légal est assisté, dans l’exécution de sa charge, par un conseil de tutelle.
Tuteur : si le besoin de protection est partiel ou temporaire
C’est un tuteur au majeur qui est le représentant légal d’une personne partiellement ou temporairement inapte à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens. L’étendue des responsabilités du tuteur est déterminée par le jugement de tutelle qui l’a nommé. La tutelle concerne soit :
- la personne et les biens;
- la personne seulement;
- les biens seulement.
Curateur : si le besoin de protection est total
C’est un curateur au majeur qui est le représentant légal de la personne ayant besoin d’être représentée dans tous les actes de sa vie, en raison de son inaptitude totale et permanente.
LE CONSEIL DE TUTELLE
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le curateur ou le tuteur au majeur est assisté, dans l’exécution de sa charge, par un conseil de tutelle. Composé de trois membres et d’un secrétaire, ce conseil est nommé par une assemblée de parents (autrefois le conseil de famille) convoquée par un greffier (représentant judiciaire auparavant appelé protonotaire) ou un notaire.
Le rôle du conseil de tutelle consiste à surveiller la tutelle et à vérifier la bonne administration des biens. Ses devoirs consistent notamment à :
- se réunir au moins une fois l’an et à inviter le représentant légal à ses délibérations;
- s’assurer que le représentant légal fait l’inventaire des biens de la personne et, si leur valeur excède 25 000 $, qu’il fournisse et maintienne une caution;
- recevoir le rapport annuel du représentant légal;
- donner son avis au tribunal sur la rémunération du représentant légal;
- demander au tribunal le remplacement du représentant légal s’il ne respecte pas ses obligations.
AUTRE RÉGIME DE PROTECTION
Conseiller au majeur : conseils ou assistance
Ce régime est mis en place lorsqu’une personne apte à administrer ses biens et à prendre soin d’elle-même a cependant besoin d’être conseillée ou assistée pour certains actes relatifs à l’administration de ses biens.
C’est uniquement un membre de la famille ou un proche de la personne concernée qui peut assumer cette fonction. Le conseiller au majeur n’administre pas les biens de la personne et n’est pas un représentant légal.
LE CURATEUR PUBLIC
Le Curateur public est nommé par le tribunal à titre de représentant légal d’une personne inapte lorsque cette dernière n’a pas de famille ou que ses proches ne peuvent ou ne veulent pas assumer cette fonction.
Ainsi, selon le degré d’inaptitude et la situation de la personne, le Curateur public peut être nommé :
- tuteur (inaptitude partielle ou temporaire);
- curateur (inaptitude totale ou définitive);
- représentant légal de la personne et de ses biens;
- représentant légal de ses biens seulement, alors qu’une personne de l’entourage du majeur protégé est choisie comme responsable de son bien-être physique et moral.
Le Curateur public a le mandat d’informer le tuteur ou le curateur au majeur de ses obligations et de l’assister dans son rôle de représentant légal, tout en supervisant son administration.
De plus, il surveille la gestion de tous les tuteurs datifs et légaux qui gèrent un patrimoine excédant 25 000 $.
Notre régime juridique nous permet de nommer diverses personnes pour agir en notre nom lorsque nous ne nous sommes plus en mesure de le faire. Il existe des différences importantes quant aux rôles et aux responsabilités de ces intervenants, que nous avons commencé à expliquer dans la chronique précédente. Aujourd’hui, nous traitons des rôles du tuteur et du mandataire. La troisième et dernière chronique sera consacrée aux régimes de protection.
LE TUTEUR
Le tuteur est la personne qui doit agir pour le bénéfice d’un enfant mineur (c’est-à-dire âgé de moins de 18 ans) ou d’une personne considérée inapte par la loi. Le parent d’un enfant est automatiquement son tuteur, sauf s’il est déchu de son autorité parentale.
Il est maintenant possible de désigner un tuteur par testament. En l’absence de testament, le tuteur sera nommé par le tribunal.
Au décès du dernier parent de l’enfant, la personne nommée sera appelée à agir au nom de ce dernier, à administrer ses biens et à veiller à son bien-être.
Le rôle du tuteur en est un de simple administration par opposition à celui de pleine administration, ce qui signifie que c’est la protection du patrimoine plutôt que l’accroissement de sa valeur qui lui incombe. De fait, le tuteur a davantage un rôle de conservateur du patrimoine qu’il doit remplir jusqu’à ce que le mineur puisse légalement assumer la gestion de ses biens, soit jusqu’à ce qu’il ait 18 ans, âge légal de la majorité.
Il faut noter que la loi prévoit certaines formalités strictes et parfois contraignantes dans le cas d’un héritage de plus de 25 000 $ à un bénéficiaire mineur.
La nomination d’un fiduciaire peut alléger considérablement la charge d’un tuteur en lui évitant de se soucier des finances de l’enfant mineur qui hérite. En pareil cas, il n’a qu’à veiller au bien-être physique et moral de ce dernier.
LE MANDATAIRE
Un mandataire est une personne chargée d’en représenter une autre dans l’exécution de certains actes. Les pouvoirs du mandataire en sont de simple administration, sauf si le mandant (c’est-à-dire la personne qui donne le mandat) a prévu des pouvoirs plus étendus.
LE MANDAT EN CAS D’INAPTITUDE
Le mandat en cas d’inaptitude a pour but de confier à un mandataire des pouvoirs précis advenant le cas où une personne est incapable d’assurer sa propre protection ou d’administrer elle-même ses biens.
Même si la loi prévoit différents régimes de protection pour une personne majeure, cette dernière peut déterminer elle-même d’avance les paramètres de son propre régime de protection, pour autant qu’elle possède toutes ses facultés.
Comme le testament n’est valide et ne peut être pris en considération qu’au jour du décès, la famille immédiate (conjoint, enfants) ou les proches (amis, collègues) d’une personne ne sont pas automatiquement autorisés à gérer ses biens ou ses finances en cas d’inaptitude. En pareilles circonstances, il faut une autorisation du tribunal.
La rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude permet donc de choisir nous-même la personne (le mandataire) qui agira pour nous en cas d’inaptitude. On évite ainsi de laisser cette décision à l’arbitraire de parents, d’amis ou d’un avocat du ministère
de la Justice. Toutefois, le mandataire ne pourra exercer ses responsabilités que lorsqu’il se sera présenté devant un tribunal pour faire constater l’inaptitude du mandant. C’est ce qu’on appelle « l’homologation de mandat ».
Le mandat du mandataire peut prendre fin pour plusieurs raisons, notamment en cas de :
- décès du mandant ou du mandataire;
- révocation du mandat par le mandant qui n’est plus inapte;
- renonciation du mandataire.
LE MANDATAIRE PAR PROCURATION
Il est également toujours possible, pour une personne pleinement lucide, de se faire représenter par quelqu’un d’autre. Dans ce cas, c’est un mandat ou une procuration qui précise l’étendue des pouvoirs accordés au mandataire.
Un tel document permet de nommer une personne qui nous représente, agit en notre nom ou administre nos biens, même si nous sommes parfaitement en mesure de le faire. Le pouvoir ainsi délégué peut être général ou spécifique, et il est très important d’en confier l’exercice à une personne de confiance.
Contrairement au mandat en cas d’inaptitude, le mandat par procuration permet d’agir immédiatement, sans autres formalités.
Le mandat du mandataire peut prendre fin pour plusieurs raisons, notamment en cas de :
- décès du mandant ou du mandataire;
- révocation du mandat par le mandant;
- renonciation du mandataire.
CONCLUSION
Comme nous l’avons vu dans cette chronique et dans la précédente, il est possible de nommer une ou plusieurs personnes (individu ou société) pour assurer, seules ou avec d’autres, l’administration de nos biens en cas d’inaptitude ou de décès. Le choix d’un liquidateur, d’un fiduciaire, d’un tuteur ou d’un mandataire doit donc se faire judicieusement et, surtout, il faut s’assurer au préalable que la personne choisie (le mandataire) sera apte à agir en notre nom et surtout, qu’elle acceptera de le faire.
En terminant, il est très important de rappeler que, selon le Code civil du Québec :
- la simple administration porte sur la conservation des biens, la perception des revenus qu’ils génèrent ainsi que l’investissement des sommes confiées dans des véhicules de placement présumés sûrs;
- la pleine administration des biens comprend non seulement leur conservation, mais également l’obligation de les faire fructifier; il faut alors agir avec prudence, diligence et loyauté, et prendre toutes les mesures nécessaires à l’accroissement du patrimoine, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire.
Compte tenu de l’importance des responsabilités et des conséquences inhérentes à la décision de déterminer à l’avance qui pourrait administrer nos biens, il faut prendre ce droit très au sérieux et l’exercer le plus tôt possible dans la vie, personne n’étant en mesure de préciser le moment où il faudra malheureusement s’en prévaloir.
Notre régime juridique prévoit la possibilité de nommer diverses personnes pour agir en notre nom lorsque nous ne nous sommes plus en mesure de le faire. Comme il existe des différences importantes quant aux rôles et aux responsabilités de ces intervenants, nous les aborderons dans le cadre de trois chroniques dont la première traite des rôles du liquidateur et du fiduciaire.
Le liquidateur
Autrefois appelé « exécuteur testamentaire », le liquidateur est la personne chargée de veiller à l’exécution des volontés d’une personne décédée, tout en protégeant les intérêts des héritiers.
Règle générale, son rôle en est un de simple administration, mais il peut être plus large si le défunt en a décidé ainsi dans son testament. Le liquidateur commence son travail au moment du décès et le termine à l’occasion du partage des biens entre les héritiers.
Comme la loi permet de désigner un ou plusieurs liquidateurs dans un testament, il est possible de prévoir plusieurs personnes pour liquider sa succession. Chacune d’elles se voit alors confier les tâches que ses compétences particulières lui permettent d’exécuter le plus efficacement.
Le choix du liquidateur revêt une grande importance, car il doit assumer diverses responsabilités légales et fiscales. Outre les arrangements funéraires et l’obtention du certificat de décès, il doit notamment :
- ouvrir un compte dans une institution financière;
- s’assurer, en effectuant des recherches auprès du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, que le testament est bel et bien le seul (ou le dernier) de la personne décédée;
- faire homologuer le testament, s’il y a lieu;
- identifier les héritiers;
- faire l’inventaire de la succession;
- évaluer les biens;
- préparer les déclarations de revenus;
- payer les dettes et recouvrer les créances;
- administrer les biens de la succession jusqu’au partage;
- effectuer le partage des biens après avoir obtenu le certificat de décharge requis par les lois fiscales.
Le Code civil prévoit que tout liquidateur, qu’il soit ou non l’un des héritiers, a droit au remboursement des dépenses engendrées par ses fonctions. S’il n’est pas l’un des héritiers, il a également droit à une rémunération. S’il est héritier, il peut être rémunéré, à la condition que le testament le prévoit ou que les héritiers le décident. Si la rémunération n’a pas été fixée par le testateur, elle l’est par les héritiers ou encore par le tribunal, en cas de désaccord entre ces derniers. Il est donc préférable que le testament soit clair et précis sur la rémunération du liquidateur, laquelle constitue un revenu imposable.
En l’absence de testament, tous les héritiers sont responsables de l’administration des biens. Ils peuvent cependant choisir de désigner, à la majorité des voix, un liquidateur de la succession.
Enfin, il faut rappeler que seule une société de fiducie peut agir à titre de liquidateur d’entreprise.
Le fiduciaire
Le fiduciaire est une personne, physique ou morale, désignée pour assurer la gestion du patrimoine fiduciaire.
La fiducie peut être « entre vifs » afin de protéger des actifs et de fractionner des revenus avec des bénéficiaires majeurs. La création de ce genre de fiducie est constatée dans un document juridique (l’acte de fiducie) qui contient les dispositions voulues par le constituant de la fiducie.
La fiducie peut également être « testamentaire ». Elle est alors créée dans le cadre d’un testament, au moyen d’un legs en fiducie. Il ne faut pas confondre les biens en fiducie avec le compte en fiducie qui est un contrat entre une institution financière et une personne agissant pour une autre.
Même si les biens en fiducie n’appartiennent pas au fiduciaire, ce dernier doit les administrer. Ce travail est assujetti aux règles légales pertinentes. Le fiduciaire a notamment la responsabilité de protéger le patrimoine fiduciaire et de le faire fructifier pendant la durée de la fiducie. Il doit agir de façon prudente et diligente, conformément aux dispositions énoncées par l’auteur de la fiducie, et toujours dans l’intérêt du ou des bénéficiaires.
Dans le cas d’une fiducie testamentaire, le fiduciaire commence son travail au moment de la création de la fiducie, c’est-à-dire au moment où le liquidateur lui remet le legs en fiducie. Son rôle prend fin lors de la distribution des biens au(x) bénéficiaire(s) du capital, au moment prévu dans le testament.
De toute évidence, la charge d’un fiduciaire s’étend sur une période plus longue que celle d’un liquidateur.
Le bénéficiaire d’une fiducie ne peut en être le seul fiduciaire, mais il peut agir à titre de cofiduciaire. Plusieurs fiduciaires peuvent être nommés. Le cas échéant, ils prendront leurs décisions à l’unanimité ou à la majorité des voix.
Les biens en fiducie constituent un patrimoine distinct de ceux du constituant de la fiducie, du fiduciaire et du ou des bénéficiaires. La fiducie constitue donc un patrimoine propre et distinct qui n’appartient à personne.
Le legs de biens en fiducie permet de soustraire le patrimoine légué aux règles de la curatelle et de la tutelle. Il permet plus de souplesse sur le plan de l’administration, car les pouvoirs d’un fiduciaire sont plus étendus que ceux d’un tuteur.
Dans la prochaine chronique, nous aborderons les rôles du tuteur et du mandataire.
Un cas concret permet de constater que le fractionnement du revenu est une approche toute simple qui génère des économies d’impôt intéressantes sur une longue période de temps.
Comparons la situation où l’imposition des revenus est répartie sur deux contribuables plutôt qu’un seul. Les résultats sont non négligeables puisque l’avantage fiscal annuel de 3 700 $ (obtenu grâce au fractionnement) peut représenter plus de 86 100 $ après 15 ans, moyennant un taux de rendement de 6 %.
En effet, le retrait minimum obligatoire du FERR (calculé en fonction de la valeur accumulée en fin d’année) fait en sorte d’augmenter le taux d’imposition du particulier ayant une valeur importante, par rapport à celui qui aurait un montant peu élevé dans son REER au moment de sa conversion en FERR.
De plus, une valeur de portefeuille similaire, pour le couple, permettrait d’éviter le remboursement de la pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) applicable à celui dont le revenu total, incluant le retrait minimum du FERR, excède le seuil de remboursement d’une partie de la PSV établi à 57 879 $ (en 2003). Ainsi, en considérant la PSV, la somme accumulée après impôt représente une somme supplémentaire de 167 600 $ au terme de la même période.
| Âge des conjoints : 48 ans |
Sans fractionnement
|
Avec fractionnement
|
| Placement actuel |
400 000 $
|
150 000 $
|
400 000 $
|
150 000 $
|
| Cotisation annuelle sur 12 ans |
14 500 $
|
6 000 $
|
0 $
|
20 500 $
|
| Valeur accumulée à 60 ans (à 6 %)* |
1 050 000 $
|
403 000 $
|
805 000 $
|
648 000 $
|
| Retraits annuels de 60 à 69 ans pour assumer les dépenses courantes |
40 000 $
|
40 000 $
|
40 000 $
|
40 000 $
|
| Solde accumulé à 69 ans (à 6 %)* |
1 295 000 $
|
173 000 $
|
857 000 $
|
610 000 $
|
| Retrait minimum requis à 71 ans* |
96 500 $
|
12 900 $
|
63 800 $
|
45 500 $
|
| Taux d’impôt moyen estimé |
35 %
|
7 %
|
30 %
|
26 %
|
| Montant net après impôt* |
63 200 $
|
11 200 $
|
44 700 $
|
34 300 $
|
Total combiné
PSV potentielle pour Monsieur après impôt
Total
|
74 700 $
0 $

74 700 $
|
78 400 $
3 500 $

81 900 $
|
Écart favorable
Somme accumulée en surplus après 15 ans (à 6 %)*
|
7 200 $

167 600 $
|
Bien entendu, cette stratégie doit être envisagée si vous prévoyez que les revenus de votre conjoint seront moins élevés que les vôtres. Dans certains cas, une analyse s’impose. Par exemple, si l’un des conjoints dispose d’un régime de retraite de l’employeur et qu’une rente lui sera versée à la retraite, cet élément de revenu de retraite doit être pris en compte. Le cas échéant, d’autres techniques devraient être envisagées, dont les retraits du REER dans des proportions différentes, au moment de la retraite, afin d’équilibrer le plus possible les revenus imposables de chacun. D’autre part, il pourrait être approprié qu’un des conjoints effectue des retraits avant l’âge de 69 ans (soit l’âge limite de conversion du REER en FERR) afin de réduire le retrait minimum obligatoire du FERR qui, dans certaines situations, permettrait de limiter le montant en-dessous du seuil où il faudrait rembourser la PSV1.
CONCLUSION
Le fractionnement de revenu, à même le REER du conjoint, s’avère parfois une excellente méthode pour réduire la charge fiscale du couple lors de la retraite et prolonger la sécurité financière à long terme. Pourquoi ne pas profiter dès maintenant de cette façon de faire si simple et profitable?
Rappelons en terminant que, depuis plusieurs années, les prestations de la Régie des rentes du Québec (RRQ) peuvent également être divisées entre les conjoints, lorsque les deux (2) ont au moins 60 ans, pour réduire le fardeau fiscal.
| 1 |
En prenant pour acquis que la PSV existerait toujours dans sa forme actuelle. |
Le fractionnement du revenu est une stratégie financière qui consiste à réduire la charge fiscale de sa famille en lui faisant économiser de l’argent au moyen d’une méthode toute simple : attribuer une partie du revenu d’une personne dont le taux d’imposition est élevé à un autre membre de la famille qui, lui, jouit d’un taux d’imposition moindre. En fractionnant ainsi le revenu familial, il est possible de réduire la facture fiscale et, conséquemment, d’augmenter le revenu net du couple.
En général, la question du fractionnement du revenu est soulevée au moment où on réalise que les revenus de retraite de l’un des conjoints seront beaucoup plus importants que ceux de l’autre. On s’interroge alors sur la façon de transférer des revenus imposables entre les mains de celui qui est le moins imposé. Il faut malheureusement souligner, dès le départ, que le transfert de fonds de REER au profit d’un conjoint n’est possible qu’en cas de décès ou de dissolution du mariage.
Cette stratégie, malheureusement sous utilisée, devrait être envisagée tôt, pendant la vie active, de sorte que les deux conjoints touchent des revenus équivalents, qu’ils réalisent des économies d’impôt substantielles et qu’ils disposent au bout du compte d’un revenu net total nettement plus élevé.
Un particulier peut contribuer au REER de son conjoint (incluant le conjoint de fait et le conjoint de même sexe) même si ce dernier ne gagne aucun revenu ni ne possède de droits accumulés dans un REER. Le conjoint qui contribue profite de la déduction dans l’année sans mettre en péril son maximum de cotisation personnelle, tandis que le conjoint qui reçoit la contribution sera imposé lorsque les fonds seront retirés1. Le fait de cotiser dans le REER du conjoint n’empêche nullement ce dernier de cotiser à son propre REER, selon son revenu gagné.
Les sommes versées dans le REER d’un conjoint lui appartiennent de plein droit et réduisent celles susceptibles de l’être dans le REER de celui qui contribue. Toutefois, les conjoints mariés bénéficient d’une certaine protection, car les REER font partie du patrimoine familial et doivent être partagés en cas de dissolution de leur union. Par conséquent, les sommes accumulées dans le REER au cours d’une union de fait ne donnant aucunement droit à un partage en cas de rupture du couple.
| 1 |
Sauf pour les sommes versées dans le régime qui sont retirées dans les deux (2) ans suivant la fin de l’année où elles ont été versées; ces sommes seront incluses dans le revenu du conjoint cotisant. Ainsi, pour les 3 premières années, on a tout intérêt à retirer des montants cotisés à son propre REER (règle des 3 ans). |
| 2 |
La convention de conjoint de fait devrait évidemment prévoir un certain nombre d’autres points relatifs au partage à la dissolution. |
Toute somme versée dans le REER d’un conjoint de fait lui appartenant, il peut en disposer à sa guise car il en devient l’unique propriétaire; d’où notre recommandation d’en prévoir les conséquences et de signer une convention2 à cet effet.
Exemple
Comme le démontre le tableau ci-dessous, un revenu avant impôt de 100 000 $ (en supposant qu’il s’agisse du revenu brut nécessaire pour maintenir votre niveau de vie à la retraite), imposé sur un (1) contribuable, représente un impôt total d’environ 35 900 $.
Le même revenu imposé sur deux (2) contribuables (vous et votre conjoint), à raison de 50 000 $ chacun, générerait un impôt total conjoint d’environ 27 400 $, soit 13 700 $ chacun. Outre l’économie annuelle conjointe de 8 500 $ qu’elle permet, cette façon de faire vous permettrait de bénéficier du crédit d’impôt pour revenus de pension pour les deux (2) conjoints.
AVANTAGES FISCAUX DU FRACTIONNEMENT SELON LES REVENUS IMPOSABLES D’UN COUPLE
Revenu annuel du couple
à la retraite |
Impôt personnel estimé* |
Impôt total
pour le couple |
Écart favorable généré par le fractionnement |
| Vous |
100 000 $ |
Vous |
35 900 $ |
35 900 $ |
sans objet |
| Votre conjoint |
0 $ |
Votre conjoint |
0 $ |
| Vous |
50 000 $ |
Vous |
13 700 $ |
27 400 $ |
8 500 $ |
| Votre conjoint |
50 000 $ |
Votre conjoint |
13 700 $ |
| Vous |
80 000 $ |
Vous |
26 700 $ |
29 700 $ |
6 200 $ |
| Votre conjoint |
20 000 $ |
Votre conjoint |
3 000 $ |
|
| * |
Sommes arrondies à la centaine de dollars et calculées en fonction du crédit personnel de base et du crédit pour montant forfaitaire selon le régime simplifié du Québec en 2003. |
Dans la prochaine chronique, nous aborderons un cas concret qui illustre la simplicité du fractionnement du revenu et les économies d’impôt intéressantes qu’il génère sur une longue période de temps.
LA « MISE À PART » DE L’ARGENT, UNE STRATÉGIE FISCALE INTÉRESSANTE POUR LE TRAVAILLEUR AUTONOME
Fiscaliste bien connu, le président du Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF), M.Yves Chartrand, a publié, en avril 2003, un texte sur une stratégie dont le potentiel est apparemment illimité.
Accessible aux travailleurs autonomes non incorporés, aux particuliers propriétaires d’immeubles locatifs et aux associés d’une société en nom collectif, cette stratégie permettrait de transformer des intérêts non déductibles (par exemple, sur l’hypothèque grevant la résidence principale) en intérêts déductibles. La stratégie de M. Chartrand est fondée sur un jugement rendu par la Cour suprême en 2001 et appuyée par une réponse favorable de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à une demande de décision anticipée qu’il a lui-même déposée, en décembre 2002.
Cette stratégie repose essentiellement sur deux éléments, en l’occurrence 1) des dépenses d’exploitation et 2) des dettes personnelles dont les intérêts ne sont pas déductibles.
En pratique, la «mise à part» de l’argent est une technique en vertu de laquelle le contribuable conserve ses liquidités afin de payer ses dépenses personnelles, incluant ses emprunts pour lesquels les intérêts ne sont pas déductibles, tandis que les dépenses dont les intérêts sont déductibles en cas d’emprunt sont effectivement financées par ce moyen.
Pour se prévaloir de cette technique, il faut ouvrir des comptes bancaires distincts, l’un pour les dépenses, l’autre pour les recettes de l’entreprise. Les revenus de l’entreprise serviront à assumer les dépenses courantes, incluant les dettes personnelles. Un autre compte comportant une marge de crédit ou tout autre emprunt sera affecté au paiement des dépenses d’affaires. Il est important, voire essentiel que ce compte ne soit pas « contaminé », c’est-à-dire qu’il ne serve pas à défrayer des dépenses à des fins personnelles. En effet, les dispositions de la loi de l’impôt relatives à la déductibilité des intérêts édictent que l’argent emprunté doit être utilisé spécifiquement à des fins admissibles.
Ceci signifie que les dettes dont les intérêts ne sont pas déductibles seront payées avec les revenus bruts (c’est-à-dire avant les dépenses d’affaires) déposés dans un compte « recettes »; ces dettes étaient auparavant payées à même les revenus nets (c’est-à-dire après les dépenses d’affaires). D’autre part, un compte « débours » servira exclusivement à payer les dépenses d’exploitation de l’entreprise, soit des dépenses « admissibles » aux fins de la déduction des intérêts.
Ce faisant, un travailleur autonome pourra convertir progressivement tous ses emprunts dont les intérêts sont non déductibles aux fins fiscales en emprunts dont les intérêts le seront entièrement.
Selon M. Chartrand, cette technique pourrait être utilisée dans plusieurs situations : la récupération de cotisations inutilisées au REER, le paiement des impôts en retard, le règlement du solde de la carte de crédit, le prêt auto, etc.
Exemple
Prenons à titre d’exemple, un médecin dont la situation se résume comme suit :
|
Chiffres d’affaires (revenus professionnels) |
200 000 $ |
|
Dépenses d’exploitation |
(50 000) $ |
|
|
|
Revenu net avant impôts |
150 000 $ |
|
Impôts approximatifs |
(60 000) $ |
|
|
|
Liquidités annuelles pour assumer les dépenses
courantes (incluant hypothèque et dettes personnelles) |
90 000 $ |
|
|
|
Hypothèque sur la résidence |
100 000 $ |
En utilisant la « mise à part » de l’argent, le professionnel en question aura deux comptes de banque pour l’entreprise : l’un pour les recettes (200 000 $ par année), l’autre pour les débours de l’entreprise (50 000 $ par année).
Ainsi, les recettes (revenus professionnels) seront utilisées pour assumer les dépenses courantes (90 000 $), les impôts (60 000 $) et l’hypothèque
(100 000 $). Le compte « débours », comprenant une marge de crédit autorisée de 100 000 $, augmentera à chaque dollar remboursé sur le prêt hypothécaire actuel.
La conversion devra être effectuée après deux ans, l’emprunt de 100 000 $ correspondant à deux années de dépenses d’exploitation. Utilisée à 50 % la première année et à 100 % la seconde, la marge de crédit permettra de déduire les intérêts afférents désormais entièrement déductibles, et ce, durant toute la période d’amortissement de la marge de crédit, car l’emprunt sera effectué à des fins admissibles, la marge ayant servi à gagner un revenu d’entreprise.
Par la suite, il sera possible de convertir la marge de crédit en prêt hypothécaire et de continuer à déduire la charge d’intérêts sur cet emprunt au fil des années, selon la durée restante de l’emprunt (5, 10, 15 ou 20 ans). Dans le présent cas, il pourra en résulter des économies intéressantes puisque les intérêts payés sur une hypothèque de 100 000 $ à 6 % sur 20 ans totaliseront plus de 75 600 $.
Pour le contribuable, on calcule des épargnes de 36 000 $ à un taux d’impôt marginal de 48,2 %, et ce, sans trop d’efforts.
Plus les dépenses d’affaires du travailleur autonome seront élevées, plus vite la stratégie sera complétée.
CONCLUSION
Consulter son planificateur financier avant d’utiliser cette stratégie est une sage décision, car aussi attrayante soit-elle, elle doit être l’objet d’un examen rigoureux. Il faudra par exemple procéder au partage du patrimoine familial en cas de séparation ou de divorce. En effet, pendant l’utilisation du compte « recettes» pour régler l’hypothèque sur la résidence, la marge de crédit « affaires » augmentera d’autant. Or, comme celle-ci ne constitue pas une dette réduisant la valeur du patrimoine familial, il pourrait en résulter un accroissement important au profit de l’autre conjoint(e), compte tenu de l’hypothèque initiale.
La stratégie de « mise à part » de l’argent n’est pas accessible au salarié, celui-ci ne faisant aucune dépense d’affaires.
Si vous êtes intéressée(e) à approfondir cette question, communiquez avec nous. Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer un bulletin fiscal explicatif.
En raison des taux d’intérêt relativement bas et de l’augmentation de la valeur des propriétés, plusieurs personnes songent à utiliser leur hypothèque pour rembourser certaines dettes dont les taux d’intérêt sont élevés (cartes de crédit, prêts à la consommation, etc…), pour rénover la maison ou encore pour investir dans des REER ou d’autres placements.
Il s’avère possible de profiter de l’évaluation à la hausse de sa maison, car les prêteurs consentent généralement des prêts représentant jusqu’à 75 % de la valeur de la propriété. En pratique, le refinancement hypothécaire consiste à emprunter un montant supérieur au solde dû afin de libérer des capitaux (communément appelé « l’équité ») susceptibles d’être utilisés par l’emprunteur comme bon lui semble.
Les établissement bancaires proposent aussi certaines options qui combinent prêt hypothécaire et marge de crédit afin de donner accès à des liquidités, à des conditions avantageuses. Souple, la marge de crédit (préautorisée) avec garantie hypothécaire offre un prêt en main sans avoir à solliciter l’institution chaque fois que l’emprunteur a besoin de financement, les fonds étant libérés sans autre formalité.
Aussi séduisant que soit le refinancement hypothécaire, il faut être très prudent avant de s’en prévaloir. Il faut impérativement en évaluer les avantages, prévoir les coûts inhérents à la transaction et déterminer avec précision sa capacité de remboursement.
Depuis les changements apportés au Code civil du Québec, en 1994, certains actes hypothécaires permettent une majoration du solde sans qu’il soit nécessaire de passer chez le notaire. Auparavant, un nouvel acte hypothécaire notarié était nécessaire, ce qui occasionnait des frais importants. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que des frais d’évaluation et des pénalités pourraient être exigés, si le terme du prêt n’était pas arrivé à échéance. Dans certains cas, il est possible de renouveler avant terme et d’obtenir un taux pondéré qui tienne compte à la fois du taux d’intérêt en vigueur et de celui de l’hypothèque.
REFINANCER POUR CONTRIBUER AU REER ?
Pour une personne qui ne possède pas les fonds nécessaires pour contribuer à son REER et qui dispose de contributions inutilisées, il pourrait être intéressant de le faire grâce à un refinancement hypothécaire. En effet, bien que les intérêts ne soient pas déductibles lorsque les placements sont effectués dans un REER, il en résulte un avantage certain en raison de la déduction fiscale et du rendement à l’abri de l’impôt.
Prenons l’exemple d’une somme de 52 000 $ (incluant les droits inutilisés) admissible au REER et d’une cotisation équivalente effectuée grâce à une augmentation du prêt hypothécaire existant.
D’une part, en supposant que le retour d’impôt (25 000 $ selon un taux marginal de 48 %) serait appliqué immédiatement à la diminution de l’emprunt, il faudrait verser quelque 3 500 $, en frais d’intérêt pour rembourser le solde de 27 000 $ à un taux hypothécaire de 5 %, amorti sur 5 ans. Les mensualités seraient d’environ 500 $.
D’autre part, la valeur accumulée du placement de 52 000 $ dans le REER totaliserait plus de 66 000 $, après la même période de 5 ans, si l’on tient compte d’un rendement de 5 %, soit une plus-value nette de 10 500 $ (c’est-à-dire 14 000 $ de rendement moins 3 500 $ en frais d’intérêt).
À plus longue échéance, en considérant un rendement fixe de 5 %, le même placement de 52 000 $ vaudrait environ 84 700 $ après 10 ans, et à plus de 108 000 $ après 15 ans.
REFINANCER POUR INVESTIR DANS DES PLACEMENTS NON ENREGISTRÉS ?
Dans certains cas, le refinancement pourrait rendre les intérêts déductibles d’impôts, alors que ce n’est pas le cas pour les intérêts versés sur un prêt accordé lors de l’achat d’une résidence personnelle.
Par exemple, réemprunter 52 000 $ sur sa propriété pour l’investir permettrait de déduire les frais d’intérêts, pourvu que l’argent soit utilisé à une fin admissible (par exemple, un placement dans le marché boursier). Deux jugements de la Cour suprême du Canada rendus dans les affaires Ludco et Singleton se sont avérés favorables aux contribuables, en facilitant ce genre de transactions sans pour autant refuser la déduction fiscale.
Par contre, lorsqu’on utilise l’effet de levier que constitue le financement des placements par emprunt, il faut s’attendre à ce que l’investissement rapporte plus qu’il n’en coûte. Souvent, cela peut signifier un risque accru qui ne convient pas à tous les types d’investisseur.
REFINANCER POUR INVESTIR DANS L’IMMOBILIER ?
Il est possible d’envisager l’achat d’un immeuble locatif et d’obtenir la mise de fonds nécessaire en refinançant sa maison, les intérêts déductibles s’appliquant à la totalité du prix payé.
Par exemple, l’achat d’un duplex de 200 000 $ est assorti d’une hypothèque de
150 000 $ (75 % de la valeur marchande). La différence, soit 50 000 $ obtenus à même le refinancement de la résidence personnelle (ou la marge de crédit hypothécaire obtenue), permettrait de déduire les intérêts sur 200 000 $. Ainsi, dans le cas d’un taux marginal d’imposition de 50 %, cela aurait pour effet de réduire de 50 % le coût réel de l’emprunt.
REFINANCER POUR REMBOURSER DES DETTES PERSONNELLES OU POUR RÉNOVER SA PROPRIÉTÉ ?
Le refinancement pourrait être une solution lorsque le niveau important d’endettement d’une personne est une source de stress et d’anxiété, voire d’angoisse. Par contre, une telle démarche ne doit pas devenir une incitation à consommer davantage, surtout si la personne endettée éprouve de la difficulté à gérer ses affaires. En pareille situation, la somme empruntée devrait être remboursée rapidement, et les habitudes de consommation, considérablement modifiées. Autrement dit, une meilleure discipline s’imposerait d’elle-même.
Quant au propriétaire qui prévoit des rénovations importantes à sa propriété, une augmentation de son prêt hypothécaire pourrait être envisagée pour financer les travaux, à moindre coût, vu les taux moins élevés.
CONCLUSION
Il existe différents produits sur le marché, dont les hypothèques à taux variables et la marge de crédit hypothécaire, en fonction des besoins de chacun. Généralement, les établissements prêteurs ciblent une clientèle dont le solde hypothécaire est faible, compte tenu de la valeur de la propriété, et qui jouit d’une bonne situation financière.
Il faut éviter de privilégier le refinancement de façon systématique et en vérifier la pertinence, car bien qu’il s’agisse d’une solution intéressante à première vue, cette stratégie peut s’avérer risquée et dénuée d’intérêt sur le plan financier. Par exemple, aussi attrayant qu’il puisse être sur le plan fiscal, le levier financier (qui consiste à emprunter pour investir) n’est pas recommandé à tous les investisseurs.
N’hésitez donc pas à consulter votre conseiller afin de bien évaluer tous les facteurs et de vous assurer d’en tirer des bénéfices concrets.
Comme l’illustre la figure ci-dessous, l’économie évolue généralement selon un cycle qui comprend quatre phases, soit 1) un creux, 2) une reprise (ou expansion), 3) un sommet, et 4) un ralentissement (ou récession).

Historiquement, bien que ce scénario se reproduise à intervalles réguliers, il s’avère difficile de prévoir la durée et l’ampleur des différentes phases d’un cycle, car des variations passagères peuvent masquer certaines tendances de fond qui influent considérablement sur ces éléments déterminants. Cette difficulté a été à l’origine de l’élaboration d’indices, appelés indicateurs économiques. Il s’agit de données compilées pendant une longue période de temps, puis analysées et classées, dans une tentative pour déterminer la situation d’un cycle et pour prévoir son évolution.
Ces indicateurs de marché ont été divisés en trois catégories, soit 1) les indicateurs retardataires, 2) les indicateurs simultanés et 3) les indicateurs précurseurs.
LES INDICATEURS RETARDATAIRES
Les indicateurs retardataires sont ceux qui réagissent après l’économie dans son ensemble. En d’autres mots, ils continuent soit à progresser en dépit du fait que d’autres indicateurs ont confirmé la fin d’un sommet économique, soit à régresser malgré le début d’une reprise.
L’inflation, les coûts de la main-d’œuvre, le niveau des stocks, le taux de chômage, de même que les dépenses des entreprises pour l’acquisition de nouvelles usines et de matériel, sont de bons exemples d’indicateurs retardataires.
En ce qui concerne l’inflation, elle ne permet pas d’établir la direction que prendra l’économie, mais seulement la façon dont le cycle évolue. En pratique, l’inflation augmente pendant qu’on approche du sommet du cycle, alors que l’économie roule déjà à fond. La raison en est fort simple : les entreprises produisent à pleine capacité tout en subissant des pressions en vue de hausser les salaires, ce qui les oblige à augmenter le prix de leurs marchandises afin de maintenir leurs marges de profit.
Depuis quelques mois déjà, les nouvelles économiques avancent que la reprise économique américaine ne pourra être confirmée que lorsque les entreprises auront recommencé à investir pour moderniser leurs installations et pour augmenter leur capacité de production. Cet indicateur étant retardataire, l’investisseur qui désire se positionner avant le début de la reprise ne peut se permettre d’attendre, d’autant plus que les entreprises n’envisagent des projets d’expansion qu’après avoir constaté une augmentation soutenue de la demande, soit au terme d’une période d’une année ou deux.
LES INDICATEURS SIMULTANÉS
Les indicateurs simultanés varient à peu près en même temps que l’économie dans son ensemble.
Ils comprennent, entre autres, le revenu des particuliers et les ventes au détail. Comme il faut cependant compter un certain temps avant que ces statistiques voient le jour, elles s’avèrent de piètres indicateurs pour l’investisseur qui veut se positionner en vue d’une reprise économique ou qui cherche à éviter une récession.
LES INDICATEURS PRÉCURSEURS
Indéniablement, les indicateurs les plus suivis sont ceux qui sont qualifiés de précurseurs, car ils laissent entrevoir une tendance avant même que l’activité économique ne le confirme. En principe, ils doivent donc permettre d’anticiper la direction que prendra l’économie au cours des mois à venir. Cependant, comme aucun indicateur n’est parfait, il est préférable que plusieurs indicateurs pointent dans la même direction avant de tirer quelque conclusion que ce soit.
Il faut également préciser que, lors de la publication d’un indicateur, les marchés financiers réagissent à sa déviation par rapport à la prévision qui faisait consensus au moment de sa sortie, et non pas en regard de la valeur de l’indicateur en tant que telle. Les marchés ne réagiront que s’il y a déviation par rapport aux valeurs anticipées, car les prix des actions et des obligations auront alors déjà évolué au cours des jours précédents, afin de tenir compte de la valeur prévue de l’indicateur.
Les deux premiers indicateurs précurseurs sont étroitement liés à la politique monétaire de la Banque centrale. La masse monétaire réelle (M1) est un indicateur précurseur (environ six mois) qui mesure la somme d’argent liquide (comptes bancaires et au comptant) dont disposent les consommateurs et les entreprises.
L’écart entre les taux d’intérêt à long terme et les taux d’intérêt à court terme constitue un autre indicateur précurseur (plus ou moins un an). Si la Banque centrale adopte une politique monétaire restrictive pour freiner une surchauffe de l’économie, elle haussera les taux d’intérêt à court terme. Ces derniers augmenteront davantage que ceux à long terme, provoquant du même coup un aplanissement de la courbe des taux. Celle-ci va parfois même jusqu’à s’inverser, les taux à court terme étant alors plus élevés que ceux à long terme. Une telle situation peut entraîner une diminution de la demande finale et déboucher sur une récession.
Calculé par Statistique Canada, l’indice composite des indicateurs avancés du Canada tient compte de dix indicateurs avancés, dont l’indicateur composite avancé des États-Unis et l’indice S&P/TSX de la Bourse de Toronto. La Bourse canadienne est effectivement un indicateur précurseur (au moins six mois) sur l’état de notre économie. Quant à l’indice composite, il permet de prévoir assez bien la direction que prendra l’économie, et ce, deux ou trois mois à l’avance. À la fin de l’été
2003, cet indicateur ne laissait toujours pas entrevoir de récession, mais incitait à conclure à une croissance économique modérée.
|
INDICATEUR
|
CATÉGORIE
|
MOUVEMENT
EN REGARD
DE CELUI DE
L’ÉCONOMIE
|
| Inflation |
Retardataire
|
Identique1
|
| Coût de la main d’œuvre |
Retardataire
|
Identique
|
| Niveau des stocks |
Retardataire
|
Inverse2
|
| Taux de chômage |
Retardataire
|
Inverse
|
| Dépenses des entreprises pour l’acquisition de nouvelles usines |
Retardataire
|
Identique
|
| Prêts commerciaux |
Retardataire
|
Identique
|
| Revenu des particuliers |
Simultané
|
Identique
|
| Ventes au détail |
Simultané
|
Identique
|
| Produit intérieur brut (PIB) |
Simultané
|
Identique
|
| Production industrielle |
Simultané
|
Identique
|
| Masse monétaire (M1) |
Précurseur |
Identique
|
| Écart entre les taux à long terme et ceux à court terme |
Précurseur |
Identique
|
| Indice composite des indicateurs avancés du Canada |
Précurseur |
Identique
|
| Indicateur composite avancé des États-Unis |
Précurseur |
Identique
|
| Indice S&P/TSX de la Bourse de Toronto |
Précurseur |
Identique
|
| 1 |
L’indicateur est à la hausse lorsque l’économie est à la hausse. |
| 2 |
L’indicateur est à la baisse lorsque l’économie est à la hausse.
|
Idéalement, le capital accumulé dans votre REER devrait y rester jusqu’au moment de votre retraite. Néanmoins, vous pouvez utiliser les sommes investies pour acheter une propriété ou pour retourner aux études, sans avoir à payer d’impôt sur vos retraits ?
EN PRINCIPE, TOUT MONTANT retiré de votre REER, que ce soit à la retraite ou avant, s’ajoute au revenu imposable de l’année. Cependant, il existe deux exceptions à cette règle. Il vous est possible, en effet, de puiser dans votre REER, sans payer d’impôt sur la sommes prélevée, pour financer l’achat d’une maison en vertu du Régime d’accession à la propriété (RAP), ou des études supérieures, grâce au Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP).
Dans un cas comme dans l’autre, le retrait total peut atteindre 20 000 $ et doit ensuite être remboursé graduellement. Il s’agit, en quelque sorte, d’un prêt que vous vous accordez à vous-même, sans intérêt, à même les fonds de votre REER ?
L’objectif est évidemment d’alléger le fardeau financier des contribuables qui veulent accéder à la propriété ou parfaire leur formation. Ceci étant dit, la loi ne vous impose aucune obligation quant à l’utilisation de cet argent « auto-emprunté ». Dans la mesure où vous êtes admissible à l’un ou l’autre de ces régimes, les sommes retirées peuvent servir, en tout ou en partie, à d’autres fins.
Pour acheter une maison
Le RAP a été mis en place en 1992 par le gouvernement canadien, qui décidait, deux ans plus tard, de le prolonger indéfiniment. Pour faciliter l’achat ou la construction d’une maison qui deviendra votre résidence principale, ce régime vous autorise à retirer, sans incidence fiscale, jusqu’à 20 000 $ de votre REER. Si vous faites l’acquisition d’une propriété avec votre conjoint, vous pouvez tous les deux retirer cette somme de vos REER respectifs et constituer ainsi une mise de fonds globale de 40 000 $.
Les conditions ? L’argent doit se trouver dans un REER depuis au moins 90 jours. En outre, ni vous ni votre conjoint ne devez avoir été propriétaire d’une résidence principale au cours des cinq dernières années. L’année en cours, que le retrait ait lieu en janvier ou en décembre, est alors considérée comme une année complète.
Si vous avez bénéficiez du RAP dans le passé, vous pouvez vous en prévaloir de nouveau, mais seulement si vous avez remboursé la totalité de votre retrait précédent et si vous n’avez pas été propriétaire au cours des cinq dernières années.
Vous disposez ensuite d’un délai de 15 ans pour réinvestir dans votre REER les sommes que vous y avez prélevées. Ce délai débute à compter de la deuxième année suivant celle du retrait; au moins 1/15 des sommes « rapées » doit être remboursé annuellement, à défaut de quoi une somme équivalant à ce remboursement minimal viendra s’ajouter à
votre revenu imposable de l’année en cours. Du reste, les autorités fiscales vous feront parvenir annuellement un avis faisant état du solde à remettre et du minimum exigible.
Toutefois, si vous en avez les moyens, vous pouvez commencer à rembourser pendant la période de grâce de deux ans. De même, il est recommandé de continuer à cotiser à votre REER, si possible, en plus d’y rembourser chaque année le montant minimal prescrit.
Pour étudier
Créé en 1999, le Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP) vous donne accès aux économies de votre REER afin que vous ou votre conjoint puissiez suivre une formation ou poursuivre des études à temps plein.
Vous pouvez ainsi retirer 10 000 $ par année, mais sans dépasser la limite de retrait total de 20 000 $ sur une période maximale de quatre ans. Comme votre conjoint peut adopter la même stratégie que vous, vos retraits combinés peuvent atteindre 40 000 $. Ces sommes doivent, une fois de plus, avoir été versées dans un REER depuis au moins 90 jours.
Vous (ou votre conjoint) devez, toutefois, être admis ou inscrit à un programme de formation ou d’enseignement supérieur :
- offert par un établissement d’enseignement reconnu;
- d’une durée minimale de trois mois consécutifs, et
- exigeant au moins 10 heures de cours ou de travaux par semaine.
Pour ce qui est du remboursement, vous devrez réinjecter chaque année dans votre REER au moins 1/10 de la somme retirée, car le délai de remboursement, plus bref que dans le cas du RAP, n’est que de 10 ans. Il débute à la plus rapprochée de ces deux dates :
- la deuxième année suivant la dernière année où vous étiez inscrit à un programme de formation admissible;
- la cinquième année suivant l’année de votre premier retrait.
Demandez l’avis de votre conseiller financier
Si vous faites des retraits en vertu de l’un de ces deux régimes, assurez-vous d’utiliser, parmi tous vos placements REER, ceux qui présentent le potentiel de rendement le plus limité.
Pour plus de détails sur le RAP ou le REEP, consultez votre conseiller financier ou le site de l’Agence des douanes et du revenu du Canada : www.ccra-adrc.gc.ca
| Vous détenez des parts du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec ?
Si oui, vous ne pouvez retirer cet investissement qu’en tout dernier recours; il vous faut d’abord liquider tous les autres placements REER que vous possédez par ailleurs.
|
Bientôt, les fameux « baby-boomers » entreront dans le troisième âge, ce qui devrait se traduire par une progression phénoménale de la demande de soins de santé. Les générations suivantes, moins imposantes, pourront-elles en éponger les coûts ? Non, répondait catégoriquement Jacques Légaré, professeur de démographie à l’Université de Montréal, lors d’une conférence qu’il a prononcée en avril dernier dans le cadre des rencontres organisées par Les Fonds d’investissement FMOQ inc.
La situation démographique du Québec se distingue de celle de ses voisins d’Amérique et de celle des pays européens. En effet, le baby-boum, cette poussée de la natalité observée entre 1946 et 1966, a atteint chez nous des proportions spectaculaires, inégalées dans tout l’Occident. En revanche, le déclin des naissances qui a suivi, aussi appelé baby bust, a été plus rapide et plus prononcé au Québec que partout ailleurs dans les pays industrialisés, à l’exception cependant de l’Italie, où le taux de natalité est encore plus faible que le nôtre. Rappelons que ce taux, qui s’établit à 1,5 enfant par femme, demeure nettement inférieur à l’indice de remplacement de la population, fixé à 2 enfants par femme. Autrement dit, on dénombre ici moins de naissances que de décès.
Les baby-boomers forment donc au Québec le plus large segment de population. Et, bien sûr, ils vieillissent. Leur poids démographique est tel en regard des autres générations, et la natalité est si chétive, que dans les décennies à venir, le quart environ des citoyens du Québec seront des personnes de 65 ans et plus. Or, à l’heure actuelle, le troisième âge ne représente que 9 % de la population.
« Examinons l’évolution de l’âge médian au Québec, nous propose le professeur Jacques Légaré. De quoi s’agit-il ? D’un âge charnière, au-dessus duquel se trouve la moitié de la population et au-dessous duquel se situe l’autre moitié. Eh bien ! l’âge médian était de 20 ans seulement chez nous, au début du 20e siècle. En 2051, l’âge médian de la population sera passé à 50 ans. »
Et tandis que gonfle la cohorte de personnes âgées, la population active, elle, ne cesse de décroître. En fait, les experts prévoient qu’il y aura chaque année davantage de nouveaux retraités que de nouveaux arrivants sur le marché de la main-d’œuvre, si bien que dans un demi-siècle, on recensera un travailleur pour un pensionné !
Manquons-nous de prévoyance ?
Ainsi, le nombre de contribuables salariés tend à diminuer graduellement, mais le nombre de bénéficiaires potentiels de programmes gouvernementaux destinés aux aînés va, quant à lui, grimper. D’ores et déjà, on peut s’attendre à ce que nos baby-boomers, en avançant en âge, réclament des services accrus de maintien à domicile, de soins de longue durée et d’hébergement, d’autant plus qu’ils sont susceptibles de vivre encore plus longtemps que leurs parents ! « Les progrès de la médecine et de la science étant ce qu’ils sont, explique le professeur Légaré, l’espérance de vie allonge continuellement. Du coup, la proportion des grands vieillards, soit les personnes de 80 ans et plus, augmentera. Actuellement, ces grands vieillards constituent 15 % de la population âgée de 65 ans et plus. Bientôt, ils en formeront plus du tiers ! Le problème, c’est que les coûts sociaux grandissent avec l’âge. Par exemple, pour subvenir aux besoins d’un grand vieillard l’État doit dépenser jusqu’à 25 000 $ par année, soit 10 000 $ de plus que pour une personne de 65 ans. »
Les prochaines générations disposeront-elles des ressources nécessaires pour faire face à une croissance aussi forte et aussi durable de la demande de soins de santé ? Évidemment non, selon le professeur Jacques Légaré, car ceux qui remplaceront les baby-boomers sur le marché du travail ne seront pas suffisamment nombreux et ils ne consentiront jamais à voir s’envoler une bonne part de leur salaire en impôt au profit de leurs aînés.
« Pourtant, s’étonne le démographe Légaré, notre société a fait preuve de prévoyance en matière de revenus de retraite. Nous avons compris assez rapidement que les programmes de rentes des gouvernements ne permettraient pas d’assurer aux baby-boomers un revenu de retraite décent. Aussi, toute une série de mesures ont été prises : majoration du taux de cotisation au Régime de rentes du Québec dans le but de constituer une réserve, incitation à l’épargne-retraite individuelle, sous forme de REER, et collective, sous forme de caisse d’entreprise (ou, si vous préférez, de fonds de pension), afin de diversifier les sources de revenus de retraite et de réduire notre dépendance aux prestations de l’État. Pourquoi ne pas nous préparer de la même façon à la flambée prévisible des coûts de la santé ? »
D’après le professeur Légaré, il conviendrait dès maintenant de créer une « caisse santé », c’est-à-dire accumuler une réserve en vue des décennies à venir, comme le font plusieurs pays européens. La question est lancée. Tout le débat reste à faire…
La présentation de cette conférence est disponible dans notre site Internet à l’adresse www.fondsfmoq.com