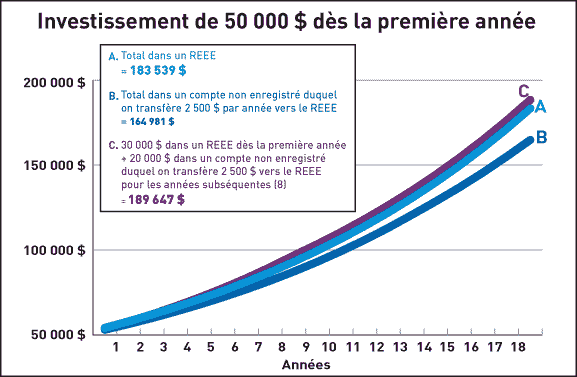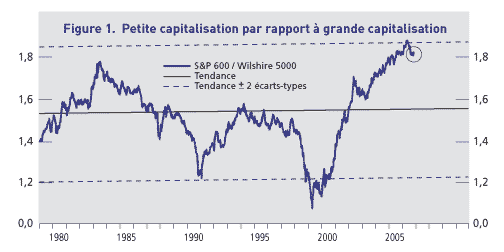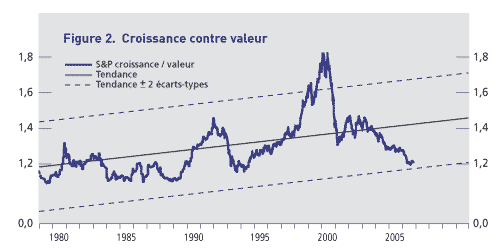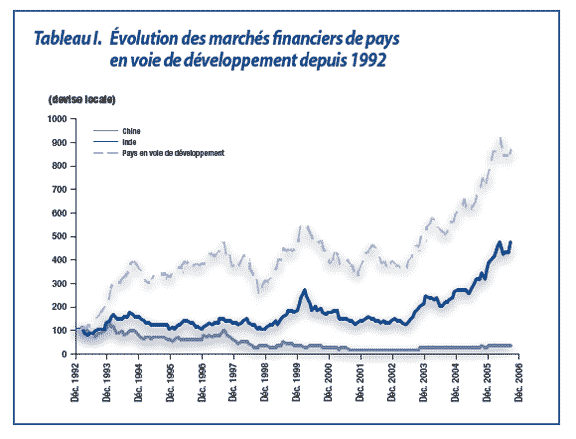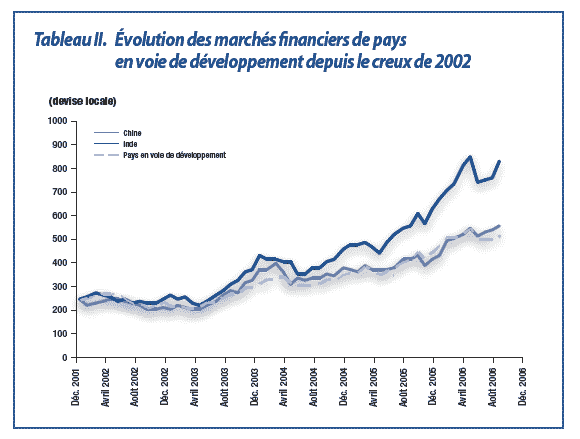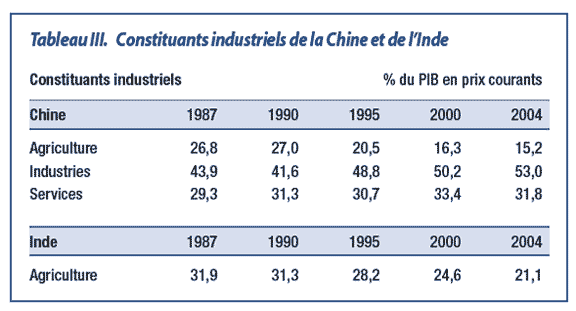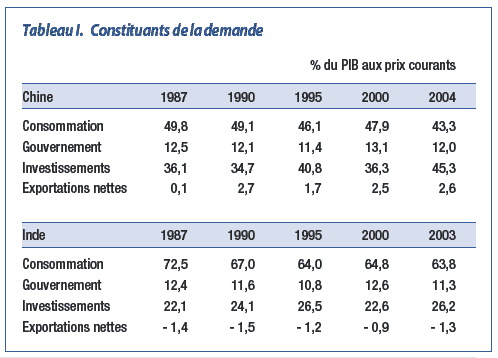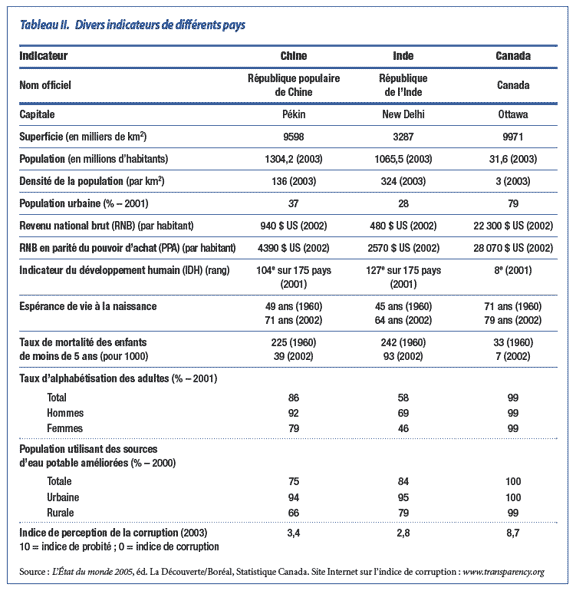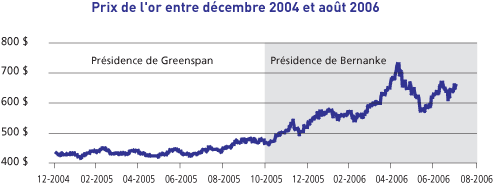Obtenir un rendement annuel de 30 %, au lieu de 10 %, simplement parce qu’on a emprunté 87 % du montant investi, est certes une idée est séduisante.
Pour multiplier ainsi le rendement, les investisseurs doivent utiliser l’« effet de levier », une stratégie qui repose sur un principe pouvant être formulé ainsi : « Il faut de l’argent pour faire de l’argent » ou «On peut faire de l’argent avec l’argent des autres ».
Les adeptes de cette stratégie avancent qu’un investisseur ayant 20 000 $ à placer pourrait obtenir un prêt « 2 pour 1 » qui lui permettrait d’injecter 60 000 $ (prêt de 40 000 $) dans un fonds commun de placement avec un rendement, par exemple, de 10 % par an. Au bout d’un an, il dégagerait un gain brut (avant le coût d’emprunt) de 6 000 $ (60 000 $ x 10 %).
Si l’emprunt était assorti d’un taux de 7 %, il devrait assumer une dépense en intérêts de 2 800 $ (40 000 $ x 7 %). Le gain net après les frais d’intérêt serait donc de 3 200 $, ce qui représenterait un rendement de 16 % en regard des 20 000 $ réellement investis. Le rendement de 10 % du fonds commun serait donc amplifié. En conséquence, plus on emprunte une grosse proportion de l’investissement, plus cet effet de levier est important.
Des exemples de ce genre, on en retrouve un peu partout. Le but de ceux qui les utilisent est fort simple : inciter des investisseurs à recourir à l’effet de levier. Il faut cependant savoir que la plupart des conseillers financiers sont rémunérés au moyen de commissions. Il est dès lors facile de comprendre qu’ils empocheront beaucoup plus en commissions s’ils parviennent à vous convaincre d’investir plusieurs fois la somme dont vous disposez. Comment? Par le biais d’un prêt levier! Par ailleurs, il est important de ne pas perdre de vue que l’établissement financier pour lequel ces « conseillers » travaillent empochera les intérêts que vous devrez payer sur l’emprunt.
Si ces commissions et ces intérêts sont assurés pour ceux qui vous « vendent » l’effet de levier, ce n’est pas du tout le cas du rendement sur vos investissements. Aussi, méfiez-vous de ce genre de calculs qui semblent si simples et si beaux!
Il est vrai que, pour certaines personnes qui ont fait appel à cette stratégie, la manœuvre s’est avérée bénéfique. La plupart des propriétaires de maison y ont recours, souvent sans même le savoir. En effet, pour la majorité des gens, l’acquisition d’une première habitation se fait avec une mise de fonds variant de 5 à 20 %. En pratique, ces nouveaux propriétaires empruntent de 80 à 95 % de la valeur de leur propriété et profiteront de sa pleine appréciation.
Un exemple : vous achetez une maison au prix de 200 000 $ avec une mise de fonds de 20 000 $. Cinq ans plus tard, vous la revendez 240 000 $, ce qui vous permet de réaliser un gain de 40 000 $, en excluant les coûts de votre hypothèque. Cela représente une appréciation de 20 % par rapport au prix initial de la maison, et un gain de 200 % par rapport à la mise de fonds initiale. Tout un effet de levier!
Par contre, ce genre d’expérience a mal tourné pour d’autres personnes qui se sont contentées de suivre un « conseiller » mettant l’accent surtout sur les gros caractères du contrat pour leur vendre l’effet de levier et qui ont négligé, par le fait même, de prendre connaissance des petits caractères avant de signer.
Répercussions d’une dégelée
Que se serait-il passé, dans notre premier exemple, si le fonds n’avait pas connu un rendement de 10 % ? Pis encore, s’il avait chuté au lieu de progresser ?
À l’aide du même calcul, il est facile d’illustrer ce qui serait arrivé si l’investisseur avait vu la valeur de ses parts fondre de 10 % au cours de l’année : au lieu de dégager un gain de 6 000 $, il aurait perdu la même somme (6 000 $), à laquelle il faut ajouter les intérêts sur l’emprunt, soit 2 800 $ (40 000 $ x 7 %). Cette perte totale de 8 800 $ est 4,4 fois plus élevée que la perte de 2 000 $ que l’investisseur aurait enregistrée en investissant seulement 20 000 $. En pratique, l’investissement de 20 000 $ ne vaudrait plus que 11 200 $ (20 000 $ – 8 800 $), pour une perte de 44 %, alors que le fonds commun n’a chuté que de 10 %!
Il est donc primordial de ne jamais oublier qu’un effet de levier amplifie le mouvement des prix à la hausse comme à la baisse. On peut même affirmer qu’en raison des coûts d’emprunt qui y sont rattachés, cet effet accentue davantage les baisses. Voilà pourquoi il est fortement recommandé aux investisseurs de toujours emprunter un montant qu’ils peuvent rembourser aisément. De fait, toute personne qui décide d’utiliser cette stratégie devrait estimer au départ combien elle est prête à perdre advenant que le pire se produise, un scénario qui n’est pas qu’hypothétique!
Heureusement, bon nombre d’investisseurs limitent leur emprunt à 10 ou à 20 % du capital investi. De cette façon, ils bénéficient de l’effet de levier sans trop s’exposer au risque de s’embourber dans des dettes.
Pour que cette stratégie soit envisageable, il faut que le rendement de l’investissement soit plus élevé que le taux d’intérêt sur l’emprunt. Cette condition signifie que vous devrez opter pour des investissements dont le risque est qualifié de « moyen » à « élevé », car les placements « conservateurs » ne produisent jamais des rendements plus élevés que le taux exigé sur l’emprunt. Or, qui dit « placements risqués » dit également « volatilité accrue des rendements ». Si l’on ajoute un effet de levier à cette combinaison, on se retrouve devant une recette assez explosive. Cœurs sensibles, s’abstenir!
Conditions d’emprunt
Tout investisseur avisé devrait acquérir un autre réflexe, soit celui de bien se renseigner sur les conditions d’emprunt. Quel est le taux d’intérêt? Est-il fixe ou variable? Dans ce dernier cas, il est primordial d’estimer les probabilités d’une hausse des taux d’intérêt, c’est-à-dire d’évaluer les pressions inflationnistes et la montée des taux d’intérêt pouvant en découler.
Il faut savoir également que certains prêts offerts par les sociétés financières sont qualifiés de « sur marge », en ce sens qu’ils peuvent enclencher un appel de marge. En clair, ces facilités de crédit permettent normalement d’emprunter jusqu’à 90 % de la valeur au marché libre d’un titre.
Si, par exemple, un investisseur achète 1 000 titres de la société ABC à 80 $ l’unité, en déposant une couverture (mise de fonds) de 8 000 $ dans son compte sur marge, il empruntera le reste, soit 72 000 $ (80 000 $ x 90 %).
Si, par la suite, le prix unitaire des titres d’ABC baissait à 77 $, le compte serait déficitaire de 2 700 $, parce que le courtier ne pourrait prêter que 90 % de la valeur au marché, soit 69 300 $ (77 000 $ x 90 %). Puisqu’il aurait déjà prêté 72 000 $, le courtier devrait récupérer cette différence de 2 700 $ (72 000 $ – 69 300 $). Si l’investisseur était incapable de lui remettre cette somme rapidement, les titres seraient alors vendus à leur valeur marchande, et l’investisseur subirait une perte de 3 000 $.
Déductibilité des intérêts : nuance !
On entend souvent que l’effet de levier procure un avantage fiscal intéressant, l’intérêt sur l’emprunt pouvant être déduit de l’impôt. Cette affirmation doit être nuancée, car elle omet une différence importante entre la fiscalité du Québec et celle du Canada. En effet, alors que la première permet de déduire les intérêts versés à des fins d’investissement uniquement du revenu d’investissement, la seconde permet de le faire des autres revenus. Cette différence n’est pas anodine puisqu’elle jette un doute sur la possibilité de bénéficier de cet avantage fiscal au Québec, en cas de placements non profitables.
En résumé, bien qu’il soit possible pour un investisseur aguerri ou fortuné de s’enrichir plus rapidement grâce à l’effet de levier, il est primordial de bien analyser tous les risques avant d’aller de l’avant, sans quoi cette aventure pourrait s’avérer catastrophique.
Est-ce que je dépense trop ? Mon avoir est-il plus important que la moyenne des gens? Voilà des questions qui nous sont fréquemment posées et auxquelles il est possible de répondre à l’aide de quelques statistiques. En effet, malgré une situation budgétaire qui varie d’un ménage à l’autre, il appert selon plusieurs spécialistes que « que les gens font à peu près les mêmes choses aux mêmes âges ».
Pour une famille, le coût de la vie évolue en fonction des étapes qu’elle franchit. En début de carrière, on met l’accent sur l’acquisition de biens durables. Par la suite, la naissance d’un ou de plusieurs enfants entraîne une augmentation des dépenses de consommation qui s’accentuent pendant le temps des études, puis diminuent avec le départ des enfants de la résidence familiale. Règle générale, les dépenses de consommation baissent à l’approche de la retraite, tandis que la valeur nette du ménage s’accroît.
Les tableaux ci-dessous devraient vous permettre d’analyser votre situation financière en regard des statistiques québécoises, et plus particulièrement en comparaison avec des professionnels.. Ils sont présentés par groupe d’âge (le nombre moyen d’enfants par ménage est de 2). Comme vous pourrez le constater, dans tous les dossiers que nous avons recensés, les dépenses moyennes des ménages comptant au moins un professionnel de la médecine sont de 67 949 $, soit 1,8 fois plus élevées que celles de la moyenne des Québécois (36 811 $). Quant au revenu moyen d’un ménage comptant au moins un médecin, il s’élève à 168 320 $, soit 3,3 fois celui d’un ménage québécois moyen (51 214 $).
|
40 ans
et moins
|
41 à 49 ans
|
50 à 59 ans
|
60 ans
et plus
|
Total 1
(dossiers recensés)
|
|
Moyenne
Québécoise2
|
| Logement |
23 173 $
|
20 310 $
|
17 131 $
|
12 044 $
|
18 785 $
|
11%
|
12 441$
|
24%
|
| Alimentation |
10 113 $
|
16 518 $
|
13 817 $
|
13 190 $
|
14 447 $
|
9%
|
8 162 $
|
16%
|
| Habillement |
4 744 $
|
5 852 $
|
4 224 $
|
2 843 $
|
4 857 $
|
3%
|
2 238 $
|
4%
|
| Transport |
9 636 $
|
9 165 $
|
7 625 $
|
4 296 $
|
8 245 $
|
5%
|
6 863 $
|
13%
|
| Soins de santé, assurances privées |
6 537 $
|
7 106 $
|
6 619 $
|
3 098 $
|
6 528 $
|
4%
|
2 486 $
|
5%
|
| Éducation |
573 $
|
2 929 $
|
3 466 $
|
520 $
|
2 650 $
|
2%
|
776 $
|
2%
|
| Loisirs |
5 304 $
|
8 625 $
|
5 956 $
|
10 275 $
|
7 345 $
|
4%
|
2 838 $
|
6%
|
| Divers (cadeaux, etc.) |
6 412 $
|
5 181 $
|
5 319 $
|
1 600 $
|
5 092 $
|
3%
|
1 007 $
|
2%
|
| TOTAL |
66 492 $
|
75 686 $
|
64 157 $
|
47 866 $
|
67 949 $
|
40%
|
36 811 $
|
72%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Revenu |
139 515 $
|
191 130 $
|
159 207 $
|
132 400 $
|
168 320 $
|
100%
|
51 214 $
|
100%
|
| Actifs REER |
186 556 $
|
434 364 $
|
632 952 $
|
590 187 $
|
491 232 $
|
|
|
|
| Hors REER |
40 389 $
|
246 951 $
|
178 188 $
|
433 962 $
|
211 453 $
|
|
|
|
|
| 1 Dossiers recensés : |
Échantillonnage du service de planification financière de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. |
| 2 Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 203-0001 |
En résumé, avec une facture fiscale variant entre 30 et 40 % et des dépenses de consommation se situant entre 35 et 45 %, le revenu disponible pour l’épargne d’un professionnel de la médecine est de 20 à 25 %.
Voici un aperçu du fardeau fiscal assumé par les Québécois en 2004. Ce tableau tient compte des crédits personnels de base (au fédéral et au provincial) ainsi que de l’abattement provincial de 16,5 % de l’impôt fédéral de base.
|
Revenu
imposable
|
Impôt
|
|
fédéral
|
provincial
|
Impôt total
|
Taux en vigueur (%)
|
|
30 000 $
|
2 940 $
|
3 060 $
|
6 000 $
|
20,0 %
|
|
50 000 $
|
6 360 $
|
7 060 $
|
13 420 $
|
26,8 %
|
|
75 000 $
|
11 120 $
|
12 840 $
|
23 960 $
|
32,0 %
|
|
100 000 $
|
16 550 $
|
18 840 $
|
35 390 $
|
35,4 %
|
|
150 000 $
|
28 310 $
|
30 840 $
|
59 150 $
|
39,4 %
|
|
200 000 $
|
40 420 $
|
42 840 $
|
83 260 $
|
41,6 %
|
|
L’excédent budgétaire, incluant la cotisation au REER, est investi en vue d’augmenter le patrimoine financier et de réaliser des projets financiers personnels, par exemple constituer un fonds en cas d’imprévu, créer une réserve ou payer des dettes, prendre sa retraite, voyager, acheter un bien durable (chalet, etc.), financer les études des enfants ou investir.
Selon les statistiques, le Québécois moyen épargne près de 6 % de son revenu annuel. Au Québec, le poids du REER dans l’avoir net moyen des ménages n’est que de 13 % selon une étude réalisée en 1999. Selon Statistiques Canada, cette année-là, 55 % des familles détenaient un REER dont la valeur moyenne était de 51 200 $. Ainsi, une personne ayant une rémunération plus élevée (telle qu’un professionnel de la médecine) est généralement en mesure d’épargner davantage. Les statistiques semblent d’ailleurs confirmer cette tendance puisqu’en moyenne, les placements enregistrés de cette personne totalisent 491 232 $, et ses investissements hors REER comptent pour 211 453 $, représentant plus de 60 % de la valeur nette. En fait, il s’agit du capital sur lequel cette personne devra compter pour générer les revenus nécessaires à ses besoins financiers au moment de sa retraite.
Pour vous aider à faire une analyse de votre situation personnelle ou familiale, l’équipe de la sociétéLes Fonds d’investissement FMOQ inc. est à votre disposition. N’hésitez pas à nous consulter.
« Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier », dit le proverbe.
Voilà un conseil plein de bon sens. Intuitivement, il est facile de comprendre qu’en éparpillant nos billes par-ci, par-là, nous risquons moins d’être frappé par une hécatombe.
Pourtant, même si ce proverbe est sans cesse répété par les médias et les compagnies financières, des investisseurs se cassent encore la figure de façon magistrale avec leurs placements. Étonnant ? Pas du tout! Car la nature humaine fait en sorte qu’un individu sera généralement obnubilé par des rendements élevés, mais comprendra mal le risque qui y est associé.
À preuve, tout le système de la Loterie nationale repose sur cette réalité. Les billets de loterie se vendent comme des petits pains chauds parce que les gens sont envoûtés par le gros lot et oublient qu’ils risquent de perdre leur mise.
La seule façon d’éliminer le risque d’être ébloui par des rendements alléchants, et de nous retrouver par erreur à la mauvaise place au mauvais moment, est de bien diversifier le portefeuille. Autrement dit, il vaut mieux avoir à peu près raison en tout temps que d’avoir complètement tort à un moment donné. Les exemples d’étoiles filantes qui se sont subitement transformées en canards boiteux ne manquent pas.
L’expérience démontre également qu’il faut diversifier par classes d’actif, c’est-à-dire les titres boursiers, les obligations et les liquidités, et prendre le temps de déterminer convenablement le poids de ces dernières, tout en tenant compte de notre tolérance au risque et de notre horizon de placement. Gary Brinson, Randolph Hood et Gilbert Beebower, qui ont examiné le portefeuille de 91 grands fonds de pension au milieu des années 80, ont réalisé qu’un peu plus de 90 % de la variabilité du rendement découlait de la politique de répartition d’actif. Cette découverte a ouvert la voie à l’élaboration de stratégies, dont l’objectif est d’accroître le rendement potentiel tout en contrôlant le risque sur une période donnée.
Mais la plupart des gens ne comprennent pas très bien l’impact que cette diversification aura sur leur portefeuille et n’y portent pas vraiment attention lorsque vient le temps d’investir. Pourtant, c’est loin d’être sorcier. En combinant les différentes classes d’actif, on obtient des portefeuilles avec des caractéristiques très différentes.
Une forte pondération de titres boursiers (ex. : actions ordinaires et fiducies de revenu) accroît la performance du portefeuille. Par contre, elle a aussi pour conséquence d’augmenter le risque. Alors, comment choisir ?
Pour déterminer la pondération des actions, il faut comprendre que le risque lié au marché boursier tient au fait que celui-ci évolue selon des cycles réguliers, tout à fait imprévisibles, et produit même des rendements négatifs sur de courtes périodes de temps. Une façon d’atténuer ce risque est de prolonger notre horizon de placement. En effet, le risque d’encaisser une perte du capital, due à un déclin du marché, est beaucoup moins élevé sur une longue période, c’est-à-dire de 5 à 7 ans et plus.
À l’opposé, on remarque que l’ajout de produits plus sécuritaires, telles les obligations (ex. : obligations gouvernementales et obligations corporatives) et les liquidités (ex. : bons du Trésor et Obligations d’épargne du Canada) diminue le risque. Comme ces trois classes d’actif évoluent différemment selon les cycles économiques, leur combinaison a également l’avantage de permettre à ces dernières de se tempérer mutuellement. Autrement dit, lorsqu’une classe d’actif est en difficulté, les autres viennent à sa rescousse.
Préserver l’équilibre
Comme les grandes catégories d’actif ne fluctuent pas de la même façon, il est pratique courante de rééquilibrer périodiquement le portefeuille pour maintenir la répartition d’actif à peu près inchangée à travers le temps. Le rééquilibrage du portefeuille a l’avantage d’être l’un des rares moyens d’accroître le rendement sans encourir de risque supplémentaire.
Comment ça fonctionne ? C’est pourtant très simple. Il suffit de vendre les actifs en portefeuille qui ont été les plus rentables (habituellement les actions) pour acheter ceux qui ont produit les pires rendements.
Le fait que pratiquement tous les tests portant sur des stratégies de rééquilibrage produisent des rendements excédentaires peut sembler étonnant. Mais la seule explication est que les actifs au rendement très élevé ont tendance à s’apprécier au-delà de leur valeur réelle. L’investisseur qui rééquilibre ses actifs régulièrement vend donc les parts de fonds communs de placement les plus chères et achètent les parts bon marché. Lorsque ces parts bon marché retournent à leur valeur réelle (s’apprécient), elles permettent de rentabiliser l’opération de rééquilibrage.
Il est intéressant de constater que l’approche « portefeuille » ne s’appuie pas sur des stratégies financières de haute voltige que seuls quelques adeptes peuvent comprendre. Elle repose plutôt sur le gros bon sens. Ces principes sont pourtant la clé de voûte de toute stratégie de placement visant à minimiser le risque et à maximiser le rendement. Ils nous permettent d’investir judicieusement tout en dormant sur nos deux oreilles.
Bon nombre d’investisseurs en ont mare des rendements de 4 à 5 % offerts présentement par les titres à revenu fixe et salivent rien qu’à l’idée d’obtenir 10 % par année. Lorsque ces derniers découvrent que les fonds de dividendes d’actions canadiennes ont procuré en moyenne (en date de septembre 2007) une performance annuelle de 14,8 % en 5 ans, de 10,3 % en 10 ans et de 11,9 % en 15 ans, ils sont estomaqués.
Est-ce trop beau pour être vrai ? Bien sûr que non, car les dividendes sont synonymes de profitabilité. Pourquoi ? Parce que les actionnaires détiennent les droits de propriété de l’entreprise et en partagent ainsi les succès et les revers. Alors, lorsqu’une société réussit à rentabiliser ses opérations, son premier réflexe sera généralement de chouchouter ses porteurs de parts en leur versant des dividendes.
La générosité des entreprises dans la distribution de cette gratification dépend en premier lieu de ses propres besoins. Dans le cas de sociétés parvenues à un stade de maturité, c’est-à-dire les Blue Chips, une grande partie du bénéfice sera versée en dividendes. Par contre, si les entreprises sont jeunes et en pleine croissance, l’essentiel des profits pourrait servir à en financer l’essor.
Le pourcentage du bénéfice net versé en dividendes varie donc énormément d’une entreprise à l’autre. Toutefois, une chose est certaine, un rendement en dividendes élevé (montant des dividendes/cours de l’action) caractérise généralement une entreprise rentable, bien établie et solide. Au Canada, les sociétés les plus généreuses avec leurs actionnaires évoluent dans les services financiers, les télécommunications et les services publics. Il s’agit donc de placements assez conservateurs qu’un investisseur peut détenir à long terme.
Une autre caractéristique non négligeable est que l’accroissement des dividendes est de nature à provoquer une montée du prix de l’action. La politique de versement de dividendes est donc un facteur clé influençant la valeur d’une entreprise. Ainsi, certaines sociétés, telles que Power Corporation, Banque Royale et Banque Nationale, se sont taillées une réputation appréciable auprès des investisseurs en raison de la constance avec laquelle le flot de dividendes s’est accru ces dernières années.
Dans l’ensemble, cependant, le rendement en dividendes a fléchi au fil des ans au Canada. De 1960 à 1998, le dividende annuel moyen de l’indice phare canadien s’est établi à 3,4 %, révèle l’étude Évolution récente des marchés d’actions et ses conséquences, publiée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Mais le taux a reculé depuis et s’élevait à 2,44 % le 30 mars dernier. Ce repli s’explique en grande partie par le fait que de plus en plus d’entreprises augmentent la valeur de leurs actions (et avantagent les actionnaires) en rachetant les titres en circulation à même leurs bénéfices.
Une dernière particularité des dividendes est que leur traitement fiscal est avantageux. En effet, le taux maximal d’imposition des dividendes versés par les sociétés ouvertes s’élève actuellement à 29,7 % au Québec, comparativement à 48,2 % pour les revenus d’intérêt. C’est donc un placement encore plus intéressant lorsqu’il ne fait pas partie d’un REER.
Choisir avec doigté
Avec un tel profil, pas étonnant que les fonds de dividendes soient en vogue. Leur popularité s’appuie sur les qualités suivantes : constance des rendements, limitation du risque, régularité des revenus et fiscalité avantageuse des dividendes et du gain en capital.
Le risque qui guette cependant les investisseurs est d’être ébahis par ces qualités et, conséquemment, ne pas sélectionner ces fonds diligemment. Pourquoi est-ce important de bien choisir? Parce que cette catégorie de fonds englobe des portefeuilles très différents les uns des autres, puisque l’actif peut être canalisé dans les actions ordinaires, les actions privilégiées, les parts de fiducies de revenu ou les obligations corporatives.
Les composantes clés de ces fonds sont bien entendu les actions ordinaires et privilégiées. Qu’est-ce à dire? Les actions privilégiées sont une action de type particulier qui rapporte un montant fixe de dividendes, puisé à même les profits de l’entreprise. Leur nom signale qu’elles ont priorité sur les actions ordinaires en ce qui concerne le paiement des dividendes. Elles sont en quelque sorte un titre hybride, plus sécuritaire que les actions ordinaires, mais plus risqué que les obligations corporatives.
Bien que les gestionnaires de fonds de dividendes mettent l’emphase sur ces titres, il y a un hic, et il est de taille : les actions ordinaires munies de dividendes élevés et les actions privilégiées sont souvent émises par les mêmes entreprises canadiennes. Par conséquent, les fonds pourraient dépendre d’un nombre restreint d’émetteurs. Pour contourner ce problème, les gestionnaires font normalement appel aux parts de fiducies de revenu et aux obligations de sociétés (corporate bonds).
Jusqu’à tout récemment, les fonds de dividendes fortement investis dans les fiducies de revenu brillaient avec éclat. Étant donné l’avantage fiscal dont jouissent ces fiducies, tous les projecteurs étaient tournés vers elles. Seulement voilà, le gouvernement fédéral a modifié les règles fiscales en novembre 2006 de manière à ce que l’imposition des distributions des fiducies de revenu devienne semblable à celle des dividendes d’ici la fin de 2011. Cette décision, visant à décourager les sociétés ouvertes de se convertir en fiducies de revenu, n’a pas manqué de jeter une douche froide sur la valeur de ces unités et sur le rendement des fonds qui y sont exposés.
Au reste, les obligations d’entreprises constituent le placement le moins avantageux à l’extérieur du REER, car les revenus d’intérêt sont imposables à 100 %. Il faut noter que les obligations ont tout de même l’avantage d’accroître la stabilité du fonds, tout comme les actions privilégiées.
En comprenant mieux les fonds de dividendes, un investisseur peut donc maximiser les avantages qu’il en tire. Il faut aussi noter que les fonds de revenu mensuel, parfois aussi appelés fonds diversifiés, ont fait leur apparition depuis quelques années et sont composés des quatre mêmes classes d’actifs. Ils méritent aussi notre attention.
Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) permet de faire fructifier des épargnes, à l’abri de l’impôt, jusqu’à ce que l’enfant que l’on veut aider (le bénéficiaire) s’inscrive à un programme d’études postsecondaires.
Pour encourager les contribuables à économiser, le gouvernement du Canada verse une subvention (la Subvention canadienne pour l’épargne-études ou SCEE), directement dans le REEE dont l’enfant est bénéficiaire.
Dans son dernier budget, le gouvernement du Canada a adopté des mesures destinées à« rehausser l’attrait des REEE », soit :
- l’élimination du plafond des cotisations annuelles de 4 000 $;
- l’augmentation du plafond cumulatif des cotisations de 42 000 $ à 50 000 $;
- la hausse du montant maximal annuel de la Subvention canadienne pour l’épargne-études de 400 $ à 500 $.
En pratique, ces trois mesures signifient que :
- la cotisation maximale de 4 000 $, par année et par bénéficiaire, n’existe plus;
- pour toute la durée du régime, la limite cumulative des cotisations est désormais de 50 000 $;
- la subvention de 20 % s’applique dorénavant à la première tranche de 2 500 $ des cotisations annuelles, pour un total de 500 $.
Il est à noter :
- que le plafond cumulatif de subvention au régime (7 200 $ au total, par bénéficiaire) demeure le même; en conséquence, quatorze cotisations de 2 500 $ et une quinzième cotisation de 1 000 $ permettront d’atteindre ce montant limite (14 x 500 $ + 1 x 200 $ = 7 200$);
- qu’il est toujours possible de récupérer une année de retard de subvention à la fois. Ainsi, une cotisation de 5 000 $ permettra d’obtenir 1 000 $ de subvention, si l’enfant n’a pas touché toutes les subventions auxquelles il a droit depuis sa naissance.
Le paiement d’aide aux études (PAE)
Le paiement d’aide aux études (PAE) est un montant qui provient d’un REEE et qui est versé pour aider un bénéficiaire à payer le coût de ses études postsecondaires. Constitué des subventions et des revenus accumulés au fil des ans, ce paiement ne comprend pas les cotisations du souscripteur.
Pour un étudiant à temps plein, le PAE est limité à 5 000 $ pour la première session de cégep alors qu’il est sans limite par la suite.
Depuis le dernier budget fédéral, un étudiant à temps partiel peut aussi recevoir un PAE, qui est toutefois limité à 2 500 $ par session.
|
AVANT
le 1er janvier 2007 |
APRÈS
le 1er janvier 2007 |
| Plafond de la cotisation (par année) |
4 000 $ |
Aucun |
| Plafond de la cotisation (à vie) |
42 000 $ |
50 000 $ |
| Plafond de la subvention (à vie) |
7 200 $ |
7 200 $ |
Limite de la subvention annuelle
(en l’absence de retard) |
400 $
(20 % de 2 000 $) |
500 $
(20 % de 2 500 $) |
Limite de la subvention annuelle
(en cas de retard) |
800 $
(20 % de 4 000 $) |
1 000 $
(20 % de 5 000 $) |
| Admissibilité aux PAE |
Étudiants
à temps plein
seulement |
Étudiants
à temps plein
ou à temps partiel(certaines restrictions s’appliquent) |
|
Subvention du gouvernement du Québec
Dans son dernier budget, le gouvernement du Québec a annoncé qu’il ajoutera 10 % sur les premiers 2 500 $ cotisés annuellement dans ce régime.
Même si le gouvernement fédéral n’a pas jugé bon de hausser la limite à vie de la subvention de 7 200 $ à laquelle un bénéficiaire a droit, le régime a été bonifié, car la subvention est dorénavant accordée sur les premiers 2 500 $ de capital investi par enfant, comparativement à 2 000 $ avant le 1er janvier 2007. La subvention annuelle passe ainsi de 400 $ à 500 $. De plus, le gouvernement du Québec ajoute dorénavant une subvention de 250 $ pour toute cotisation annuelle de 2 500 $.
Les autres améliorations apportées au régime sont :
- l’abolition de la limite de cotisation annuelle de 4 000 $;
- l’augmentation de la limite de cotisation à vie, de 42 000 $ à 50 000 $.
Ces deux éléments peuvent modifier d’une manière significative la façon d’accumuler de l’épargne pour les études des enfants.
En effet, dorénavant, des parents ou des grands-parents peuvent, à la naissance de leur enfant ou petit enfant, cotiser d’un seul coup jusqu’à 50 000 $ dans un REEE. Ce faisant, ils peuvent toucher une seule subvention, tout en faisant croître longtemps les revenus à l’abri de l’impôt.
En pratique, une cotisation de 50 000 $ dans un REEE pourrait croître jusqu’à 183 358 $1 après 18 ans, comparativement à 116 447 $2 dans un compte non enregistré. L’écart de 66 911 $ provient presque exclusivement du fait que, dans le REEE, les rendements profitent à l’abri de l’impôt.
Par contre, si un souscripteur investissait plutôt 2 500 $ par année dans un REEE afin de toucher toutes les subventions auxquelles il aurait droit, tout en laissant le reste de son capital de 50 000 $ croître dans un compte non enregistré, son portefeuille (REEE et non enregistré) atteindrait 164 981 $2.

De fait, le scénario idéal se situe entre les deux précédents, car il est préférable de placer rapidement un bon montant à l’abri de l’impôt (même si l’on se prive des subventions gouvernementals futures). Voici un exemple :
- cotiser 30 000 $ à un REEE la première année; et
- placer 20 000 $ dans un compte non enregistré, duquel serait retiré annuellement un montant de 2 500 $ qui serait transféré au REEE, pendant une période de 8 ans.
En agissant ainsi, vous toucherez seulement 6 750 $ de subventions (500 $ X 9 et 250 $ X 9) alors que le maximum est 10 800 $ (7 200 $ au fédéral et 3 600 $ au provincial). Cependant, le portefeuille accumulé atteindra 189 647 $.
1 Rendement projeté de 7 %
2 Rendement projeté de 7 % et taux moyen d’imposition des rendements de 35 %
- Petite capitalisation
- Grande capitalisation
- Style valeur
- Style croissance
- Un peu de chacune
- Aucune de ces réponses
Les marchés boursiers sont composés de titres variés que l’on regroupe par caractéristiques principales pour analyser les facteurs les plus influents sur leur rendement. Ainsi, il y a d’une part les titres dits de petite capitalisation (car la valeur de l’entreprise est plus petite) que l’on compare aux titres de grande capitalisation, et d’autre part les titres de style valeur (dont l’entreprise est plus mature, les revenus et dividendes sont plus stables et dont les cours en bourse sont moins volatils) que l’on compare aux titres de style croissance.
Les experts recommandent de plus en plus d’investir dans les titres de petite capitalisation et dans ceux de style valeur. Ces idées d’investissement gagnent en popularité du fait que ces titres affichent de meilleurs rendements que les titres comparables depuis plus de cinq années consécutives.

La figure 1 illustre le rendement relatif des titres de petite capitalisation, représentés par l’indice des titres américains S&P 600, relativement aux 5 000 titres les plus importants du marché américain, représentés par l’indice Wilshire 5000. Lorsque la ligne du graphique est haussière, comme c’était le cas dans la période de 1999 à 2006, un investisseur obtient de meilleurs rendements en détenant des titres de petite capitalisation plutôt que de l’ensemble du marché boursier.
La figure 1 met d’abord en évidence que, depuis plus de 25 ans, les titres de petite capitalisation offrent essentiellement le même rendement que ceux e l’ensemble du marché boursier, bien que l’on retrouve des cycles à l’intérieur de cette longue période où les rendements diffèrent substantiellement.
Ensuite, on remarque que les titres de petite capitalisation devancent substantiellement leur contrepartie au cours des années qui suivent le creux des récessions. Sur le graphique, la courbe est fortement haussière après 1980, 1990 et 2001.
La raison de l’excellente performance des titres de petite capitalisation durant ces périodes tient d’abord du fait que ce sont, par définition, des titres plus volatils, de compagnies moins matures, dont le plan d’affaires et les revenus reposent sur la commercialisation de biens et services moins diversifiés, dans des marchés plus restreints et dont le bilan est relativement plus faible.
Donc, lorsque la fin d’un cycle économique se transforme en récession, les titres de petite capitalisation sont les plus durement touchés. Par conséquent, lorsque les banques centrales abaissent leurs taux d’intérêt de manière expansionniste pour relancer les économies, que la demande reprend et que les investisseurs reprennent goût au risque, les titres les plus sensibles à la relance économique sont ces mêmes titres de petite capitalisation.
Cependant, cinq années ont maintenant passé depuis la dernière récession et, suivant le succès de la relance économique mondiale, les banques centrales ont ajusté leur politique monétaire de vivement expansionniste à plutôt neutre. Donc, pendant que le rythme de croissance économique mondial ralentit en s’ajustant à ces nouvelles conditions monétaires, que l’accès au capital devient plus onéreux et difficile pour les entreprises moins bien assises, ce sont les titres de grande capitalisation qui commencent à afficher des rendements relatifs supérieurs.
Les grandes entreprises sont comparativement moins sensibles au coût et à la réduction que la quantité de capital disponible, et leur plus grande diversification commerciale et étendue géographique leur permettent de mieux assurer la progression de leur chiffre d’affaires.
L’essentiel n’est donc pas de savoir si les titres de petite capitalisation constituent un meilleur ou un pire investissement que ceux de l’ensemble du marché boursier, mais plutôt de reconnaître que leur attrait dépend du prix que l’on paie pour les acheter. Et il semble que de nos jours, les titres de petite capitalisation sont à un extrême de valorisation par rapport à leur vis-à-vis depuis vingt-cinq ans. Ainsi, la probabilité d’afficher de meilleurs rendements au cours des deux ou trois prochaines années favorise les titres de grande capitalisation.
On observe aussi aujourd’hui d’ailleurs un extrême de valorisation entre les titres de style valeur par rapport à ceux de style croissance.

La figure 2 suggère de nouveau que sur les 25 dernières années, les investisseurs défensifs détenant des titres de style valeur et les investisseurs agressifs avec des titres de croissance, ont obtenu essentiellement le même rendement.
Durant la période de 1998 à 2000, les personnes et les entreprises ont accéléré l’adoption d’Internet dans leurs pratiques commerciales, beaucoup d’investissements ont eu lieu en prévoyance du bogue de l’an 2000, mais surtout plusieurs disaient alors qu’il y avait un miracle de productivité, que l’on avait battu l’inflation et le caractère cyclique de l’économie. Tous préféraient les titres de croissance et on peut clairement voir l’appréciation de ces titres par rapport à ceux de style valeur sur le graphique.
Depuis, il y a eu la récession américaine, l’éclatement de la bulle spéculative des titres de technologie, les scandales financiers, les attentats terroristes. Tous les événements ont fait croire à bien des économistes que les entreprises seraient bien hésitantes à créer de l’emploi et à investir, que la relance serait difficile à engendrer et qu’il y avait même un risque sérieux de baisse généralisée des prix à la consommation (déflation).
Dans un tel contexte, qui voudrait investir dans des entreprises qui réinvestissent leur précieux capital pour mettre au point de nouveaux produits ou marchés? Les investisseurs étaient clairs : ils privilégiaient les sociétés qui retournaient de préférence leurs profits aux actionnaires sous forme de dividendes.
Les années 2001 à 2006 montrent ainsi le phénomène d’entraînement qui s’est instauré dans l’esprit des investisseurs. On achète des titres de style valeur par prudence parce qu’ils sont moins volatils et parce qu’ils donnent de gros dividendes. En principe, c’est raisonnable. Mais quel est le prix que l’on paie pour les actions qui offrent ces caractéristiques?
La figure 2 nous montre que relativement aux titres de croissance, les titres de style valeur sont essentiellement à leur prix le plus cher depuis 25 ans.
En réalisant que le cycle économique est bien durable, qu’il n’y a pas de risque de récession imminent, que la santé financière des consommateurs, des entreprises et des gouvernements est saine, que les occasions d’augmenter la productivité par l’entremise d’acquisitions et de sous-traitance partout dans le monde sont abondantes, la probabilité d’avoir de meilleurs rendements au cours des deux ou trois prochaines années semble donc plus élevée avec les titres de style croissance.
En terminant, même si l’on entend aujourd’hui plusieurs observateurs recommander l’achat de titres de petite capitalisation et de titres de style valeur, nous croyons qu’il y a lieu d’être prudent à cet égard puisqu’il faut continuer de toujours prendre en compte d’autres facteurs comme sa tolérance au risque, son horizon de placement et l’ensemble de son portefeuille avant de faire un choix d’investissement.
Parmi les nombreux articles de nature économique et financière, certains s’avèrent particulièrement intéressants. Dans le texte qui suit, vous pourrez constater que même quelques années après sa publication, l’article de Madame Stéphanie Grammond, publié dans La Presse du 31 mars 2002, n’en demeure pas moins intéressant et tout aussi pertinent.
Les gaffes du boursicoteur
Il faut apprendre de ses erreurs, mais quand on peut apprendre des erreurs des autres, c’est encore mieux! Et à la Bourse, ça coûte moins cher. Quels sont les pires bévues de l’investisseur individuel qui se lance sur les parquets boursiers ? Nous en avons dressé la liste à partir des commentaires de professionnels de la finance et des témoignages de visiteurs du site de Cyberpresse, qui nous ont raconté leurs bévues.
Gaffe 1. Il met tous ses œufs dans le même panier
QUI NE CONNAÎT PAS le fameux dicton : « Il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier » ? Pourtant, la gaffe la plus classique et la plus fréquente du boursicoteur
reste la sur-concentration, et pas seulement dans le temps de Pâques !
Les conseillers en placement ont beau faire de la diversification une véritable rengaine, la leçon n’est pas assimilée, comme l’illustre l’histoire de cet investisseur « dégonflé ».
« Après une entrée intéressante sur les marchés boursiers (bonnes acquisitions et
aussi très bons profits), j’ai tenté le grand coup en unissant une bonne partie de mes avoirs dans un titre unique et soi-disant prometteur. C’est ainsi que mes espoirs et ma carrière de boursicoteur en ont pris pour leur rhume avec 360networks », raconte l’homme qui a payé le titre 34,40 $. La société de Colombie-Britannique qui voulait
mettre sur pied un réseau de fibre optique, est présentement sous la protection de la loi sur la faillite. Son action ne vaut plus que 13 cents.
D’autre part, il ne faut pas croire qu’en détenant un grand nombre de titres, on diversifie automatiquement son portefeuille. « C’est incroyable ! Je vois très souvent des portefeuilles de 100 000 $ où il y a 70 000 $ en titres de technologie. Et la personne se demande si elle devrait acheter du Nortel ou du CGI », dit Vincent Delisle, stratège chez Valeurs mobilières Desjardins.
Par ailleurs, « contrairement à ce que bien des investisseurs individuels pensent, il est encore plus important de diversifier son portefeuille dans les obligations que dans les actions », dit Jean-Paul Giacometti, vice-président de la Corporation de gestion de placements Claret.
Du côté des actions, si un titre s’écroule, il est très probable que les gains importants qu’une autre société dans votre portefeuille atténue les pertes. « Mais du côté des
obligations corporatives (des titres de dettes émis par des sociétés), vous ne pouvez pas compter sur l’envolée des autres obligations en portefeuille pour compenser pour
les pertes en cas de faillite d’une société dont vous détenez un titre à revenus fixes.
« On ne peut jamais trop diversifier son portefeuille d’obligations corporatives », conclue
donc M. Giacometti.
Gaffe 2. Il suit le troupeau et achète au sommet
TROP SOUVENT, l’investisseur accroche aux modes et suit le troupeau, alors que pour réussir, il faut savoir aller à contresens. Pour Éric F. Gosselin, président de la section
planification financière à l’Ordre des administrateurs agréés du Québec, le comportement le plus typique du boursicoteur est le suivant : « Les investisseurs particuliers commencent à investir quand le marché a déjà remonté de 15 ou
20 %. Et quand le marché est au plancher, c’est à ce moment là qu’ils vendent. »
Le réflexe d’acheter au sommet vaut aussi pour des titres individuels, comme l’illustre la gaffe de Monsieur N., un autre visiteur de Cyberpresse, qui a acquis 100 actions de Netgraphe à 19,25 $. Porté par la foule d’investisseurs qui voulaient profiter du Klondike de l’Internet, le titre de cette petite société québécoise a atteint un sommet 19,80 $ en mars 2000. Mais deux mois plus tard, son prix était déjà retombé de moitié. Et aujourd’hui l’action vaut 27 cents… tout comme en 1999, avant la bulle.
Gaffe 3. Il tombe en amour avec ses titres gagnants
CERTAINS investisseurs s’entichent de leurs actions qui ont enregistré une belle performance. Ils tombent en amour avec les entreprises gagnantes. Mais l’amour rend aveugle. Quand les signaux de vente commencent à ressortir, l’investisseur amoureux n’y voit que du feu !
« Qui a su vendre à temps Nortel Networks, Groupe CGI ou Research in Motion ? » demande M. Gosselin. Cette dernière firme, spécialisée dans le matériel pour les communications sans fil, a vu son action s’emballer de 11 $ à 227 $ en un an… mais ensuite s’effondrer à 35 $ en quelques semaines.
Gaffe 4. Il s’acharne à conserver ses titres perdants
D’AUTRES investisseurs, qui refusent d’encaisser leurs pertes, s’acharnent à conserver des titres déprimés en espérant un jour récupérer leur mise…
« La pire gaffe que j’ai faite, a été de m’entêter à garder des actions qui ne finissent plus de descendre (exemple : Nortel Networks, Bombardier, BCE, Lorus, etc.) Je crois qu’il faudrait liquider au plus tôt toute action qui a perdu 1 $. Si j’avais fait cela je serais plus riche de plusieurs milliers de dollars », raconte un autre investisseur qui nous a
écrit via Cyberpresse.
Cette réaction est certainement excessive, mais il est vrai qu’il faut éviter de sombrer avec un titre. Encore plus, il faut éviter de s’enterrer avec une action qui demeure perpétuellement à la baisse, en utilisant la technique de la moyenne à la baisse, recommande M. Giacometti. Cette technique consiste à augmenter sa position dans un titre qu’on possède déjà et dont la valeur a baissé. Au total, on peut ainsi réduire son coût d’achat moyen.
« On peut faire ça une fois ou deux, mais il faut s’arrêter. Sinon, ça devient comme la technique au casino, où on mise toujours sur la même couleur (rouge ou noire) en
doublant sa mise à chaque fois qu’on perd ! » dit-il.
Gaffe 5. Il confond Bourse et casino
À PROPOS, bien des boursicoteurs confondent l’investissement et la spéculation. Au lieu de passer leur temps au casino, ils jouent à la Bourse. « La gestion de portefeuille,
ça ne devrait pas être excitant », met en garde M. Delisle.
« Si vous voulez vous amuser, ouvrez un autre compte, à part, qui contiendra 5 à 10 % de votre portefeuille, pas plus. Quand vous aurez perdu votre mise, vous ne pourrez pas aller piger davantage dans votre compte principal », suggère M. Giacometti.
Gaffe 6. Il confond bonne société et bonne action
« LA MAJORITÉ de la population ne fait pas la différence entre une bonne compagnie et une bonne action », affirme M. Delisle. Une société peut avoir une « belle histoire » à raconter, une croissance extraordinaire, un produit extrêmement prometteur. Mais tout a un prix. « Je peux vous vanter une voiture totalement infaillible qui roule à 350 kilomètres à l’heure. Mais est-ce que vous allez l’acheter si son prix est de six millions de dollars ? » illustre M. Giacometti.
L’important en investissement est d’être capable de déterminer si la valeur de l’action est attrayante compte tenu des perspectives de la société.
« D’ailleurs lorsqu’on est trop proche d’une entreprise (si vous êtes employé ou si des membres de votre famille le sont), il est préférable de ne pas trop y investir », dit M. Delisle. Ce conseil vaut son pesant d’or quand on pense au cas d’Enron, où les employés ont tout perdu, leur emploi et leurs épargnes en vue de la retraite, qui étaient principalement investies en actions de leur employeur.
Gaffe 7. Ses connaissances financières sont déficientes
IL NE SUFFIT PAS d’avoir le goût de s’occuper de son portefeuille d’investissements. Encore faut-il avoir du temps à investir et des connaissances approfondies… ce qui est loin d’être toujours le cas, comme l’illustre cette anecdote.
« Je me souviendrai toujours d’un investisseur qui m’avait dit qu’il était déçu de son conseiller parce qu’il lui avait fait acheter du Bombardier. Selon lui, ça n’avait pas été un bon placement parce que « le titre restait toujours à l’intérieur d’une fourchette de 16 $ à
20 $ depuis plusieurs années », raconte le stratège. Or, il faut savoir que Bombardier a l’habitude de fractionner son action en deux dès qu’elle monte. Ceci retranche la moitié de la valeur de l’action, mais tous les investisseurs en ont deux fois plus.
Gaffe 8. Il écoute les tuyaux de son beau-frère
LE BOURSICOTEUR oublie souvent de faire ses devoirs. Il prend des décisions de placements de bribes d’information ou de rumeurs. Il écoute les tuyaux de son fameux
beau-frère qui lui parle de ses actions qui ont doublé. Ou encore, il s’abreuve des manchettes des journaux qui relatent les escalades boursières des coqueluches de l’heure.
Le lendemain matin, le boursicoteur se rue pour acheter les titres en question… mais il est trop tard.
Quand on achète des actions d’une entreprise, il faut avoir la même attitude que si on achetait la compagnie au complet… à l’image de l’investisseur américain Warren
Buffett.
Gaffe 9. Il se laisse submerger par une mer d’informations
LORSQU’IL TENTE de faire ses devoirs, l’investisseur particulier se laisse parfois prendre au piège de la surinformation. Il se laisse submerger par la mer d’information des journaux, de la télévision, des analystes financiers des maisons de courtage, et d’Internet. Il n’arrive pas à faire le tri parmi les différentes sources et il ne sait pas comment interpréter les avis de tous et chacun.
Gaffe 10. Il veut des coups de circuit
« C’EST UNE ÉPIDÉMIE chez les jeunes investisseurs », dit M. Giacometti. Ils visent des rendements trop élevés. Et leurs ambitions les brûlent. « Pour les jeunes, ce n’est pas tant le rendement qui va générer la plus grande partie de la croissance du capital. C’est plutôt l’habitude de mettre régulièrement des sous de côté », dit M. Giacometti.
Note : Article reproduit suite à une permission obtenue de La Presse, tous droits réservés.
Depuis longtemps, on parle de l’intégration, dans l’échiquier mondial, de ces deux économies géantes de par leurs populations, mais si différentes de par leurs institutions, leurs infrastructures et leurs marchés financiers.
En raison de l’importance du sujet, l’intégration de ces deux pays dans les dynamiques commerciales et financières mondiales occupe une grande place dans les discussions des investisseurs, non seulement du fait de l’entrée de la Chine au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et du boom technologique de la dernière décennie, mais également en raison de l’afflux de liquidités et de l’enthousiasme (peut-être même un peu euphorique) que suscitent les titres de ces pays.
Bien que la Chine affiche un rythme de croissance réelle moyenne de son économie de près de 10 % depuis une vingtaine d’années (rythme d’ailleurs plus rapide que celui de l’Inde au cours de la même période qui s’élève à 5 %), cette croissance n’équivaut pas nécessairement à un meilleur rendement sur le parquet de la Bourse.
Performance boursière
Les tableaux 1 et 2 illustrent en effet le rendement des Bourses de la Chine, de l’Inde et de l’ensemble des pays en voie de développement, cumulativement depuis 1992 et depuis le creux des marchés boursiers, en 2002. Depuis 1992, la Chine a accumulé un retard important face à la plupart des pays émergents; depuis 2002, elle n’atteint que le rendement moyen de l’ensemble de ces pays, ce qui la positionne bien loin derrière la Bourse indienne.


Pourquoi cette différence entre les performances de l’économie et de la Bourse de ces pays?
Contribution économique — secteur agricole
Il faut d’abord garder en perspective que la Chine et l’Inde sont deux pays en voie de développement et que l’origine de leurs croissances économiques respectives est différente de celle des pays industrialisés.
Au cours du vingtième siècle, ces derniers ont vu leurs économies passer d’un fondement manufacturier à un fondement de services. Aujourd’hui, par exemple, plus de 65 % du PIB du Canada repose sur la prestation de services. Cette transformation a réduit considérablement la volatilité du cycle économique, car l’accumulation et la liquidation d’inventaires et de main-d’œuvre accentuaient l’amplitude des récessions et des expansions.
De la même façon, une économie fondée davantage sur le secteur agricole est encore plus volatile qu’une économie manufacturière, mais surtout plus imprévisible, car elle dépend plus des aléas des conditions météorologiques et des récoltes.
Au cours des 15 dernières années (voir le tableau 3), la Chine a fait plus de progrès que l’Inde pour réduire la proportion de son économie fondée sur l’agriculture. Toutefois, l’Inde a toujours préservé, depuis cette période, un avantage marqué, en raison de la proportion de son produit intérieur provenant du secteur des services.

Par conséquent, l’économie chinoise est aujourd’hui très liée au cycle de la demande mondiale des biens manufacturés, étant donné que plus de 53 % de son PIB est lié au secteur de l’industrie; de son côté, l’économie de l’Inde est moins sensible à ce même cycle, mais plus dépendante de la température.
Dans le prochain texte, nous aborderons les contributions du secteur privé et des régimes politiques ainsi que les composantes de la croissance économique de ces deux pays.
Contribution économique — Secteur privé
Depuis une quinzaine d’années (tableau 1), les économies de la Chine et de l’Inde ont maintenu les contributions respectives des différents agents à la croissance économique.

Malgré le régime centralisateur communiste chinois, la proportion du PIB consommée par le gouvernement ne représente que 12 % de la demande interne, tout comme en Inde et au Canada.
Par contre, ce sont les investissements (infrastructures, énergie, transport, communication, gestion de l’eau, etc.) qui distinguent la Chine de l’Inde, avec un rythme de croissance spectaculaire qui stimule d’autant les gains de productivité manufacturière qui la caractérisent. Cette abondance de capitaux disponibles est possible grâce au taux d’épargne de plus de 40 % du PIB dont jouit la Chine depuis une quinzaine d’années et qui a des effets multiplicateurs sur le rythme de croissance économique.
Pour sa part, le taux d’épargne en Inde s’est maintenu à la moitié du taux chinois, soit autour de 20 %, au cours de cette même période. Étant donné la disponibilité moindre des capitaux, les politiques économiques ont plutôt favorisé les détenteurs de ces mêmes capitaux (en élevant des barrières à la concurrence, comme l’allocation de permis et de quotas) au détriment de l’atteinte d’un rythme de croissance plus élevé.
Par conséquent, la demande intérieure de l’Inde est dominée par le secteur de la consommation privée, c’est-à-dire des ménages qui consomment des biens durables ou non, secteur qui subit l’influence à son tour de l’accroissement du revenu disponible de la population (baisses d’impôt, augmentation des salaires et des revenus de placement).
Contribution économique — Régimes politiques
Plusieurs observateurs dénoncent le non-respect des libertés individuelles en Chine et reconnaissent le régime démocratique de l’Inde. Il n’en demeure pas moins que le pouvoir central chinois constitue la clé d’une croissance rapide soutenue, tandis que le modèle démocratique indien s’avère un fardeau important pour la croissance économique du pays.
Plus précisément, la détermination des autorités politiques chinoises à développer le pays, économiquement et financièrement, a fait en sorte de favoriser des politiques macroéconomiques, comme les expérimentations régionales avec le système capitaliste, la direction du développement infrastructurel et économique des différentes régions ainsi que l’allègement de la réglementation sur le commerce externe.

Croissance ou profits ?
Il y a souvent confusion entre croissance économique et croissance boursière. Un système juridique efficace qui soutient le respect des contrats, assorti d’une contrainte de capitaux, peut permettre aux entreprises concurrentielles de produire de protéger des profits des plus considérables.
Toutefois ces ingrédients ne sont pas nécessaires pour la croissance économique d’un pays en voie de développement. L’expérience chinoise prouve qu’il est possible de diriger une croissance économique rapide en créant des marchés de consommation efficaces et en investissant de façon importante dans les infrastructures. La croissance chinoise est due à la canalisation efficace du fort taux d’épargne en investissements. Cet état de fait solidement établi continuera d’attiser un rythme de croissance accéléré tout au long de la prochaine décennie, indépendamment des progrès relatifs à la protection des droits de la personne, au système juridique ou à la libéralisation des marchés financiers.
Contrairement à la Chine, l’Inde compte un nombre important de très grandes entreprises privées, cotées en Bourse et oeuvrant dans un marché international très concurrentiel. La Chine ne possède pas de telles entreprises, ses plus importantes étant des sociétés d’État. Souvent alourdies par la main-d’œuvre et les dettes, ces dernières n’ont pas nécessairement comme objectif la maximisation des bénéfices, car elles sont plutôt préoccupées à accroître leurs revenus. En effet, plus l’entreprise est grande et emploie un nombre élevé de personnes, plus elle est susceptible de bénéficier de l’appui de l’État lorsqu’elle est en difficulté. Les sociétés privées tendent alors à être beaucoup plus petites, à fonctionner avec des marges bénéficiaires des plus minces et dans des marchés des plus concurrentiels; elles n’ont pas accès au financement des marchés des capitaux intérieurs ou internationaux.
Par conséquent, le rendement des actions en Bourse a généralement été plus élevé en Inde qu’en Chine et devrait continuer de l’être.

Curriculum vitae de Ben S.Bernanke |
| Naissance : |
13 décembre 1953, à Augusta, en Géorgie |
| Études : |
1975 : B.A. en économie (Université Harvard)
1979 : Ph.D. en économie du Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| Expérience : |
1979-1985 : professeur à l’Université Stanford
1985-2002 : professeur à l’Université de Princeton
2002-2005 : membre du Board of Governors de la Réserve fédérale
Juin 2005-janvier 2006 : président du President’s Council of Economic Advisers à la Maison-Blanche
1er février 2006 : président élu de la Réserve fédérale américaine pour un mandat de 14 ans |
|
|
Le 1er février 2006, la nomination de Dr Ben S. Bernanke à la présidence de la Réserve fédérale américaine (la Fed) était confirmée. Dr Bernanke succédait officiellement à M. Alan Greenspan, en poste depuis 1987.
Depuis plusieurs mois, les investisseurs spéculaient sur les principes directeurs susceptibles de guider les décisions des candidats à la présidence de la Fed, et plus particulièrement sur ceux de Dr Bernanke depuis sa nomination comme gouverneur, en octobre 2005.
Principes directeurs de Dr Bernanke
À ce titre, Dr Bernanke avait déjà révélé, dans le cadre de plusieurs travaux et à l’occasion d’allocutions, sa philosophie quant au rôle et à la direction de la politique monétaire.
Le nouveau président endosse le mandat à deux volets de la Fed, en l’occurrence la stabilité des prix et la maximisation de l’emploi. Selon lui, il est insuffisant de viser exclusivement la stabilité des prix, comme le requiert le mandat de la Banque centrale européenne, en supposant que la demande et l’emploi s’ajusteront automatiquement. Ses assises théoriques d’économiste et de professeur l’ancrent fermement dans cette vision du rôle de la Fed.
Pour Dr Bernanke, la gestion d’une cible pour l’inflation est un mécanisme dont l’objectif principal est de fixer les attentes inflationnistes des marchés. Lorsque ces dernières sont stables, la Fed dispose de plus de flexibilité pour gérer les objectifs de la demande et de l’emploi, selon les circonstances du moment.
D’autre part, le nouveau président de la Fed rejette l’idée selon laquelle il revient à la banque centrale de prévenir et d’intervenir lorsqu’une bulle spéculative se manifeste. Il met en doute la capacité de quiconque d’identifier avec certitude le développement d’une telle bulle et de déterminer avec justesse l’intervention à prescrire. Dr Bernanke croit essentiellement que le rôle de la Fed est de viser l’économie et non les marchés financiers.

En ce qui concerne le déficit du compte courant américain, Dr Bernanke attribue le gonflement de ce dernier non pas à la consommation excessive américaine de biens et de services étrangers, mais plutôt à une demande mondiale excessive pour les actifs américains, demande générée par une épargne mondiale exorbitante en raison de la faiblesse de la consommation en Europe et au Japon, de l’intégration de l’épargne chinoise dans les marchés financiers mondiaux et de l’intervention des banques centrales asiatiques pour empêcher l’appréciation de leurs devises depuis l’éclatement de leurs marchés, en 1997-1998. Avec une telle préférence pour les actifs américains, le déficit du compte courant peut toujours être facilement financé; il le sera jusqu’à une reprise de la demande, en Europe et en Asie.
Un début plutôt difficile ?
L’entrée en fonction d’un nouveau président de la Fed crée naturellement une incertitude quant à la poursuite du mandat de cette institution si importante pour les fondements de l’économie et des marchés financiers.
À la suite de la nomination de M. Alan Greenspan, en 1987, les marchés avaient craint qu’il ne manifeste pas la même détermination que son prédécesseur, M. Paul Volker, pour contrôler les pressions inflationnistes de l’époque.
Reflétant cette inquiétude, les marchés avaient alors salué l’entrée en fonction de M. Greenspan par une hausse des taux d’intérêt obligataires, de 7 % à 10 %. L’histoire retient qu’il avait alors relevé le défi des marchés par une hausse tout aussi incisive des taux d’intérêt directeurs de la Fed. Cette décision conduisit à une retombée des taux d’intérêt à long terme… par le biais du fameux crack boursier.
Cette fois-ci, les taux d’intérêt à long terme demeurent toujours relativement stables, à suite de l’intronisation de Dr Bernanke, mais c’est le prix de l’or qui a bondi depuis sa nomination, en octobre 2005, comme l’illustre le graphique ci-contre.
Avec une hausse de 466 USD* l’once, en octobre 2005, à 652 USD l’once, lors de la rédaction de cet article, une question se pose : les marchés doutent-ils de la capacité de DrBernanke de contrôler efficacement les pressions inflationnistes et de préserver la valeur du dollar américain ?
Pareille hypothèse serait inquiétante, mais elle n’est pas supportée par la réaction des autres marchés financiers qui devraient être tout aussi sensibles à une telle éventualité. Il semble plutôt que la montée du prix de l’or soit davantage liée à la forte demande pour le métal précieux en Inde, au Moyen-Orient et en Chine, de même qu’aux tensions géopolitiques actuelles. Il faut néanmoins reconnaître la coïncidence de ces événements.
La montée du prix de l’or lance-t-elle donc un défi au nouveau président de la Réserve fédérale américaine? Dr Bernanke tentera-t-il de contrer la montée du prix de l’or, comme M. Greenspan avait contré l’envolée des taux d’intérêt obligataires, ou ignorera-t-il ce mouvement de marché, puisqu’il ne reflète pas une inquiétude sur le contrôle de l’inflation ?
Les questions sont posées. Les réponses ne tarderont pas.
* Code du dollar américain selon la norme ISO 4217 relative aux codes des monnaies du monde
À juste titre, les frais de scolarité et, surtout, les frais afférents aux études collégiales ou universitaires préoccupent bon nombre d’étudiants et leurs parents. En effet, en dépit du gel des premiers qui totalisent approximativement 3 000 $ par année, les seconds, eux, peuvent facilement atteindre 10 000 $ par année.
Avec un taux d’inflation annuel qui se situe à 3 % pour le logement et autres frais de subsistance, et à 5 % pour les frais de scolarité, c’est une somme d’environ 22 000 $ qu’il faudra débourser, dans une quinzaine d’années, pour financer une année complète d’études universitaires.
Indéniablement, pour beaucoup de personnes, les études postsecondaires représentent un véritable défi financier pour lequel il n’existe pas de panacée, si ce n’est de mettre de l’argent de côté, le plus tôt possible, afin d’amasser un pécule intéressant qui s’apprécie au fil des ans.
Le régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Or, si épargner de l’argent en vue des études d’un enfant est une chose, le faire fructifier pour qu’il s’apprécie de façon significative en est une autre. C’est pourquoi le régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un mode d’épargne à envisager sérieusement, et ce, d’autant plus qu’il comporte deux principaux avantages.
Premier avantage
Tous les revenus d’intérêts, de dividendes et de gain en capital produits par le régime s’accumulent, année après année, à l’abri de l’impôt. Lorsque ces sommes sont retirées afin de payer les études postsecondaires, l’impôt est alors calculé en fonction des revenus de l’étudiant et donc assujetti, dans la plupart des cas, à un taux d’imposition moindre.
Deuxième avantage
Depuis 1998, le programme Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE)encourage fortement l’épargne. En effet, la subvention versée correspond à 20 % de la première tranche de 2 000 $ de cotisation annuelle pour chaque enfant de moins de 18 ans (sous réserve de certaines restrictions pour les enfants de 16 et 17 ans). Il est aussi possible d’investir un autre 2 000 $ annuellement, mais cet investissement sera subventionné seulement si l’enfant n’a pas reçu toutes les subventions auxquelles il a droit depuis sa naissance (ou depuis 1998, selon l’année la plus récente).
De plus, depuis le 1er janvier 2005, le taux de la SCEE pour la première tranche de 500 $ des cotisations versées au REEE dont le bénéficiaire est un enfant de moins de 18 ans, a augmenté pour s’établir à :
- 40 % si le revenu net admissible de la famille de l’enfant pour l’année ne dépasse pas 36 378 $;
- 30 % si le revenu net admissible de la famille de l’enfant s’élève à plus de 36 378 $, sans dépasser 72 756 $.
Le revenu net admissible de la famille de l’enfant pour une année sera habituellement le même que celui qui est utilisé pour déterminer la Prestation canadienne fiscale pour enfants.
Toutes les autres cotisations admissibles au REEE donnant droit à la SCEE demeurent au taux de 20 %.
Conditions
La cotisation annuelle maximum permise est de 4 000 $, tandis que le plafond cumulatif est fixé à 42 000 $.
En investissant 2 000 $ annuellement pendant 18 ans, il est possible d’obtenir un montant maximal de subvention s’élevant à 7 200 $.
Une contribution à un REEE est permise jusqu’à la 21e année suivant l’établissement du régime qui, lui, peut être conservé pendant 25 ans.
À qui appartient le capital investi ?
Le capital investi dans un REEE appartient au souscripteur, c’est-à-dire la personne qui contribue au REEE. À la fin du régime, le souscripteur peut reprendre son capital.
Attention! Dans le cas des retraits de capital qui ne serviraient pas au paiement d’aide aux études, on peut devoir rembourser la subvention canadienne reçue. Afin d’éviter les mauvaises surprises, il est très important de vérifier les conséquences qu’entraînerait ce type de remboursement.
Et si l’enfant ne poursuit pas d’études postsecondaires ?
Différents scénarios peuvent alors être envisagés par le souscripteur :
- Désigner un autre bénéficiaire, si le régime auquel on a adhéré le permet.
- Retirer le capital investi – À condition que le REEE soit ouvert depuis au moins 10 ans et que le bénéficiaire soit âgé d’au moins 21 ans : – sous réserve de la disponibilité de droits de cotisation REER suffisants, transférer jusqu’à 50 000 $ des revenus accumulés du REEE à un REER. Dans ce cas, les revenus accumulés ne seront pas imposés, mais il faudra rembourser les subventions reçues ; ou
- Retirer le capital investi – À condition que le REEE soit ouvert depuis au moins 10 ans et que le bénéficiaire soit âgé d’au moins 21 ans ; – encaisser les revenus. Le souscripteur devra alors payer de l’impôt sur les revenus du REEE et subir une pénalité de 20 %. Les subventions reçues devront être remboursées.
- Si le régime n’est pas ouvert depuis au moins 10 ans et/ou que le bénéficiaire n’est pas âgé d’au moins 21 ans : reprendre le capital et faire don des revenus du REEE à un établissement d’enseignement postsecondaire de son choix. Encore là, il faudra rembourser les subventions reçues.
Le REEE s’avère donc un mode d’épargne doublement intéressant, car il permet de profiter d’un abri fiscal et de généreuses subventions gouvernementales.
Les conseillers de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. sont à votre disposition pour vous fournir de plus amples renseignements sur le REEE ainsi que sur toute autre question d’ordre financier.